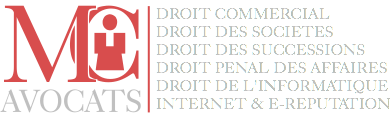2015

Le coût du droit de suite, qui doit être payé à l’auteur lors de toute revente d’une œuvre d’art par un professionnel, peut tout aussi bien être supporté définitivement par le vendeur que par l’acheteur
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Le droit de suite est défini par une directive de l’Union Européenne 2001/84/CE du 27 septembre 2001 et par l’article L.122-8 du Code de la propriété intellectuelle (en droit français) comme le droit pour l’auteur d’une œuvre d’art originale à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession.
L’article L.122-8, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle dispose que le droit de suite est à la charge du vendeur et que la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur.
Dans le cadre de l’organisation de ventes aux enchères d’œuvres d’art organisée par Christie’s France, certaines de ces ventes donnent lieu à la perception d’un droit de suite. Or, les conditions générales de vente de Christie’s France prévoient que, pour certains lots désignés dans son catalogue, cette dernière perçoit de la part de l’acheteur, pour le compte et au nom du vendeur, la somme correspondant au droit de suite.
Le Syndicat National des Antiquaires (SNA) estimant que les conditions générales de Christie’s France constituaient un acte de concurrence déloyale en mettant le droit de suite à la charge de l’acheteur a souhaité poursuivre Christie’s France en justice.
Pour sa part,Christie’s France considère que la Directive européenne 2001/84/CE du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, énonce sans autre précision ou restriction, que le droit de suite est à la charge du vendeur et qu’elle n’exclut donc pas un aménagement conventionnel de la charge du paiement de ce droit.
Saisie de ce litige, la Cour de cassation française demande à la Cour de justice si le vendeur supporte toujours définitivement le coût du droit de suite ou bien s’il est possible de déroger à cette règle par voie conventionnelle.
La CJUE, dans un arrêt C-41/14 « Christie’s France / SNC », répond que si la directive dispose que la personne redevable du droit de suite est en principe le vendeur, elle prévoit néanmoins une dérogation à ce principe et laisse ainsi les États membres libres de définir une autre personne parmi les professionnels visés dans la directive 2001/84.
La personne redevable du droit de suite ainsi désignée par la législation nationale est libre de convenir avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que cette dernière supporte en définitive, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu’un tel arrangement contractuel n’affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur.
En tout état de cause, il convient de bien souligner que Christie’s France avait pris soin de noter que le paiement de la redevance du droit de suite était réglée « au nom et pour le compte du vendeur », instaurant ainsi un mandat afin de paiement, en toute transparence. Il paraît bien évidemment plus prudent de se placer sous la double bannière de cette question préjudicielle à la CJUE et du mandat afin d’être certain de profiter de l’aménagement organisé par la Directive 2001/84/CE.
Enfin, reste à savoir si le législateur profitera d’un nième lifting du CPI pour introduire cette exception au coeur de l’article L.122-8, exception qui semble définitivement acquise.

2014

La SGDL vous invite à sa conférence sur le nouveau contrat d’édition, le 13 janvier 2015 à l’Hôtel de Massa
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Comme nous l’avions commenté dans ce billet, le contrat d’édition a été assez substantiellement remanié.
La Société Des Gens de Lettres (SGDL), association reconnue d’utilité publique, ex-société de perception et de répartition de droits, souhaiterait communiquer autour du nouveau contrat d’édition, conforme aux nouvelles dispositions légales entrées en vigueur au 1er décembre 2014 et organise une rencontre d’information et d’échange sur ce nouveau contrat le 13 janvier 2015 à l’Hôtel de Massa.
Pour plus d’information :
SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES
Hôtel de Massa
38, rue du Fbg-St-Jacques, 75014 Paris
tél : 01 53 10 12 00 fax : 01 53 10 12 12
www.sgdl.org – courriel : sgdl@sgdl.org

2014

Le nouveau contrat d’édition et l’édition numérique
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Le Code de la propriété intellectuelle vient de nouveau d’être mis à jour, par une Ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition dont les contours, la forme et les conditions d’exploitation sont désormais mieux définies et ne relèveront plus de la seule appréciation du juge parfois différente d’une juridiction à l’autre.
Cet ajout législatif consiste notamment à intégrer la notion d’édition d’oeuvres par voie électronique en dessinant les contours de forme et de fond du contrat de cession de droits relatifs à ce type d’exploitation de l’oeuvre. L’ordonnance modifie donc certains des articles déjà existants et rajoute une sous-section 2 au livre I du Code de la propriété intellectuelle, par l’ajout de huit articles L. 132-17-1 à L. 132-17-8 .
1. Le contrat d’édition plus formaliste sur la cession de droit et la rémunération de l’auteur
Le contrat d’édition portant sur un ouvrage littéraire devra déterminer les conditions de la cession sur support papier et sur support numérique (« ebook » ou « livre numérique ») dans des parties distinctes, à peine de nullité de la cession.
Surtout, le nouvel article L. 132-17-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le contrat d’édition garantit à l’auteur « une rémunération juste et équitable » sur l’ensemble des recettes provenant de la commercialisation et de la diffusion d’un livre édité sous une forme numérique, et qu’en cas de vente à l’unité, la participation proportionnelle aux recettes au profit de l’auteur est calculée en fonction du prix de vente au public hors taxes. Cela renvoie directement au mode de commercialisation de type e-book à l’unité, comme sur la plateforme iTunes par exemple.
Résolument moderne (on pouvait s’y attendre de la part du Pr. Sirinelli), le modèle économique reposant en tout ou partie sur la publicité ou sur toutes autres recettes liées indirectement au livre est pris en compte et doit avoir un impact direct sur la rémunération due à l’auteur à ce titre. Ce mode de rémunération est donc clairement autorisé, ce dont certaines sociétés très en avance en la matière, telle Youboox et ses partenaires éditeurs, peuvent se féliciter.
Enfin la rémunération forfaitaire est exclue pour la cession de l’ensemble de ses droits d’exploitation sous une forme numérique et pour tous les modes d’exploitation numérique du livre, sauf dans les cas de contributions à caractère accessoire ou non essentiel, tels que mentionnés au 4o de l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, pour une opération déterminée.
De manière non moins importante, l’article L. 132-17-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le contrat d’édition doit comporter une clause de réexamen des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme numérique, sans toutefois qu’une périodicité ou des conditions de déclenchement n’aient été introduites par le législateur… ce qu’on peut regretter car la mise en oeuvre d’une telle clause risque là encore de faire couler de l’encre jurisprudentielle.
2. Des obligations d’exploitation de l’oeuvre et de reddition des comptes renforcées
Le contrôle de la rémunération effective l’auteur et de l’exploitation effective de l’oeuvre sont désormais regardées de plus près en renforçant les obligations de l’éditeur.
Concernant la reddition des comptes, l’éditeur devra désormais procéder à une reddition des comptes au moins une fois par an, à la date prévue au contrat et au plus tard six mois après l’arrêté des comptes qui précède. A défaut, l’auteur disposera d’une faculté de résiliation du contrat, de plein droit.
De plus, concernant l’exploitation de l’oeuvre, l’auteur pourra également remettre en cause le contrat par voie de résiliation si, pendant deux années consécutives suivant les quatre premières années de la publication de l’œuvre, les états de comptes ne font apparaître aucun droit versé ou crédités en compensation d’un à-valoir, au titre d’aucune des opérations de vente sur support papier, vente à l’unité par voie numérique, consultation en ligne ou traduction intégrale.
Toutefois, le II. de l’article L.132-17-4 et l’article L. 132-17-8 du Code de la propriété intellectuelle disposent qu’un accord entres organisations professionnelles et syndicats d’auteurs pourrait être rendu obligatoire par le Ministre chargé de la culture afin de déroger aux règles fixées par le I. de l’artice L.132-17-4 par la mise en place d’autres modalités concernant cette obligation d’exploitation de l’oeuvre.

2014

Droit des brevets : de la contrefaçon à la nullité du brevet pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Agir en contrefaçon contre un concurrent en vertu d’un brevet d’invention n’est pas sans risque : le défendeur dans un procès en contrefaçon a la faculté d’invoquer la nullité du brevet, soit pour défaut de nouveauté, soit pour défaut d’activité inventive. Il convient donc, avant d’agir en justice, de prendre soin d’analyser scrupuleusement les forces en présence, le brevet et ses revendications, la date de sa première mise en oeuvre, ainsi que les modes de divulgation du procédé protégé.
De même, un soin particulier doit être apporté aux opérations de saisie-contrefaçon car la nullité des opérations peut anéantir tout le système de preuve nécessaire à la démonstration de la contrefaçon.
Enfin, la conduite du procès en contrefaçon nécessite une certaine prudence pour ne pas voir la procédure se retourner contre soi alors qu’on était demandeur au départ : le fait d’annoncer à des clients ou des prospects qu’un procès en contrefaçon est en cours contre un concurrent est susceptible d’être qualifié d’acte de concurrence déloyale par dénigrement.
Dans un jugement rendu le 10 octobre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a eu l’occasion de se prononcer, une fois n’est pas coutume : sur la nullité du brevet pour défaut de nouveauté ; sur la nullité d’une saisie contrefaçon pour défaut de signature de la requête par l’avocat de la requérante ; et sur la demande reconventionnelle du défendeur (c’est à dire du prétendu contrefacteur) au titre du dénigrement.
La nullité des opérations de saisie-contrefaçon pour défaut de signature de la requête
Dans cette affaire le Tribunal a retenu que « l’absence de signature de la requête vicie l’ensemble des actes subséquents et le tribunal est compétent pour prononcer la nullité des procès-verbaux des opérations de saisie réalisées (…). »
En effet, les deux requêtes présentées au nom de la société demanderesse n’étaient pas signées : si elles mentionnaient que l’avocat auteur de la requête était l’avocat de la société demanderesse, cette seule mention ne permettaient pas de connaître l’identité et la qualité de la personne ayant effectivement formulé la requête en l’absence de toute signature.
Cette absence de signature de la requête afin de saisie-contrefaçon constitue un vice de fond qui entraîne la nullité de l’acte sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief.
De plus, le Tribunal vient confirmer qu’en matière de saisie-contrefaçon, les dispositions de l’article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile ne font pas obstacle à ce que le juge du fond appréciant la validité des éléments de preuve qui lui sont soumis, puisse annuler des procès-verbaux de saisie pour des motifs tirés des conditions de délivrance de l’ordonnance, outre le fait que la faculté lui en est expressément réservé parle Code de la propriété intellectuelle.
Par conséquent, l’ensemble des demandes fondées sur la contrefaçon du brevet dont la protection était sollicitée reposant uniquement sur les informations et documents obtenus lors des saisies contrefaçon, ont été rejetées par le Tribunal en l’absence de tout élément de preuve valide.
La nullité du brevet pour défaut de nouveauté
Dans cette affaire le Tribunal constate qu’une notice, datée d’avril 2005, publiée sur le site Internet de la société demanderesse, quoique postérieure au dépôt du brevet effectué en juillet 2003, indique néanmoins que depuis dix ans la technologie protégée par le brevet litigieux dans différents marchés… la société demanderesse expose donc sur son site internet qu’elle exploite la technologie de son brevet depuis plus de 7 ans avant que n’en soit déposée la demande de brevet.
C’est l’exemple type du procédé frappé d’un défaut de nouveauté et rendant le brevet nul.
Il convient en effet de rappeler ici que l’INPI n’effectue pas de contrôle a priori sur la validité et la nouveauté du brevet : cette hypothèse est donc beaucoup plus fréquente qu’on ne le pense et c’est la raison pour laquelle il est important de toujours examiner le critère de nouveauté d’un brevet de manière approfondie que l’on soit en défense ou que l’on prévoit d’assigner en contrefaçon.
Le Tribunal conclue donc sa découverte ainsi : « Il ressort ainsi de cette notice datée de 2005 que la société [demanderesse] commercialise un procédé de filtrage avec décolmatage automatique des diatomées par injection d’eau et d’air comprimé depuis 10 ans soit depuis 1995. Ainsi cette notice réalisée par la société [demanderesse] constitue une preuve d’une divulgation du procédé objet de l’invention, antérieure au dépôt du brevet. (…) Ainsi la société [demanderesse] ayant divulgué l’invention telle que présentée dans la revendication n°1 avant d’avoir procédé au dépôt du brevet, celle-ci ne présente pas le caractère nouveau requis par la loi et doit être déclarée nulle.«
En voulant se faire sa publicité, la société demanderesse s’est donc tiré une balle dans le pied.
Le défaut de détachement des revendications du brevet et son effet sur la nullité globale du brevet
Dans cette affaire, le Tribunal va logiquement pousser son raisonnement sur la nullité de la revendication n°1 dudit brevet pour en déduire d’éventuels effets sur les autres revendications.
Le Tribunal constatera que, bien que la demanderesse ait invoqué également les revendications dépendantes 2 et 3, 5 à 9 et 11 à 13 de son brevet FR 2 857 833 et que les défenderesses aient sollicité l’annulation du brevet dans son ensemble, il ne s’est pas instauré de discussion sur la validité des revendications dépendantes, c’est à dire que la société demanderesse n’a pas cherché à défendre les autres revendications de son brevet.
Et le Tribunal en a déduit que la nouveauté et l’activité inventive du brevet étaient uniquement incluses dans la revendication n°1 de telle sorte que l’ensemble des revendications, qui portent sur des aménagements secondaires, ont donc été également annulées.
La contre-attaque du défendeur pour concurrence déloyale par dénigrement
Non contente d’assigner son prétendu contrefacteur en justice, la société demanderesse a cru bon d’indiquer aux clients et prospects commun de son concurrent, qu’elle avait assigné ce dernier en contrefaçon en joignant une copie de son assignation à ses correspondances.
Le Tribunal indique que l’assignation qui jointe aux courriers de la demanderesse, présente de manière partiale les faits reprochés à la société défenderesse et en la joignant aux lettres, la société demanderesse a fait perdre à l’information qu’elle délivrait leur caractère pondéré et strictement nécessaire pour manifestement tenter d’influencer la décision des communes sur l’attribution des marchés (“Nous vous laissons en tirer les conséquences”).
Le Tribunal ne retient pas la faute au titre de l’envoi d’un simple mail d’information, mais bien de la fourniture conjointe de l’assignation qui est un document par définition partial. C’est en cela que la communication va être jugée fautive et que sera reconnu un droit à réparation au profit du concurrent.
L’arroseur devient arrosé.

2014

JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2013
Tribunal de Grande Instance de Paris Read More
2014

L’Acte d’Avocat : définition et sécurité des transactions
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Le CNB explique ce qu’est l’Acte d’Avocat et le type de contrats ou d’accords qu’il permet de sécuriser (rupture du contrat de travail, cession de fonds de commerce, cession de marque, licence de logiciel, cession de droit d’auteurs, vente de site internet, compromis de vente, séquestre, séquestration du prix, séquestration des sources, contrat de confidentialité…)
Acte sous seings privés sécurisé, l’acte d’avocat permet de s’assurer de la qualité des parties et de la validité des clauses contractuelles stipulées au contrat, grâce à l’intervention d’un ou plusieurs avocat(s) rédacteur(s) de l’acte.
Chaque avocat enregistre son client après vérification des éléments d’identité et chaque client signe le contrat par voie électronique : pas de papier, l’Acte d’Avocat est, en outre, écolo !
Voir également notre service d’accompagnement à la cession de sites internet (rédaction du contrat de vente, séquestration du prix, séquestration des sources, enregistrement du contrat).

2014

Contrefaçon de dessins et modèles communautaires : la protection des design enregistrés et non enregistrés en Europe
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /La Cour de Justice de l’Union Européenne vient de revenir sur les notions de dessins et modèles enregistrés et de dessins et modèles non enregistrés, dans un arrêt n° C‑345/13 du 19 juin 2014 « Karen Millen Fashions Ltd contre Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd ».
Dans cet arrêt l’Avocat Général, M. Melchior Wathelet, a pris le soin, dans ses conclusions du 02 avril 2014, de rappeler et d’expliciter le texte du règlement n°6/2002 DU CONSEIL du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.
Rappelons à ce titre que le règlement européen dispose que la protection d’un dessin ou modèle par un dessin oumodèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel, ces critères se définissant ainsi :
- CARACTERE NOUVEAU : un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public :
a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ;
b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle dont la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.
- CARACTERE INDIVIDUEL : Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public :
a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ;b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle dont la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.
La CJUE a suivi les conclusions de son avocat général en concluant que, dans le cadre d’actions en contrefaçon, un dessin ou modèle communautaire non enregistré doit être présumé valide si son titulaire indique dans quelle mesure il présente un caractère individuel.
Toutefois la question portait également sur la question de savoir si l’existence du caractère individuel du dessin ou modèle (ou du design) doit être examinée en référence seulement à un ou plusieurs dessins ou modèles individuels divulgués au public antérieurement, ou s’il doit également être examiné en référence à des combinaisons d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs.
Dans son arrêt du 14 juin 2014, la Cour constate juge que le caractère individuel d’un dessin ou modèle en vue de l’octroi d’une protection au titre du règlement doit être apprécié par rapport à un ou plusieurs dessins ou modèles précis, individualisés, déterminés et identifiés parmi l’ensemble des dessins ou modèles divulgués au public antérieurement.
Par conséquent, cette appréciation ne peut pas se faire en référence à une combinaison d’éléments spécifiques et isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs.
En conséquence pour s’assurer de la protection conférée par son dessin ou modèle, même non enregistré, le titulaire de droit doit donc simplement démontrer en quoi son dessin ou modèle présente un caractère individuel : c’est-à-dire qu’il doit identifier le ou les éléments du dessin ou modèle concerné(s) qui, selon lui, confère(nt) un tel caractère à celui-ci.

2014

La marque, même tridimensionnelle n’a pas vocation à protéger un design
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Marque ou modèle, il faut choisir. C’est ainsi que l’avocat général Maciej Szpunar auprès de la CJUE a estimé que le droit de l’Union excluait tout enregistrement à titre de marque des formes imposées par la fonction du produit ainsi que les formes dont les caractéristiques esthétiques décident de l’attrait exercé par le produit.
En l’espèce, la société norvégienne Stokke A/S a déposé auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle une demande d’enregistrement pour une marque tridimensionnelle.
Cette marque reprend le dessin en trois dimensions (ou le design ou le modèle, selon l’expression préférée) de la chaise pour enfant « Tripp Trapp ».
De son côté, la société allemande Hauck GmbH & Co. KG produit et distribue des articles pour enfant, dont deux modèles de chaise nommés « Alpha » et « Beta ».
La société Stokke A/S et les deux auteurs personne physique du design industriel introduisent un recours contre la société Hauck, au motif que la vente des chaises « Alpha » et « Beta » viole leurs droits d’auteur ainsi que les droits tirés de la marque enregistrée par la société Stokke A/S.
La société Hauck forme une demande reconventionnelle, afin de l’annulation de la marque. En 2000, une juridiction néerlandaise accueille favorablement le recours des auteurs en ce qui concerne la violation des droits d’auteur tout en annulant, conformément à la demande de la société Hauck, l’enregistrement de la marque de la société Stokke A/S.
Saisi d’un pourvoi en cassation, le « Hoge Raad der Nederlanden » (Cour suprême des Pays-Bas) pose à la CJUE des questions préjudicielles sur les motifs pour lesquels une marque constituée par la forme du produit peut être frappée de nullité.
C’est dans ce contexte que l’avocat général a estimé que la notion de « forme imposée par la nature même du produit », couvre non seulement les formes naturelles et les formes qui font l’objet de normes (comme par exemple la forme d’une banane pour les bananes ou bien celle d’un ballon de rugby), mais également d’autres formes, à savoir celles dont les caractéristiques essentielles résultent de la fonction du produit concerné. Il s’agirait par exemple, pour une table, de pieds accolés à un plateau horizontal ou, pour une brique, de la forme d’un parallélépipède.
L’avocat général considère également que le droit de l’Union exclut l’enregistrement d’une forme dont l’ensemble des caractéristiques essentielles sont conditionnées par la fonction utilitaire assurée par le produit. Réserver des caractéristiques revêtant une importance essentielle pour la fonction du produit au bénéfice d’un seul opérateur économique ferait obstacle à ce que des entreprises concurrentes attribuent à leurs produits une forme qui serait tout aussi utile à l’utilisation de ces derniers. Le propriétaire de la marque se verrait ainsi octroyer un avantage significatif qui aurait des effets négatifs sur la structure de la concurrence sur le marché concerné.
S’agissant du motif de refus ou de nullité basé sur les « formes qui donnent une valeur substantielle au produit », l’avocat général indique que le champ d’application de ce motif ne se limite pas aux œuvres d’art et aux œuvres des arts appliqués. Il concerne également les produits qui ne sont pas ordinairement perçus comme des objets assurant une fonction ornementale, mais pour lesquels l’aspect esthétique de la forme constitue l’un des éléments essentiels décidant de leur attractivité et joue un rôle important sur un certain segment défini du marché (comme c’est le cas pour les meubles de design). Partant, ce motif s’applique aux formes dont les caractéristiques esthétiques constituent une des raisons principales pour lesquelles le consommateur décide d’acheter le produit. Cette interprétation n’exclut pas que le produit présente d’autres caractéristiques importantes pour le consommateur.
Il semblait en effet utile de rappeler que les objets (les biens) matériels ne peuvent pas faire l’objet d’un dépôt de marque dans le sens où la forme de l’objet pourrait créer au bénéfice du déposant un monopole d’exploitation, ce qui n’est pas souhaitable.
En effet, la superposition du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles (du design autrement dit) protègent déjà suffisamment les objet tridimensionnels faisant l’objet d’une exploitation artisanale ou industrielle.
A ce titre, la logique de l’avocat général n’est pas sans rappeler les analyses faites quant au caractère propre qu’un dessin ou modèle doit conserver afin de conférer une protection efficace à l’objet auquel il se rapporte.
Enfin, les conclusions de l’avocat général doivent également être mises en lumière au regard du fait qu’une marque peut être renouvelée sans limite de temps… alors que le dessin ou modèle est limité à 25 ans d’existence que ce soit un dessin ou modèle français ou un dessin ou modèle européen.
L’aspect temporel du monopole conféré au titulaire de droit n’est donc pas neutre dans l’affaire et il aurait été bon d’y faire directement référence, car c’est aussi cela qui motive, sans nul doute, la position de l’avocat général… position qui, rappelons-le, n’engage pas la CJUE…
Attendons donc la solution.

2014

Un fournisseur d’accès à Internet peut se voir ordonner de bloquer à ses clients l’accès à un site web qui porte atteinte au droit d’auteur.
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Un fournisseur d’accès à Internet peut se voir ordonner de bloquer à ses clients l’accès à un site web qui porte atteinte au droit d’auteur.
Une telle injonction et son exécution doivent toutefois assurer un juste équilibre entre les droits fondamentaux concernés.
La Cour estime dès lors que les droits fondamentaux concernés ne s’opposent pas à une telle injonction, à la double condition que les mesures prises par le fournisseur d’accès ne privent pas inutilement les utilisateurs de la possibilité d’accéder de façon licite aux informations disponibles et que ces mesures aient pour effet d’empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les
utilisateurs de consulter les objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle.
La Cour précise que les internautes ainsi d’ailleurs que le fournisseur d’accès à Internet doivent pouvoir faire valoir leurs droits devant le juge. Cette thèse était d’ailleurs déjà validée par la Cour d’appel de Paris, à l’initiative des avocats notamment de FREE, ORANGE, BOUYGUES et SFR.
Il appartient aux autorités et aux juridictions nationales de vérifier si les conditions sus-citées sont bien remplies.
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
27 mars 2014 (*)
«Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Société de l’information – Directive 2001/29/CE –Site Internet mettant des œuvres cinématographiques à la disposition du public sans le consentement des titulaires d’un droit voisin du droit d’auteur – Article 8, paragraphe 3 – Notion d’ʻintermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisinʼ – Fournisseur d’accès à Internet – Ordonnance adressée à un fournisseur d’accès à Internet lui interdisant d’accorder à ses clients l’accès à un site Internet – Mise en balance des droits fondamentaux»
Dans l’affaire C‑314/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 11 mai 2012, parvenue à la Cour le 29 juin 2012, dans la procédure
UPC Telekabel Wien GmbH
contre
Constantin Film Verleih GmbH,
Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 juin 2013,
considérant les observations présentées:
– pour UPC Telekabel Wien GmbH, par Mes M. Bulgarini et T. Höhne, Rechtsanwälte,
– pour Constantin Film Verleih GmbH et Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH, par Mes A. Manak et N. Kraft, Rechtsanwälte,
– pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Schillemans et C. Wissels, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Christie, en qualité d’agent, assisté de M. S. Malynicz, barrister,
– pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. F. W. Bulst, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 novembre 2013,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, paragraphes 1 et 2, sous b), et 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10), ainsi que de certains droits fondamentaux consacrés par le droit de l’Union.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant UPC Telekabel Wien GmbH (ci-après «UPC Telekabel») à Constantin Film Verleih GmbH (ci-après «Constantin Film») et à Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH (ci-après «Wega») au sujet d’une demande tendant à ce qu’il lui soit enjoint de bloquer l’accès de ses clients à un site Internet mettant à la disposition du public certains des films de ces dernières sans leur consentement.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 9 et 59 de la directive 2001/29 énoncent:
«(9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. […] La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.
[…]
(59) Les services d’intermédiaires peuvent, en particulier dans un environnement numérique, être de plus en plus utilisés par des tiers pour porter atteinte à des droits. Dans de nombreux cas, ces intermédiaires sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes. Par conséquent, sans préjudice de toute autre sanction ou voie de recours dont ils peuvent se prévaloir, les titulaires de droits doivent avoir la possibilité de demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre d’un intermédiaire qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’une œuvre protégée ou d’un autre objet protégé. […] Les conditions et modalités concernant une telle ordonnance sur requête devraient relever du droit interne des États membres.»
4 L’article 1er de ladite directive, intitulé «Champ d’application», dispose à son paragraphe 1:
«La présente directive porte sur la protection juridique du droit d’auteur et des droits voisins dans le cadre du marché intérieur, avec une importance particulière accordée à la société de l’information.»
5 L’article 3 de la même directive, intitulé «Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés», prévoit à son paragraphe 2:
«Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement:
[…]
c) pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films;
[…]»
6 L’article 8 de la directive 2001/29, intitulé «Sanctions et voies de recours», indique à son paragraphe 3:
«Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.»
Le droit autrichien
7 L’article 18a, paragraphe 1, de la loi sur le droit d’auteur (Urheberrechtsgesetz), du 9 avril 1936 (BGBl. 111/1936), telle que modifiée par la nouvelle loi de 2003 sur le droit d’auteur (Urheberrechtsgesetz-Novelle 2003, BGBl. I, 32/2003, ci-après l’«UrhG»), est libellé comme suit:
«L’auteur a le droit exclusif de mettre l’œuvre à la disposition du public, par fil ou sans fil, d’une manière qui permette à chacun d’y avoir accès de l’endroit et au moment de son choix.»
8 L’article 81, paragraphes 1 et 1a, de l’UrhG dispose:
«1. Toute personne dont un droit exclusif conféré par la présente loi a été violé ou qui redoute une telle violation peut engager une action en abstention. Le propriétaire d’une entreprise peut aussi être poursuivi en justice si la violation a été commise au cours de l’activité de son entreprise par l’un de ses employés ou par un mandataire ou si elle menace de l’être; l’article 81, paragraphe 1a, s’applique mutatis mutandis.
1a. Si l’auteur d’une telle atteinte ou la personne dont une telle atteinte est à craindre utilise à cette fin les services d’un intermédiaire, une action en abstention peut également être introduite contre ce dernier au titre du paragraphe 1. […]»
9 L’article 355, paragraphe 1, du code relatif aux procédures d’exécution dispose:
«La procédure d’exécution forcée à l’encontre de la personne tenue de cesser d’agir ou de tolérer un agissement prévoit que, pour chaque violation perpétrée après que l’obligation a acquis force exécutoire, le tribunal saisi de l’exécution, en accordant cette dernière, inflige, sur demande, une sanction pécuniaire. Pour chaque violation ultérieure, le tribunal saisi de l’exécution doit infliger, sur demande, une sanction pécuniaire supplémentaire ou une peine d’emprisonnement d’une durée totale d’un an maximum. […]»
10 Il ressort des explications fournies par la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle que, au stade de la procédure d’exécution forcée, le destinataire de l’interdiction peut faire valoir, pour s’exonérer de sa responsabilité, qu’il a pris toutes les mesures qui pouvaient être attendues de lui afin d’empêcher le résultat interdit.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 Constantin Film et Wega, deux sociétés de production cinématographique, ayant constaté qu’un site Internet proposait, sans leur accord, soit de télécharger, soit de regarder en «streaming» certains des films qu’elles avaient produits, ont saisi le juge des référés aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 81, paragraphe 1a, de l’UrhG, la délivrance d’une ordonnance enjoignant à UPC Telekabel, un fournisseur d’accès à Internet, de bloquer l’accès de ses clients au site Internet en cause, dans la mesure où ce site met à la disposition du public, sans leur consentement, des œuvres cinématographiques sur lesquelles elles détiennent un droit voisin du droit d’auteur.
12 Par ordonnance du 13 mai 2011, le Handelsgericht Wien (Autriche) a interdit à UPC Telekabel de fournir à ses clients l’accès au site Internet litigieux, cette interdiction devant être notamment réalisée en bloquant le nom de domaine et l’adresse IP («Internet Protocol») actuelle de ce site ainsi que toute autre adresse IP de ce dernier dont cette société pourrait avoir connaissance.
13 Au mois de juin 2011, le site Internet litigieux a cessé son activité à la suite d’une action des forces de police allemande à l’encontre de ses exploitants.
14 Par ordonnance du 27 octobre 2011, l’Oberlandesgericht Wien (Autriche), en tant que juridiction d’appel, a partiellement réformé l’ordonnance de la juridiction de première instance en ce que celle-ci avait, à tort, spécifié les moyens qu’UPC Telekabel devait mettre en œuvre pour procéder au blocage du site Internet litigieux et ainsi exécuter l’ordonnance d’injonction. Pour parvenir à cette conclusion, l’Oberlandesgericht Wien a estimé que l’article 81, paragraphe 1a, de l’UrhG doit être interprété à la lumière de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29. Puis, il a considéré que, en donnant accès à ses clients aux contenus mis en ligne illégalement, UPC Telekabel devait être considérée comme un intermédiaire dont les services étaient utilisés pour porter atteinte à un droit voisin du droit d’auteur de sorte que Constantin Film et Wega étaient en droit de demander à ce qu’une ordonnance soit prononcée contre cette société. Cependant, s’agissant de la protection du droit d’auteur, l’Oberlandesgericht Wien a estimé qu’UPC Telekabel pouvait uniquement se voir obligée, sous la forme d’une obligation de résultat, d’interdire à ses clients l’accès au site Internet litigieux, mais qu’elle devait rester libre de décider des moyens à mettre en œuvre.
15 UPC Telekabel a formé un pourvoi en «Revision» devant l’Oberster Gerichtshof (Autriche).
16 Au soutien de son pourvoi, UPC Telekabel fait notamment valoir que ses services ne pouvaient être considérés comme utilisés pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, car elle n’entretenait aucune relation commerciale avec les exploitants du site Internet litigieux et il n’est pas établi que ses propres clients ont agi de manière illégale. En tout état de cause, UPC Telekabel soutient que les différentes mesures de blocage susceptibles d’être mises en œuvre peuvent toutes être techniquement contournées et que certaines sont excessivement coûteuses.
17 Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 […] doit-il être interprété en ce sens qu’une personne qui met des objets protégés à la disposition du public sur Internet sans l’autorisation du titulaire de droits [au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29] utilise les services du fournisseur d’accès [à Internet] des personnes qui consultent ces objets?
En cas de réponse négative à la première question:
2) Une reproduction effectuée pour un usage privé [au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29] et une reproduction transitoire ou accessoire [au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29] ne sont-elles licites que si l’exemplaire servant à la reproduction a été reproduit, diffusé ou mis à la disposition du public en toute légalité?
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question, c’est-à-dire dans le cas où une ordonnance judiciaire doit être rendue à l’encontre du fournisseur d’accès [à Internet] conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29:
3) Est-il conforme au droit de l’Union et notamment à la nécessaire mise en balance des droits fondamentaux des parties concernées d’interdire au fournisseur d’accès [à Internet] dans des termes très généraux (c’est-à-dire sans prescription de mesures concrètes) d’accorder à ses clients l’accès à un site Internet dont l’intégralité ou une partie substantielle du contenu n’a pas été autorisée par le titulaire de droits, lorsque le fournisseur d’accès peut échapper aux astreintes visant à réprimer la violation de cette interdiction en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables?
En cas de réponse négative à la troisième question:
4) Est-il conforme au droit de l’Union et notamment à la nécessaire mise en balance des droits fondamentaux des parties concernées d’imposer à un fournisseur d’accès [à Internet] des mesures concrètes visant à rendre plus difficile à ses clients l’accès à un site Internet dont le contenu a été illégalement mis à disposition, lorsque ces mesures, qui requièrent des moyens non négligeables, peuvent facilement être contournées sans connaissances techniques spécifiques?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité des questions préjudicielles
18 À titre liminaire, il convient de relever que la circonstance selon laquelle le site Internet en cause au principal a cessé son activité ne rend pas les questions préjudicielles irrecevables.
19 En effet, en vertu d’une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, non encore publié au Recueil, point 34).
20 Ainsi, le rejet par la Cour d’une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt Aziz, précité, point 35).
21 Or, tel n’est pas le cas du litige au principal, puisqu’il ressort de la demande de décision préjudicielle que, en vertu du droit autrichien, la juridiction de renvoi doit rendre sa décision sur la base des faits tels qu’ils ont été exposés dans la décision de première instance, c’est-à-dire à un moment où le site Internet en cause au principal était encore accessible.
22 Il découle de ce qui précède que la demande de décision préjudicielle est recevable.
Sur la première question
23 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’une personne qui met à la disposition du public sur un site Internet des objets protégés sans l’accord du titulaire de droits, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, utilise les services du fournisseur d’accès à Internet des personnes qui consultent ces objets, lequel serait à considérer comme un intermédiaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.
24 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans l’affaire au principal, il est constant que des objets protégés ont été mis à la disposition des utilisateurs d’un site Internet sans le consentement des titulaires de droits évoqués audit article 3, paragraphe 2.
25 Vu que, selon cette disposition, les titulaires de droits jouissent du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire tout acte de mise à la disposition du public, il doit être constaté qu’un acte de mise à la disposition du public d’un objet protégé sur un site Internet effectué sans le consentement des titulaires de droits porte atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins.
26 Pour remédier à une telle situation d’atteinte aux droits en question, l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 prévoit la possibilité, pour les titulaires de droits, de demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à l’un de leurs droits.
27 En effet, ainsi que l’indique le considérant 59 de la directive 2001/29, dès lors que les services d’intermédiaires sont de plus en plus utilisés pour porter atteinte au droit d’auteur ou à des droits voisins, ces intermédiaires sont, dans de nombreux cas, les mieux à même de mettre fin à ces atteintes.
28 En l’occurrence, le Handelsgericht Wien, puis l’Oberlandesgericht Wien ont enjoint à UPC Telekabel, fournisseur d’accès à Internet visé par l’injonction en cause au principal, de mettre fin à l’atteinte portée aux droits de Constantin Film et de Wega.
29 UPC Telekabel conteste toutefois pouvoir être qualifiée, au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, d’intermédiaire dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.
30 À cet égard, il découle du considérant 59 de la directive 2001/29 que le terme d’«intermédiaire», employé à l’article 8, paragraphe 3, de cette directive, vise toute personne qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’une œuvre protégée ou d’un autre objet protégé.
31 Eu égard à l’objectif poursuivi par la directive 2001/29, tel qu’il ressort notamment du considérant 9 de celle-ci, qui est de garantir aux titulaires de droits un niveau de protection élevé, la notion de contrefaçon ainsi employée doit être entendue comme incluant la situation d’un objet protégé mis sur Internet à la disposition du public sans l’accord des titulaires de droits en question.
32 Par suite, vu que le fournisseur d’accès à Internet est un acteur obligé de toute transmission sur Internet d’une contrefaçon entre l’un de ses clients et un tiers, puisque, en octroyant l’accès au réseau, il rend possible cette transmission (voir, en ce sens, ordonnance du 19 février 2009, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, C‑557/07, Rec. p. I‑1227, point 44), il y a lieu de considérer qu’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal, qui permet à ses clients d’accéder à des objets protégés mis à la disposition du public sur Internet par un tiers, est un intermédiaire dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.
33 Une telle conclusion est corroborée par l’objectif poursuivi par la directive 2001/29. En effet, exclure les fournisseurs d’accès à Internet du champ d’application de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 diminuerait substantiellement la protection des titulaires de droits, voulue par cette directive (voir, en ce sens, ordonnance LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, précitée, point 45).
34 Ladite conclusion ne saurait être remise en cause par l’objection selon laquelle, pour que l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 soit applicable, il serait nécessaire qu’il existe un lien contractuel entre le fournisseur d’accès à Internet et la personne ayant commis l’atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.
35 En effet, il ne ressort ni du libellé dudit article 8, paragraphe 3, ni d’aucune autre disposition de la directive 2001/29 qu’il serait exigé une relation particulière entre la personne qui porte atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin et l’intermédiaire. En outre, cette exigence ne saurait non plus être déduite des objectifs poursuivis par cette directive étant donné qu’admettre une telle exigence réduirait la protection juridique reconnue aux titulaires de droits en cause, alors que l’objectif de ladite directive, ainsi que cela ressort notamment du considérant 9 de celle-ci, est précisément de leur garantir un niveau élevé de protection.
36 La conclusion à laquelle la Cour est parvenue au point 30 du présent arrêt n’est pas non plus infirmée par l’affirmation selon laquelle, pour obtenir que soit prononcée une injonction à l’encontre d’un fournisseur d’accès à Internet, les titulaires d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin doivent démontrer que certains des clients dudit fournisseur consultent effectivement, sur le site Internet en cause, les objets protégés mis à la disposition du public sans l’accord des titulaires de droits.
37 En effet, la directive 2001/29 exige que les mesures que les États membres ont l’obligation de prendre afin de se conformer à celle-ci aient pour objectifs non seulement de faire cesser les atteintes portées au droit d’auteur ou aux droits voisins, mais également de les prévenir (voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2011, Scarlet Extended, C‑70/10, Rec. p. I-11959, point 31, et du 16 février 2012, SABAM, C‑360/10, non encore publié au Recueil, point 29).
38 Or, un tel effet préventif suppose que les titulaires d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin puissent agir sans devoir établir que les clients d’un fournisseur d’accès à Internet consultent effectivement les objets protégés mis à la disposition du public sans l’accord desdits titulaires.
39 Il en est d’autant plus ainsi que l’existence d’un acte de mise à disposition d’une œuvre au public suppose uniquement que ladite œuvre ait été mise à la disposition du public, sans qu’il soit déterminant que les personnes qui composent ce public aient ou non effectivement eu accès à cette œuvre (voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2006, SGAE, C‑306/05, Rec. p. I-11519, point 43).
40 Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’une personne qui met à la disposition du public sur un site Internet des objets protégés sans l’accord du titulaire de droits, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, utilise les services du fournisseur d’accès à Internet des personnes qui consultent ces objets, lequel doit être considéré comme un intermédiaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.
Sur la deuxième question
41 Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question.
Sur la troisième question
42 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les droits fondamentaux reconnus par le droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’il soit fait interdiction, au moyen d’une injonction prononcée par un juge, à un fournisseur d’accès à Internet d’accorder à ses clients l’accès à un site Internet mettant en ligne des objets protégés sans l’accord des titulaires de droits, lorsque cette injonction ne précise pas quelles mesures ce fournisseur d’accès doit prendre et que ce dernier peut échapper aux astreintes visant à réprimer la violation de ladite injonction en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables.
43 À cet égard, ainsi que cela ressort du considérant 59 de la directive 2001/29, les modalités des injonctions que doivent prévoir les États membres en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de cette directive, telles que celles relatives aux conditions à remplir et à la procédure à suivre, relèvent du droit national.
44 Cela étant, ces règles nationales, de même que leur application par les juridictions nationales, doivent respecter les limitations découlant de la directive 2001/29 ainsi que des sources de droit auxquelles le considérant 3 de celle-ci fait référence (voir, en ce sens, arrêt Scarlet Extended, précité, point 33 et jurisprudence citée).
45 Aux fins d’apprécier la conformité au droit de l’Union d’une injonction, telle que celle en cause au principal, prise sur le fondement de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, il convient donc de tenir notamment compte des exigences résultant de la protection des droits fondamentaux applicables, et ce conformément à l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») (voir, en ce sens, arrêt Scarlet Extended, précité, point 41).
46 La Cour a déjà dit pour droit que, lorsque plusieurs droits fondamentaux sont en conflit, il incombe aux États membres, lors de la transposition d’une directive, de veiller à se fonder sur une interprétation de celle-ci qui permette d’assurer un juste équilibre entre les droits fondamentaux applicables, protégés par l’ordre juridique de l’Union. Puis, lors de la mise en œuvre des mesures de transposition de cette directive, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres non seulement d’interpréter leur droit national d’une manière conforme à ladite directive, mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de celle-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae, C-275/06, Rec. p. I-271, point 68).
47 En l’occurrence, il y a lieu de relever qu’une injonction, telle que celle en cause au principal, prise sur le fondement de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, fait s’opposer, principalement, premièrement, les droits d’auteur et les droits voisins qui font partie du droit de propriété intellectuelle et sont dès lors protégés en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la Charte, deuxièmement, la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs économiques, tels que les fournisseurs d’accès à Internet, en vertu de l’article 16 de la Charte, ainsi que, troisièmement, la liberté d’information des utilisateurs d’Internet, dont la protection est assurée par l’article 11 de la Charte.
48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté.
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.
50 Or, une injonction, telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal.
52 D’une part, une injonction, telle que celle en cause au principal, laisse à son destinataire le soin de déterminer les mesures concrètes à prendre pour atteindre le résultat visé de sorte que celui-ci peut choisir de mettre en place des mesures qui soient les mieux adaptées aux ressources et aux capacités dont il dispose et qui soient compatibles avec les autres obligations et défis auxquels il doit faire face dans l’exercice de son activité.
53 D’autre part, une telle injonction permet à son destinataire de s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables. Or, cette possibilité d’exonération a de toute évidence pour effet que le destinataire de cette injonction ne sera pas tenu de faire des sacrifices insupportables, ce qui paraît justifié notamment au regard du fait que ce dernier n’est pas l’auteur de l’atteinte au droit fondamental de propriété intellectuelle ayant provoqué l’adoption de ladite injonction.
54 À cet égard, conformément au principe de sécurité juridique, le destinataire d’une injonction, telle que celle en cause au principal, doit avoir la possibilité de faire valoir devant le juge, une fois connues les mesures d’exécution qu’il a prises et avant qu’une décision lui imposant une sanction ne soit, le cas échéant, adoptée, que les mesures prises étaient bien celles qui pouvaient être attendues de lui afin d’empêcher le résultat proscrit.
55 Cela étant, lorsque le destinataire d’une injonction, telle que celle en cause au principal, choisit les mesures à adopter afin de s’y conformer, il doit veiller à respecter le droit fondamental des utilisateurs d’Internet à la liberté d’information.
56 À cet égard, les mesures qui sont adoptées par le fournisseur d’accès à Internet doivent être strictement ciblées, en ce sens qu’elles doivent servir à mettre fin à l’atteinte portée par un tiers au droit d’auteur ou à un droit voisin, sans que les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services de ce fournisseur afin d’accéder de façon licite à des informations s’en trouvent affectés. À défaut, l’ingérence dudit fournisseur dans la liberté d’information desdits utilisateurs s’avérerait injustifiée au regard de l’objectif poursuivi.
57 Les juridictions nationales doivent avoir la possibilité de vérifier que tel est le cas. Or, dans la situation d’une injonction, telle que celle en cause au principal, il y a lieu de relever que, si le fournisseur d’accès à Internet adopte des mesures qui lui permettent de réaliser l’interdiction prescrite, les juridictions nationales n’auront pas la possibilité d’effectuer un tel contrôle au stade de la procédure d’exécution, faute de contestation à ce sujet. Par suite, pour que les droits fondamentaux reconnus par le droit de l’Union ne s’opposent pas à l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, il est nécessaire que les règles nationales de procédure prévoient la possibilité pour les internautes de faire valoir leurs droits devant le juge une fois connues les mesures d’exécution prises par le fournisseur d’accès à Internet.
58 En ce qui concerne le droit de propriété intellectuelle, il doit d’emblée être relevé qu’il n’est pas exclu que l’exécution d’une injonction, telle que celle en cause au principal, n’aboutisse pas à un arrêt total des atteintes portées au droit de propriété intellectuelle des personnes intéressées.
59 En effet, d’une part, ainsi qu’il a été constaté, le destinataire d’une telle injonction a la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité et ainsi de ne pas adopter certaines mesures éventuellement réalisables, dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de raisonnables.
60 D’autre part, il n’est pas exclu qu’aucune technique permettant de mettre complètement fin aux atteintes au droit de propriété intellectuelle n’existe ou ne soit en pratique réalisable, ce qui aurait pour conséquence que certaines mesures prises seraient, le cas échéant, contournables d’une manière ou d’une autre.
61 Il y a lieu de relever qu’il ne ressort nullement de l’article 17, paragraphe 2, de la Charte que le droit de propriété intellectuelle soit intangible et que, partant, sa protection doive nécessairement être assurée de manière absolue (voir, en ce sens, arrêt Scarlet Extended, précité, point 43).
62 Cela étant, les mesures qui sont prises par le destinataire d’une injonction, telle que celle en cause au principal, lors de l’exécution de celle-ci, doivent être suffisamment efficaces pour assurer une protection effective du droit fondamental en cause, c’est-à-dire qu’elles doivent avoir pour effet d’empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services du destinataire de cette injonction de consulter ces objets mis à leur disposition en violation dudit droit fondamental.
63 Par conséquent, bien que les mesures prises en exécution d’une injonction, telle que celle en cause au principal, ne soient pas susceptibles d’aboutir, le cas échéant, à un arrêt total des atteintes portées au droit de propriété intellectuelle, elles ne sauraient être considérées pour autant comme incompatibles avec l’exigence d’un juste équilibre à trouver, conformément à l’article 52, paragraphe 1, in fine, de la Charte, entre tous les droits fondamentaux applicables, à condition cependant que, d’une part, elles ne privent pas inutilement les utilisateurs d’Internet de la possibilité d’accéder de façon licite aux informations disponibles et, d’autre part, qu’elles aient pour effet d’empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services du destinataire de cette injonction de consulter ces objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle.
64 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que les droits fondamentaux reconnus par le droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’il soit fait interdiction, au moyen d’une injonction prononcée par un juge, à un fournisseur d’accès à Internet d’accorder à ses clients l’accès à un site Internet mettant en ligne des objets protégés sans l’accord des titulaires de droits, lorsque cette injonction ne précise pas quelles mesures ce fournisseur d’accès doit prendre et que ce dernier peut échapper aux astreintes visant à réprimer la violation de ladite injonction en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables, à condition cependant que, d’une part, les mesures prises ne privent pas inutilement les utilisateurs d’Internet de la possibilité d’accéder de façon licite aux informations disponibles et, d’autre part, que ces mesures aient pour effet d’empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services du destinataire de cette même injonction de consulter ces objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle, ce qu’il appartient aux autorités et aux juridictions nationales de vérifier.
Sur la quatrième question
65 Eu égard à la réponse apportée à la troisième question, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question.
Sur les dépens
66 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
1) L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’une personne qui met à la disposition du public sur un site Internet des objets protégés sans l’accord du titulaire de droits, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, utilise les services du fournisseur d’accès à Internet des personnes qui consultent ces objets, lequel doit être considéré comme un intermédiaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.
2) Les droits fondamentaux reconnus par le droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’il soit fait interdiction, au moyen d’une injonction prononcée par un juge, à un fournisseur d’accès à Internet d’accorder à ses clients l’accès à un site Internet mettant en ligne des objets protégés sans l’accord des titulaires de droits, lorsque cette injonction ne précise pas quelles mesures ce fournisseur d’accès doit prendre et que ce dernier peut échapper aux astreintes visant à réprimer la violation de ladite injonction en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables, à condition cependant que, d’une part, les mesures prises ne privent pas inutilement les utilisateurs d’Internet de la possibilité d’accéder de façon licite aux informations disponibles et, d’autre part, que ces mesures aient pour effet d’empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services du destinataire de cette même injonction de consulter ces objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle, ce qu’il appartient aux autorités et aux juridictions nationales de vérifier.
Signatures

2014

L’absence de vérification du respect de l’obligation de reddition des comptes est une cause de cassation d’un arrêt d’appel pour défaut de motivation
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Par un arrêt du 20/03/2014, la Cour de cassation rappelle que pour motiver correctement ses arrêts, la Cour d’appel doit rappeler en faits et en droit si l’obligation de reddition des comptes à la charge de l’éditeur a bien été respectée.
Ci-dessous l’arrêt en cause :
Cour de cassation – chambre civile 1 – Audience publique du 20 mars 2014 – N° de pourvoi: 12-29940
ECLI:FR:CCASS:2014:C100343 – Non publié au bulletin
Cassation partielle
M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Carbonnier, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Générale européenne de création et de participation (Gecep), dirigée par M. X…, puis, à compter de 1982, la société en participation constituée par cette dernière et les sociétés Edimail, Editions Harlequin et Plon, ont commercialisé en France deux cent cinquante-sept numéros de la série intitulée « l’Exécuteur », créée en 1969 par l’auteur américain Y… ; que M. Gérard Z… a écrit quarante-deux ouvrages de cette série, entre 1983 et 2000, et son fils, M. Philippe Z…, vingt-neuf, entre 1992 et 2005 ; que reprochant à l’éditeur divers manquements contractuels et invoquant la violation de leurs droits patrimoniaux et moraux d’auteur, MM. Gérard et Philippe Z… (les consorts Z…) ont assigné les sociétés Editions Harlequin, Gecep et Editions Gérard X… en résiliation de leurs contrats d’édition et paiement de dommages-intérêts ; que la société Editions Harlequin, pour s’opposer aux demandes de M. Gérard Z…, s’est prévalue du « protocole d’accord » conclu avec ce dernier le 25 octobre 2001, dont l’article 3 dispose que « M. Z… déclare et reconnaît que la société Harlequin n’a manqué à aucune de ses obligations d’éditeur au titre de la publication de la série “ l’Exécuteur “ et s’interdit d’émettre toutes revendication ou réclamation à ce sujet, s’estimant rempli de tous ses droits » ;
Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l’article 1334 du code civil, ensemble les articles 15 et 132 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que la production d’une copie ne saurait suppléer l’original, dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense ;
Attendu que pour dire que l’accord conclu entre la société Harlequin et M. Gérard Z… le 25 octobre 2001 constitue une transaction et déclarer irrecevables tant son action en nullité pour vice du consentement, prescrite, que les demandes de M. Gérard Z… portant sur des faits antérieurs au 25 janvier 2001, l’arrêt, après avoir relevé que celui-ci prétendait que l’article 3, précité, était absent du projet qui lui avait été soumis la veille de la conclusion de l’acte et procédait d’un « trucage » tardivement découvert, énonce qu’il s’abstient de produire le second exemplaire original qui lui a été remis lors de son établissement, ainsi qu’en fait foi la mention portée au pied de l’acte ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les consorts Z… avaient réclamé la production de l’original de l’acte invoqué par la société Editions Harlequin, qui n’en avait produit qu’une copie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le protocole d’accord conclu entre la société Harlequin et M. Gérard Z… le 25 octobre 2001 constitue une transaction, déclare irrecevable, comme prescrite, l’action en nullité pour vice du consentement de cette transaction et, en conséquence, déclare irrecevables les demandes de M. Gérard Z… portant sur des faits antérieurs au 25 janvier 2001, l’arrêt rendu le 1er juillet 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Editions Harlequin aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour les consorts Z…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le protocole d’accord conclu entre la société Harlequin et Gérard Z… le 25 octobre 2001 constitue une transaction, déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité pour vice de consentement de cette transaction et, en conséquence, irrecevables les demandes de Gérard Z… portant sur des faits antérieurs au 25 janvier 2001,
AUX MOTIFS QUE “ Monsieur Gérard Z… poursuit la nullité du protocole d’accord qu’il a signé avec la société Harlequin, le 25 octobre 2001 et dont l’article 3 stipule : “ Monsieur Z… déclare et reconnaît que la société Harlequin n’a manqué à aucune de ses obligations d’éditeur au titre de la publication de la série “ l’Exécuteur “ et s’interdit d’émettre toutes revendication ou réclamation à ce sujet, s’estimant rempli de tous ses droits “ ; Qu’il soutient qu’il a signé ce document dans un contexte qui ne correspond pas aux faits exposés en son préambule (puisque le différend portait sur l’altération de son manuscrit n° 184 de la série l’Exécuteur “ auquel il entendait mettre un terme et que la réception d’un avis à tiers détenteur a été inopinément invoquée par l’éditeur), souligne de multiples anomalies reflétant, selon lui, le comportement frauduleux de ce dernier à son égard, fait valoir qu’il a été établi au seul avantage de la société Harlequin, qui n’était en fait pas le véritable éditeur, et ceci sans contrepartie ; Qu’au moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription qui lui est opposé et qui a été retenu par le tribunal, il fait valoir qu’il n’a découvert la fraude que fin 2008, à la faveur de la communication de ses pièces par son adversaire dans le cadre de la présente instance ; Qu’en réplique, la société Harlequin poursuit la confirmation du jugement qui a considéré que ce protocole était constitutif d’une transaction et oppose à Monsieur Z… une exception de prescription dont le délai a commencé à courir au jour de la signature du protocole ; Qu’elle ajoute que la demande de nullité est infondée, faute d’erreur sur la personne de l’éditeur (Edimail avec qui il a toujours traité n’ayant fait que changer de dénomination sociale en 1987) ou sur son objet (s’agissant de régler la question de voies d’exécution mises en oeuvre par l’administration fiscale et d’accepter un ouvrage trop bref outre la substitution de la personne du père par celle du fils pour le rédiger) et, par ailleurs, en l’absence de manoeuvres frauduleuses qui ne sont que prétendues dès lors, en particulier, qu’il est courant, dans le processus d’élaboration d’une transaction, que des modifications soient apportées au projet initial ; Ceci exposé, que l’ensemble des causes invoquées par Monsieur Z… au soutien de sa demande d’annulation de cette convention, qu’il s’agisse de l’incapacité de l’une des parties, du défaut de concessions réciproques, de l’existence d’une erreur substantielle ou du dol viciant le consentement constituent des cas de violation d’une règle destinée à assurer la protection d’une des parties et s’analysent en des causes de nullité relative ; Qu’en application de l’article 1304 du code civil, le délai de l’action est enfermé dans le délai de cinq ans ; Que vainement Monsieur Z… entend bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de cet article reportant le point de départ du délai de prescription au jour-de la découverte du dol et de l’erreur ; Qu’en effet, il n’est pas contesté que Gérard Z… a signé cette transaction en octobre 2001, quelle que soit la date exacte de sa signature, et qu’il était conseillé depuis août 2001 par un avocat, même s’il n’était pas présent à ses côtés lors de la signature ; Que cette transaction est formulée en termes clairs et dénués d’ambiguïté et que l’appelant a admis dans ses écritures “ que c’est bien à contrecoeur qu’(il) signa le protocole définitif conscient d’avoir été floué par son éditeur “ ; Que s’il prétend, enfin, que l’article 3 sus-reproduit, absent du projet de protocole qui lui avait été soumis la veille de la passation de l’acte, procède d’un “ truquage “ tardivement découvert, il s’abstient de produire le second exemplaire original qui lui a été remis lors de son établissement, ainsi qu’en fait foi la mention portée au pied de d’acte ; Qu’il était, par conséquent, à même de voir sanctionner les vices dont il déclare qu’ils ont affecté son consentement à compter du 25 octobre 2001 en sorte que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir dès cette date ; Qu’excipant de causes de nullité affectant l’acte non contraignant niais contenant une renonciation qui lui est opposé, postérieurement à l’assignation délivrée le 21 janvier 2008, Monsieur Gérard Z… s’est trouvé prescrit en son action ; Que, s’agissant de la portée de ce protocole que Monsieur Gérard Z… entend voir limiter, au seul n° 184 de “ l’Exécuteur “, la généralité des termes de son article 3 repris ci-avant conduit à considérer qu’il n’est pas fondé en sa demande et que ce protocole ne lui permet pas de se prévaloir de manquements de l’éditeur antérieurs à la date du 25 octobre 2001, étant précisé que Philippe Z… est tiers à ladite convention “ (arrêt, p. 6 et 7),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE “ Pour apprécier si la demande en nullité relative du contrat pour vice du consentement est prescrite, il convient tout d’abord de statuer sur la nature de cette convention. En vertu de l’article 2044 du Code civil, une transaction a pour objet de mettre fin à un différend entre les cocontractants. Pour être valable, elle doit contenir des concessions, réciproques, l’absence de transactions ou une transaction dérisoire constituant une renonciation et non une transaction. Les concessions doivent s’apprécier par rapport aux intentions des parties et à ce qu’elles revendiquaient avant la transaction. En l’espèce, par courrier du 27 août 2001, l’avocate de Gérard Z… mettait en demeure les éditions HARLEQUIN de ne pas publier son manuscrit portant sur le numéro 184 de la série « L’exécuteur » en raison de l’absence de signature par son client du contrat d’auteur et du fait que l’éditeur avait opéré des ajouts et modifications de son manuscrit sans son consentement. Par courrier en date du 12 septembre 2001, les éditions HARLEQUIN prenaient acte que Gérard Z… cessait sa collaboration avec la société HUNTER, éditrice de « L’exécuteur » et indiquaient que conformément au souhait de l’auteur, le numéro 184 de la série ne serait pas publié. Par courrier en date du 17 septembre 2001, Gérard Z… exposait que l’impression du numéro 184 avait été lancée sans que le contrat d’édition soit signé et que son manuscrit avait en grande partie été remanié sans son autorisation. Il ressort de ce courrier qu’une réunion devait clarifier la situation et qu’elle porterait aussi la réévaluation de ses droits d’auteur et que l’auteur espérait qu’il n’y aura pas « une rupture dans des conditions préjudiciables pour chacun de nous ». Par courrier du 21 septembre 2001, les éditions HARLEQUIN indiquaient à Gérard Z… que compte tenu de l’absence de signature du contrat d’édition et de son veto pour la mise en vente de ce titre, ils avaient renoncé à sa parution. Il ressort du « protocole d’accord » signé le 25 octobre 2001 entre Gérard Z… et la société HARLEQUIN que suite à un avis à tiers détenteur en date du 30 mars 2001, l’éditeur a indiqué à la Trésorerie de Saint Florent qu’un projet d’édition était en cours avec Gérard Z… qui devrait être rémunéré à hauteur de 65. 000 francs à ce titre, somme qu’elle lui adresserait lorsque le contrat aurait été signé par l’auteur. Aux termes de la convention, ce dernier a contesté cette réponse, estimant qu’à la date de la notification de l’avis à tiers détenteur, la créance de droits d’auteur n’était pas née en l’absence de signature du contrat et que son fils se serait substitué à lui dans la rédaction de l’ouvrage, l’éditeur devait régulariser avec celui-ci un contrat d’auteur. Par ailleurs, Gérard Z… se plaignait de « l’exécution par la société HARLEQUIN de ses obligations d’éditeur pour les numéros passés, tant au titre de son droit moral que de ses droits patrimoniaux. » L’article 1 de la convention contient une déclaration sur l’honneur de Gérard Z… au terme de laquelle il n’a pris aucune part à la rédaction du numéro 184 de la série « L’exécuteur » dont l’auteur est son fils, Philippe Z…. Dans l’article 2, Gérard Z… s’engage à garantir la société HARLEQUIN *si celle-ci se trouvait condamnée à payer les causes de l’avis à tiers détenteur. Enfin, l’article 3 constitue une reconnaissance de Gérard Z… de ce que son éditeur n’a manqué à aucune de ses obligations et qu’il s’interdit d’émettre toute revendication ou réclamation à ce sujet. Aux termes du contrat, il apparaît que la société HARLEQUIN a accepté de substituer Philippe Z… à Gérard Z… pour répondre aux difficultés fiscales que rencontraient Gérard Z…, de sorte qu’elle a bien accepté un changement d’auteur sans être sûre de la réalité et du sérieux du travail de Philippe Z…, ce qui constitue de la part de l’éditeur une concession suffisante. En conséquence, les conditions de validité de la transaction sont remplies au sens de l’article 2044 du Code civil. Cette transaction ne lie que Gérard Z… dont l’ensemble des demandes portant sur des faits antérieurs au 25 octobre 2001 sont irrecevables, sauf si elles portent sur des faits survenus ultérieurement ayant pour cause des contrats d’édition antérieurs à la signature de la transaction “ (jugement, p. 9 à 11),
ALORS QUE la production d’une copie ne saurait suppléer l’original dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense ;
Que, dans leurs conclusions d’appel, les appelants faisaient valoir que le protocole d’accord produit aux débats par les Editions Harlequin constituant un faux, l’acte signé par Monsieur Z… comportant un paragraphe de moins, sommation avait été faite aux Editions Harlequin de produire l’original ;
Que pour rejeter ce moyen, la cour d’appel a considéré que « s’il M. Z… prétend, enfin, que l’article 3 sus-reproduit, absent du projet de protocole qui lui avait été soumis la veille de la passation de l’acte, procède d’un “ truquage “ tardivement découvert, il s’abstient de produire le second exemplaire original qui lui a été remis lors de son établissement, ainsi qu’en fait foi la mention portée au pied de d’acte » ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR limité la réparation des actes de contrefaçon imputables à la société Harlequin SA, en condamnant celle-ci à payer à Monsieur Gérard Z… les sommes de 2. 500 euros et de 3. 000 euros venant réparer l’atteinte portée, respectivement, à ses droits, moral et patrimonial, sur le personnage d’Eva Swanson dont il est le créateur, et à Monsieur Philippe Z… les sommes de 2. 500 euros et de 3. 000 euros venant réparer l’atteinte portée, respectivement, à ses droits, moral et patrimonial, sur le personnage de Frank Vitali dont il est le créateur,
AUX MOTIFS QUE “ la reprise, sans le consentement de leurs auteurs, de ces deux personnages originaux et l’exploitation qui en a été faite dans 17 ouvrages de la série “ l’Exécuteur “ écrits par des tiers à compter de 2005- éléments factuels qui ne sont, au demeurant pas contestés-constituent des actes de contrefaçon dont Messieurs Gérard et Philippe Z… sont fondés à poursuivre la réparation ¿ ; que pour solliciter les sommes de 93. 500 euros (soit 5. 500 x 17) et dé 155. 550 euros (soit 9. 150 x 17) euros venant réparer l’atteinte portée, respectivement, à leurs droits, moral et patrimonial, d’auteurs du fait de la contrefaçon des personnages d’Eva Swanson et de Frank Vitali, les appelants font état du minimum garanti de 9. 151, 13 euros sur leurs droits d’auteur qui leur était consenti pour chacun de leurs ouvrages et de l’incorporation de ces personnages dans 17 romans postérieurement à la cessation de leur collaboration ; Qu’ils ne peuvent, toutefois, raisonnablement prétendre au paiement de l’intégralité des sommes perçues du temps de leur collaboration pour la rédaction d’un ouvrage entier et se prévaloir de l’” omniprésence “ de ces deux personnages dans les 17 romans incriminés alors qu’ils se bornent à souligner leur importance dans l’action de deux seulement des romans de la série, à savoir “ Coïncidences mortelles “ et “ Les vampires de spider mountain “ ; Qu’eu égard à ces éléments, la société Harlequin sera condamnée à verser à chacun une somme de 2. 500 euros venant réparer l’atteinte portée à son droit moral et une somme de 3. 000 euros venant réparer l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux sur l’un et l’autre de ces personnages “ (arrêt, p. 13 et 14),
ALORS QUE dans leurs conclusions d’appel (p. 48 et ss.), Messieurs Z… faisaient valoir que, postérieurement à la cessation de leur collaboration avec l’éditeur, les Editions Harlequin avaient procédé à une contrefaçon en leur empruntant les personnages d’Eva Swanson et de Franck Vitali dans pas moins de treize volumes (et non pas dix-sept) clairement énumérés et régulièrement produits aux débats (pièces 160 et 162 à 173), en donnant en exemple le cas de deux de ces romans ; que l’arrêt attaqué a reconnu que « la reprise, sans le consentement de leurs auteurs, de ces deux personnages originaux et l’exploitation qui en a été faite dans 17 ouvrages de la série “ l’Exécuteur “ écrits par des tiers à compter de 2005- éléments factuels qui ne sont, au demeurant pas contestés-constituent des actes de contrefaçon dont Messieurs Gérard et Philippe Z… sont fondés à poursuivre la réparation » ;
Qu’en limitant cependant la réparation de la contrefaçon pour deux des treize romans contrefaits, la cour d’appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande indemnitaire présentée par Messieurs Z… à l’encontre des Editions Harlequin, en raison des manquements contractuels commis par l’éditeur,
AUX MOTIFS QUE “ pour solliciter la résolution ou la résiliation de leur contrat et l’allocation d’une somme de 30. 000 euros à ce titre, les consorts Z… reprochent à la société Harlequin d’avoir transmis à des tierces personnes le bénéfice des contrats d’édition qu’ils ont signés-pour Gérard Z… du 26 juillet 1983 au 24 octobre 1995, pour Philippe Z… du 26 mars 1992 au 22 janvier 1996- d’avoir ainsi transgressé l’exécution de contrats de nature intuitu personae et de s’être, de plus, montrée défaillante, durant 22 ans dans son obligation de reddition de compte en dépit de leurs demandes récurrentes à ce titre depuis 1986 ; Qu’en réplique, la société Harlequin soutient qu’elle n’a jamais cédé les droits de Messieurs Z… en infraction aux dispositions de l’article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle et que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal qui n’était pas en possession d’informations complètes sur la société en participation et la fusionabsorption intervenue, elle n’a jamais cessé d’exercer son rôle d’éditeur à part entière en rémunérant les auteurs et en assurant l’exploitation et la commercialisation des oeuvres ; ceci exposé, qu’aux termes de l’article L. 132-16 du Code de la propriété intellectuelle “ l’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur “ ; Qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
– que par acte sous seing privé du 24 novembre 1982, la SA Gecep, représentée par Gérard X…, la Librairie Plon, la SA Harlequin et la SA Edimail sont convenues de constituer une société en participation ayant pour objet (article I) l’édition des n° 39 et suivants de la série “ l’Exécuteur “ dont les droits de vente en librairie appartiennent à Edimail, que les associés sont convenus (article H) de poursuivre l’édition de la série en conservant la même présentation de couverture (” Gérard X… présente “), qu’Edimail (article VII) sera chargé du choix des différents collaborateurs extérieurs, de la rédaction des manuscrits et de la réalisation des maquettes et couvertures, Gérard X… devant apporter sa collaboration tant sur le plan éditorial qu’artistique, toutes les décisions y afférent, tout ce qui concerne la politique éditoriale devant être prises d’un commun accord entre Edimail et Gérard X… et qu’Harlequin (articles XIII et XIV), finançant toutes les dépenses entrant dans le cadre de cette participation, devra tenir une comptabilité régulière et établir un compte de résultat, ceux-ci étant contractuellement répartis (article XV) entre les quatre sociétés participantes pièce 6 de l’intimée,
– que selon le numéro du journal d’annonces légale Les Petites affiches du 14 août 1987 l’assemblée générale de la SA Edimail du 20 juin 1987 a approuvé le projet de fusion avec la SA Harlequin, qui s’est trouvée dissoute et a décidé d’adopter la nouvelle dénomination “ Harlequin SA “ ; qu’elle a conservé le même numéro de RCS pièce 189 de l’intimée,
– que par avenant n° 1 au contrat de société en participation du 1 “ janvier 1996, il a été pris acte de ce que la Gecep était substitué à la Librairie Pion ainsi que la fusion-absorption d’Edimail par Harlequin et d’un nouveau partage des résultats entre Harlequin et Gecep,
– que par avenant n° 2 au contrat de société de participation du 26 décembre 2005ont été modifiés les articles X et XIV du contrat portant sur la diffusion et la distribution des ouvrages ainsi que sur les comptes de résultat ;
Qu’étant rappelé que Monsieur Gérard Z… doit se voir opposer les termes du protocole d’accord sus-évoqué, il résulte de la chronologie et de la teneur de ces pièces que la société de participation préexistait à la conclusion des contrats signés avec Philippe Z… et que ce dernier n’est pas fondé à se prévaloir de rétrocessions contrevenant aux dispositions de l’article L. 132-16 visé ci-dessus dès lors qu’il ne démontre pas que la société Edimail, qui a pris le nom d’Harlequin SA à compter de 1981 à la suite de la fusionabsorption de la société Harlequin, a transmis, à titre gratuit ou onéreux ou par voie d’apport à des tiers le bénéfice des contrats d’édition litigieux ; Que, par motifs substitués puisque le tribunal a rejeté la demande indemnitaire au seul motif que Philippe Z… ne pouvait se prévaloir d’un préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire à ce titre “ (arrêt, p. 9 et 10),
ALORS QUE le juge doit répondre à l’ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ;
Que, dans leurs écritures d’appel (p. 10), Messieurs Z… faisaient valoir qu’il résultait de l’avenant n° 2 aux statuts de la société en participation, signé le 26 décembre 2005, que la société Harlequin avait reconnu qu’il y avait eu absorption d’Edimail par Harlequin, et non le contraire ; que devant l’incohérence flagrante entre ce document et la simple photocopie d’une publication dans le journal d’annonces légales, les Petites affiches, faisant état d’une assemblée générale extraordinaire de la SA Edimail du 20 août 1987 ayant approuvé le projet de fusion signé avec la société Harlequin, celle-ci se trouvant dissoute de plein droit du fait de sa fusion avec Edimail, Messieurs Z… en déduisaient la nécessité de produire le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire ;
Qu’en se bornant à énoncer que « selon le numéro du journal d’annonces légale Les Petites affiches du 14 août 1987 l’assemblée générale de la SA Edimail du 20 juin 1987 a approuvé le projet de fusion avec la SA Harlequin, qui s’est trouvée dissoute et a décidé d’adopter la nouvelle dénomination “ Harlequin SA “ », sans répondre au moyen péremptoire de Messieurs Z…, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENCORE, QUE dans leurs écritures d’appel (p. 62 et s., 68 et s.), Messieurs Z… faisaient valoir que, durant 22 ans, les Editions Harlequin avaient été gravement défaillantes dans leur obligation de reddition de comptes aux auteurs malgré leurs demandes récurrentes depuis 1986, si bien qu’il y avait lieu de prononcer la résolution, et subsidiairement la résiliation, de tous les contrats signés entre Messieurs Z… et les Editions Harlequin et de condamner la société Harlequin à leur verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 30. 000 ¿ chacun ;
Qu’après avoir rappelé que « pour solliciter la résolution ou la résiliation de leur contrat et l’allocation d’une somme de 30. 000 euros à ce titre, les consorts Z… reprochent à la société Harlequin ¿ de s’être montrée défaillante, durant 22 ans dans son obligation de reddition de compte en dépit de leurs demandes récurrentes à ce titre depuis 1986 », la cour d’appel s’est bornée à considérer « Que, par motifs substitués puisque le tribunal a rejeté la demande indemnitaire au seul motif que Philippe Z… ne pouvait se prévaloir d’un préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire à ce titre » ;
Qu’en statuant ainsi, sans aucun motif propre concernant la défaillance des Editions Harlequin quant à son obligation de reddition de comptes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 1 juillet 2011