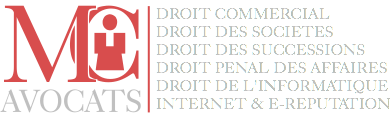2015

Le coût du droit de suite, qui doit être payé à l’auteur lors de toute revente d’une œuvre d’art par un professionnel, peut tout aussi bien être supporté définitivement par le vendeur que par l’acheteur
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Le droit de suite est défini par une directive de l’Union Européenne 2001/84/CE du 27 septembre 2001 et par l’article L.122-8 du Code de la propriété intellectuelle (en droit français) comme le droit pour l’auteur d’une œuvre d’art originale à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession.
L’article L.122-8, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle dispose que le droit de suite est à la charge du vendeur et que la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur.
Dans le cadre de l’organisation de ventes aux enchères d’œuvres d’art organisée par Christie’s France, certaines de ces ventes donnent lieu à la perception d’un droit de suite. Or, les conditions générales de vente de Christie’s France prévoient que, pour certains lots désignés dans son catalogue, cette dernière perçoit de la part de l’acheteur, pour le compte et au nom du vendeur, la somme correspondant au droit de suite.
Le Syndicat National des Antiquaires (SNA) estimant que les conditions générales de Christie’s France constituaient un acte de concurrence déloyale en mettant le droit de suite à la charge de l’acheteur a souhaité poursuivre Christie’s France en justice.
Pour sa part,Christie’s France considère que la Directive européenne 2001/84/CE du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, énonce sans autre précision ou restriction, que le droit de suite est à la charge du vendeur et qu’elle n’exclut donc pas un aménagement conventionnel de la charge du paiement de ce droit.
Saisie de ce litige, la Cour de cassation française demande à la Cour de justice si le vendeur supporte toujours définitivement le coût du droit de suite ou bien s’il est possible de déroger à cette règle par voie conventionnelle.
La CJUE, dans un arrêt C-41/14 « Christie’s France / SNC », répond que si la directive dispose que la personne redevable du droit de suite est en principe le vendeur, elle prévoit néanmoins une dérogation à ce principe et laisse ainsi les États membres libres de définir une autre personne parmi les professionnels visés dans la directive 2001/84.
La personne redevable du droit de suite ainsi désignée par la législation nationale est libre de convenir avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que cette dernière supporte en définitive, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu’un tel arrangement contractuel n’affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur.
En tout état de cause, il convient de bien souligner que Christie’s France avait pris soin de noter que le paiement de la redevance du droit de suite était réglée « au nom et pour le compte du vendeur », instaurant ainsi un mandat afin de paiement, en toute transparence. Il paraît bien évidemment plus prudent de se placer sous la double bannière de cette question préjudicielle à la CJUE et du mandat afin d’être certain de profiter de l’aménagement organisé par la Directive 2001/84/CE.
Enfin, reste à savoir si le législateur profitera d’un nième lifting du CPI pour introduire cette exception au coeur de l’article L.122-8, exception qui semble définitivement acquise.

2014

Droit des brevets : de la contrefaçon à la nullité du brevet pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Agir en contrefaçon contre un concurrent en vertu d’un brevet d’invention n’est pas sans risque : le défendeur dans un procès en contrefaçon a la faculté d’invoquer la nullité du brevet, soit pour défaut de nouveauté, soit pour défaut d’activité inventive. Il convient donc, avant d’agir en justice, de prendre soin d’analyser scrupuleusement les forces en présence, le brevet et ses revendications, la date de sa première mise en oeuvre, ainsi que les modes de divulgation du procédé protégé.
De même, un soin particulier doit être apporté aux opérations de saisie-contrefaçon car la nullité des opérations peut anéantir tout le système de preuve nécessaire à la démonstration de la contrefaçon.
Enfin, la conduite du procès en contrefaçon nécessite une certaine prudence pour ne pas voir la procédure se retourner contre soi alors qu’on était demandeur au départ : le fait d’annoncer à des clients ou des prospects qu’un procès en contrefaçon est en cours contre un concurrent est susceptible d’être qualifié d’acte de concurrence déloyale par dénigrement.
Dans un jugement rendu le 10 octobre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a eu l’occasion de se prononcer, une fois n’est pas coutume : sur la nullité du brevet pour défaut de nouveauté ; sur la nullité d’une saisie contrefaçon pour défaut de signature de la requête par l’avocat de la requérante ; et sur la demande reconventionnelle du défendeur (c’est à dire du prétendu contrefacteur) au titre du dénigrement.
La nullité des opérations de saisie-contrefaçon pour défaut de signature de la requête
Dans cette affaire le Tribunal a retenu que « l’absence de signature de la requête vicie l’ensemble des actes subséquents et le tribunal est compétent pour prononcer la nullité des procès-verbaux des opérations de saisie réalisées (…). »
En effet, les deux requêtes présentées au nom de la société demanderesse n’étaient pas signées : si elles mentionnaient que l’avocat auteur de la requête était l’avocat de la société demanderesse, cette seule mention ne permettaient pas de connaître l’identité et la qualité de la personne ayant effectivement formulé la requête en l’absence de toute signature.
Cette absence de signature de la requête afin de saisie-contrefaçon constitue un vice de fond qui entraîne la nullité de l’acte sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief.
De plus, le Tribunal vient confirmer qu’en matière de saisie-contrefaçon, les dispositions de l’article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile ne font pas obstacle à ce que le juge du fond appréciant la validité des éléments de preuve qui lui sont soumis, puisse annuler des procès-verbaux de saisie pour des motifs tirés des conditions de délivrance de l’ordonnance, outre le fait que la faculté lui en est expressément réservé parle Code de la propriété intellectuelle.
Par conséquent, l’ensemble des demandes fondées sur la contrefaçon du brevet dont la protection était sollicitée reposant uniquement sur les informations et documents obtenus lors des saisies contrefaçon, ont été rejetées par le Tribunal en l’absence de tout élément de preuve valide.
La nullité du brevet pour défaut de nouveauté
Dans cette affaire le Tribunal constate qu’une notice, datée d’avril 2005, publiée sur le site Internet de la société demanderesse, quoique postérieure au dépôt du brevet effectué en juillet 2003, indique néanmoins que depuis dix ans la technologie protégée par le brevet litigieux dans différents marchés… la société demanderesse expose donc sur son site internet qu’elle exploite la technologie de son brevet depuis plus de 7 ans avant que n’en soit déposée la demande de brevet.
C’est l’exemple type du procédé frappé d’un défaut de nouveauté et rendant le brevet nul.
Il convient en effet de rappeler ici que l’INPI n’effectue pas de contrôle a priori sur la validité et la nouveauté du brevet : cette hypothèse est donc beaucoup plus fréquente qu’on ne le pense et c’est la raison pour laquelle il est important de toujours examiner le critère de nouveauté d’un brevet de manière approfondie que l’on soit en défense ou que l’on prévoit d’assigner en contrefaçon.
Le Tribunal conclue donc sa découverte ainsi : « Il ressort ainsi de cette notice datée de 2005 que la société [demanderesse] commercialise un procédé de filtrage avec décolmatage automatique des diatomées par injection d’eau et d’air comprimé depuis 10 ans soit depuis 1995. Ainsi cette notice réalisée par la société [demanderesse] constitue une preuve d’une divulgation du procédé objet de l’invention, antérieure au dépôt du brevet. (…) Ainsi la société [demanderesse] ayant divulgué l’invention telle que présentée dans la revendication n°1 avant d’avoir procédé au dépôt du brevet, celle-ci ne présente pas le caractère nouveau requis par la loi et doit être déclarée nulle.«
En voulant se faire sa publicité, la société demanderesse s’est donc tiré une balle dans le pied.
Le défaut de détachement des revendications du brevet et son effet sur la nullité globale du brevet
Dans cette affaire, le Tribunal va logiquement pousser son raisonnement sur la nullité de la revendication n°1 dudit brevet pour en déduire d’éventuels effets sur les autres revendications.
Le Tribunal constatera que, bien que la demanderesse ait invoqué également les revendications dépendantes 2 et 3, 5 à 9 et 11 à 13 de son brevet FR 2 857 833 et que les défenderesses aient sollicité l’annulation du brevet dans son ensemble, il ne s’est pas instauré de discussion sur la validité des revendications dépendantes, c’est à dire que la société demanderesse n’a pas cherché à défendre les autres revendications de son brevet.
Et le Tribunal en a déduit que la nouveauté et l’activité inventive du brevet étaient uniquement incluses dans la revendication n°1 de telle sorte que l’ensemble des revendications, qui portent sur des aménagements secondaires, ont donc été également annulées.
La contre-attaque du défendeur pour concurrence déloyale par dénigrement
Non contente d’assigner son prétendu contrefacteur en justice, la société demanderesse a cru bon d’indiquer aux clients et prospects commun de son concurrent, qu’elle avait assigné ce dernier en contrefaçon en joignant une copie de son assignation à ses correspondances.
Le Tribunal indique que l’assignation qui jointe aux courriers de la demanderesse, présente de manière partiale les faits reprochés à la société défenderesse et en la joignant aux lettres, la société demanderesse a fait perdre à l’information qu’elle délivrait leur caractère pondéré et strictement nécessaire pour manifestement tenter d’influencer la décision des communes sur l’attribution des marchés (“Nous vous laissons en tirer les conséquences”).
Le Tribunal ne retient pas la faute au titre de l’envoi d’un simple mail d’information, mais bien de la fourniture conjointe de l’assignation qui est un document par définition partial. C’est en cela que la communication va être jugée fautive et que sera reconnu un droit à réparation au profit du concurrent.
L’arroseur devient arrosé.

2014

JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2013
Tribunal de Grande Instance de Paris Read More
2013

Dénigrement par voie de presse et sur internet : la e-reputation en droit des affaires
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Peut-on tout écrire au titre de la liberté d’expression sur un concurrent ou un ex-partenaire commercial sans nuire à sa eReputation ? Quel est la limite à ne pas franchir pour ne pas tomber dans un abus de liberté d’expression ? Enfin, en matière de e-réputation, quels sont les critères permettant de distinguer diffamation et dénigrement ?
Voilà autant de questions auxquelles la Cour de cassation s’attache à répondre en ce moment.
Par un arrêt du 24 septembre 2013, la Cour de cassation avait déjà jugé que toute divulgation critique à l’égard d’un concurrent, même justifiée par la non-conformité d’un produit aux normes françaises ou européennes, est susceptible de constituer un dénigrement (voir notre article du 10 octobre 2013 dernier, à ce sujet).
Cette fois, par un arrêt n° 1354 du 27 novembre 2013 (12-13.897), la Première chambre civile de la Cour de cassation vient apporter un éclairage supplémentaire quant à la notion de dénigrement et les conséquences du dénigrement entre professionnels.
Rappel des faits :
Un agent général d’une société d’assurance manifeste son intention de démissionner de ses fonctions pour transmettre l’exercice de ses mandats à ses deux fils, qu’il employait comme collaborateurs.
La société d’assurance mandante refuse d’agréer la candidature de ses enfants, confie la gestion des portefeuilles à d’autres intermédiaires et elle interrompt les connexions informatiques de l’agent général.
Ce dernier dénonce la situation au moyen d’un “blog”, d’affiches ou d’articles de presse et de lettres circulaires adressées à la clientèle.
Déplorant la publicité négative faite à sa e-réputation, la société d’assurance lui notifie sa révocation avec effet immédiat.
Position de la Cour de cassation :
Rejetant le premier moyen de l’agent général sur la cause de la révocation du mandat d’agence, la Cour de cassation retient que si l’exercice de la liberté d’expression ne constitue pas une faute professionnelle justifiant la révocation d’un agent général d’assurances, c’est sous réserve que cet exercice n’excède pas les limites du droit de critique admissible en regard du devoir de loyauté découlant du mandat d’intérêt commun qui le lie à l’entreprise d’assurances.
Il est vrai que l’agent général n’a pas hésité, dans cette affaire, à conduire une partie de la clientèle, inexactement informée, à résilier ses contrats pour en souscrire d’autres auprès d’entreprises d’assurances concurrentes, par l’intermédiaire du cabinet de courtage géré par son épouse.
Dans ces conditions, la Cour ne pouvait faire autrement que de reconnaitre le dénigrement et les actes de concurrence déloyale.
Mais cet arrêt rappelle également une nouvelle distinction quant à l’action menée en matière de concurrence déloyale et dénigrement, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et l’action en diffamation, fondée, quant elle, sur l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
En effet, la Cour d’appel de Besançon avait relevé que les propos dénigrant l’activité de la société d’assurances avaient jeté le discrédit sur ses produits et services, en incitant une partie de sa clientèle à s’en détourner, ce dont il résultait un abus spécifique de la liberté d’expression.
Cependant, la Cour d’appel avait cru bon de rejeter les demandes de la société d’assurance en soulignant que les abus de la liberté d’expression commis par voie de presse ne relèveraient pas de la responsabilité civile de droit commun et ne pourraient pas être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil, mais sur le fondement de l’article 29 de loi du 29 juillet 1881.
La Cour de cassation vient sanctionner le raisonnement de la Cour d’appel en soulignant que le dénigrement (Art. 1382 du code civil) a vocation à s’appliquer par exception à la diffamation (art. 29 L. 29 juillet 1881), dès lors que propos litigieux avaient pour effet ou pour objet de jeter le discrédit sur les produits et service d’un concurrent en incitant une partie de sa clientèle à s’en détourner.
Ce nouvel arrêt a donc le mérite d’illustrer parfaitement comment définir les contours du dénigrement, en s’affranchissant des règles applicables à la diffamation entre professionnels, dès lors que la publication litigieuse a vocation à détourner la clientèle d’un concurrent ou d’une partenaire.
Par conséquent, dans le cas du dénigrement, l’article 1382 du Code civil s’applique dès lors qu’il y a atteinte à la réputation d’une entreprise par la critique de ses produits ou services (que la critique soit avérée ou infondée) créant ainsi une ambiance de concurrence délétère afin de captation de clientèle.
En revanche, la diffamation porte sur la seule atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne morale et physique, par la publication de propos faisant état de faits matériellement inexacts, et sans qu’il soit nécessaire de poursuivre un but de captation ou de détournement de clientèle.
En d’autres termes, si les propos litigieux sont publiés dans un but de concurrence déloyale et donc de dénigrement, l’entreprise victime de tels agissements peut agir sur le fondement de 1382 du Code civil et s’affranchir notamment du délai de prescription court applicable aux infractions de presse (3 mois à compter du jour de première publication).
A défaut de preuve de la poursuite d’objectifs de concurrence déloyale, les propos relèvent alors de l’article 29 de loi du 29 juillet 1881, à savoir de la diffamation ou de l’injure.

2013

eRéputation & Dénigrement : toute divulgation critique à l’égard d’un concurrent, même justifiée par une non-conformité, est susceptible de constituer un dénigrement
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Par un arrêt du 24 septembre 2013, la Cour de cassation vient de juger que la critique formulée à l’encontre d’un produit ou service d’un concurrent engage la responsabilité de son auteur au titre de concurrence déloyale par dénigrement, peu important que la critique formulée soit fondée et avérée.
La Cour de cassation rappelle en outre que les juges du fond ont tout loisir de prononcer une mesure de publication judiciaire, en sus des dommages-intérêts alloués à la victime, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, si cette mesure étant jugée propre à réparer le préjudice subi par la campagne de dénigrement.
Dans cet arrêt, la Cour estime en effet que la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte.
Les faits de cette jurisprudence sont relativement simples et transposables à toute matière.
Dans le cas d’espèce, une société commercialisant des bouteilles de butane d’un format particulier (190 gr) s’est aperçue que l’un de ses concurrents commercialisait un produit ne répondant pas aux normes en vigueur pour ce type de bouteilles de gaz pour appareils de camping.
Croyant être dans son bon droit, cette société a adressé des courriers à différents distributeurs pour les informer de cette non-conformité.
C’est en cette communication que la Cour de cassation a estimé qu’il y avait dénigrement.
Il est intéressant de noter que l’auteur du dénigrement, dans ses conclusions, expliquait qu’il n’avait pas averti la DGCCRF, au motif : que « l’intervention de cette dernière aurait été différée et partielle » ; et qu’une telle saisine aurait été peu adaptée à la situation, exposant à des sanctions des sociétés qui étaient par ailleurs ses clientes.
On comprend bien ce que voulait indiquer cette société et elle a partiellement raison dans la mesure ou la DGCCRF n’a pas toujours une action aussi coercitive qu’on pourrait le souhaiter.
Malheureusement l’argument apparait toutefois un peu maladroit dans la mesure où il souligne que l’auteur du dénigrement a visé un concurrent d’une attaque tout en protégeant ses propres partenaires.
C’est précisément un des critères d’un comportement déloyal.
Sur la réparation du préjudice, la Cour de cassation nous apporte là aussi un éclairage intéressant.
La défenderesse à la cassation expose que l’octroi et de dommages-intérêts et d’une mesure de publication au profit de la victime et non seulement excessif, mais également qu’une telle publication n’est prévue par aucun texte.
L’argument invoqué fait implicitement référence aux articles L.331-1-4 (en matière de droit d’auteur et bases de données), L.521-8 (en matière de dessins et modèles), L.615-7-1 (en matière de droit des brevets) et L.716-15 (en matière de droit des marques) du Code de la propriété intellectuelle.
En effet, dans ces matières, la réparation / sanction par mesure de publication de la décision de justice ou d’un extrait de celle-ci peut être ordonnée.
L’argument est intelligent : il consiste à soutenir qu’une mesure de publication est une forme de sanction, non prévue par la loi (et notamment une loi pénale, une incrimination), et par conséquent illicite.
Toutefois, la réponse de la Cour à ce moyen n’est pas moins habile.
La réponse de la Cour revient à dire de manière synthétique : non, il ne s’agit pas d’une sanction, mais d’une mesure de réparation décidée souverainement pas les premiers juges.
Il résulte de cette très intéressante jurisprudence que la critique, même objective et avérée, sur un produit ou un service d’un concurrent (frappé de non conformité, voire même d’une autre tare plus grave) est susceptible d’être qualifié d’acte de concurrence déloyale par dénigrement.
L’autre enseignement s’apparente au « retour de bâton » : celui qui a voulu être arroseur, se retrouve arrosé… et dans des proportions bien plus importantes, puisque quelques correspondances privées ont valu à leur malheureux auteur d’être cloué au pilori sur la place publique.
En effet, dans le cas d’espèce pour deux ou trois courriers adressés à des professionnels du secteur, l’auteur du dénigrement voit un extrait du jugement à son encontre publié sur son propre site internet ainsi que dans deux magazines, le tout à ses frais, bien entendu.
La sanction a de quoi faire réfléchir.

2013

Le nom de domaine doit être distinctif pour assurer une protection et le NDD descriptif peut engager la responsabilité de son exploitant
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /C’est l’idée qui ressort des dernières jurisprudences en la matière : un nom de domaine ayant un caractère descriptif ne permet pas à son titulaire d’agir en concurrence déloyale à l’encontre de l’entreprise concurrente qui enregistrera le même nom de domaine ou un nom de domaine proche, même avec la même extension, visant le même territoire (voire la même localité).
Le nom de domaine descriptif ne confère aucun droit d’exclusivité et ne permet pas d’agir en concurrence déloyale
Dans un arrêt du 20 mars 2013, la Cour d’appel de Bastia avait en effet déjà statué sur la question en retenant notamment que « en vertu du principe de la libre concurrence, seul le titulaire d’un nom de domaine distinctif peut en rechercher la protection sur le fondement de l’article 1382 du code civil au titre de la concurrence déloyale, l’enregistrement d’un nom de domaine auprès d’une autorité de nommage ne lui conférant aucun droit privatif ni le bénéfice d’aucun statut juridique propre. En effet, une entreprise ne peut par le biais de son nom de domaine se voir conférer ’un droit quasi exclusif’ d’exercer une activité, même sur un territoire délimité. »
Il s’agissait, en l’espèce, d’un conflit intervenant entre le déposant du nom de domaine « mariagesencorse.com » et la déposante du nom de domaine « mariageencorse.com ».
Le premier déposant, s’imaginant sans doute que le premier arrivé est le premier servi et qu’il est forcément protégé juridiquement, estime être victime d’usurpation de son nom de domaine ’mariagesencorse.com’.
Il demande donc réparation sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, estimant avoir subi une atteinte préjudiciable à son nom de domaine, constitutive de concurrence déloyale et de parasitisme.
Le Tribunal de commerce d’Ajaccio, s’estimant compétent à tort pour juger de ce contentieux en droit des marques (même portant sur la question connexe des actes de concurrence déloyale), donne raison au demandeur.
La Cour d’appel de Bastia retient quant à elle qu’il n’y avait pas de ressemblance entre les deux sites concurrent et que le site « www.mariagesencorse.com est une juxtaposition d’un mot usuel et d’une provenance ou d’un lieu géographique, qui évoque l’objet et le lieu de l’activité de son titulaire sur internet. »
La Cour en déduit très justement que le simple dépôt auprès d’un registrar d’un nom de domaine descriptif ne confère aucun droit, ni aucun monopole à son titulaire, lequel se voit privé, subséquemment, de toute action en concurrence déloyale contre des sites internet ayant la même activités, même sur le même territoire et usant d’un signe descriptif très proche voire identique à titre de nom de domaine.
Le Tribunal de commerce de Paris, par un jugement du 24 mai 2013 a retenu une solution similaire à l’occasion d’un contentieux opposant les titulaires des noms de domaines « e-obseques.fr » et« i-obseques-paris.fr », le premier appartenant à une société privée et son gérant, demandeurs à l’instance, et l’autre à la ville de Paris, défenderesse.
Le Tribunal de commerce, à l’instar de la Cour d’appel de Bastia, retient également que la société privée et son gérant « ne peuvent revendiquer une protection qui aboutirait à leur reconnaitre un monopole d’utilisation d’un terme descriptif », outre le fait que les demandeurs « ne sont pas en mesure d’établir qu’une quelconque confusion soit possible entre le graphisme de leur site et celui de la société ».
Cette idée a d’ailleurs pour origine le fait que pour avoir une marque forte et qui pale d’elle même, il faut choisir un signe lequel, par définition, doit permettre de se distinguer des concurrents et non de se confondre avec.
Les critères permettant d’agir en concurrence déloyale au titre du plagiat d’un site internet
On notera, à ce titre, que ces solutions rejoignent celles déjà adoptées par le Tribunal de grande instance de Paris qui retient usuellement que l’imitation des fonctionnalités et la reproduction quasi-servile des conditions générales d’utilisation d’un site internet sont constitutives d’actes de concurrence déloyale (TGI, 3ème civile, 2ème Section, 15 mars 2013).
La solution de bon sens donne par conséquent une idée précise de ce que doit désormais relever l’exploitant d’un site internet pour poursuivre en concurrence déloyale un site concurrent :
– L’imitation d’un signe distinctif éventuellement déposé à titre de marque, de dénomination sociale et/ou de nom commercial ;
et/ou
– L’imitation d’un graphisme et/ou des fonctionnalités / conditions générales d’utilisation.
Ces critères ne sont pas nécessairement limitatifs, mais en l’absence de contrefaçon d’éléments de propriété intellectuelle, ils doivent servir de référence de base avant d’agir en concurrence déloyale contre un site internet concurrent.
Exploiter un nom de domaine descriptif peut être un acte de concurrence déloyale
Pour aller plus loin, rappelons que la Cour de cassation avait retenu, dans un arrêt du 04 mai 2012, que le fait (pour un avocat) d’enregistrer un signe descriptif à titre de nom de domaine (« avocat-divorce.com », en l’espèce) constituait « une infraction aux règles sur la publicité individuelle, ainsi qu’un acte de concurrence déloyale » (Cass. Civ. 1ère, 4 mai 2012, N° de pourvoi: 11-11180, publié sur Legifrance).
Le problème était par conséquent carrément inversé : c’est le déposant d’un nom de domaine descriptif qui aurait pu être attaqué pour concurrence déloyale par ses concurrents, non titulaires du même nom de domaine.
Certes cette jurisprudence s’applique à une profession réglementée (avocats)… néanmoins, l’argument, souligné par la Cour de cassation, consistant à soutenir qu’il y a concurrence déloyale du fait de l’enregistrement d’un nom de domaine descriptif est, à nos yeux, une invitation à ouvrir droit à poursuites à tout concurrent !
Contrairement à ce qu’on peut écrire faussement certains avocats, il n’est donc surtout pas question de course au référencement : au contraire, les noms de domaines génériques sont susceptibles d’engager la responsabilité de leur déposant et/ou de leur exploitant.
En effet, une telle jurisprudence dénote clairement une hostilité certaine de la haute juridiction à l’égard des signes descriptifs enregistrés à titre de nom de domaine.
Peut être que certains professionnels y verront une opportunité pour faire cesser des agissements de concurrents peu scrupuleux qui achètent des noms de domaines descriptifs à tour de bras pour « occuper l’espace » et acquérir de la visibilité.
Il se pourrait que le mouvement jurisprudentiel de ces derniers mois leur offre, en effet, une voie d’action.
Et ce serait logique puisqu’en droit des marques, tout intéressé peut invoquer à titre de moyen en défense la nullité d’un signe descriptif : il y a donc une certaine logique à neutraliser toute forme de monopole, quel qu’il soit, y compris s’agissant d’un nom de domaine descriptif quant à l’activité auquel il se rapporte.
En sus, cette hostilité rejoint la nouvelle (quoique de moins en moins « nouvelle ») politique de référencement de Google qui ne souhaite plus donner la part belle aux noms de domaine descriptifs, précisément afin d’éviter des abus en matière de référencement.
Il semble donc que l’achat de nom de domaines descriptifs pour être « bien vus » sur le net risque d’être « mal vus », non seulement par Google, mais également désormais, par les juridictions françaises.