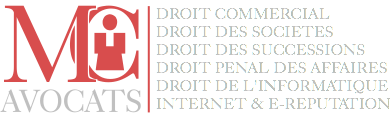2014

Assurance « protection juridique » et « e-réputation » : honoraires de l’avocat pris en charge pour le nettoyage de e-reputation
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Dans de très nombreuses situations, les honoraires de l’avocat peuvent être pris en charge par la garantie « protection juridique » (généralement souscrite avec l’assurance habitation), laquelle couvre des dommages ayant jusqu’à deux ans d’ancienneté.
- Les honoraires de l’avocat peuvent être pris en charge par une « protection juridique » dans le cadre du nettoyage d’une e-réputation
Certains assureurs offrent déjà, depuis quelques temps, des garanties afin de la protection de la e-réputation des particuliers. Ces assurances sont essentiellement tournées vers l’avenir : il n’est en effet question, dans le cadre de ces garanties, de permettre aux particuliers de « nettoyer » les diffamations, injures, atteinte à la vie privée ou usurpation d’identité, qui se produisent de manière postérieure à la date de prise d’effet du contrat d’assurance.
Par conséquent, tout publication litigieuse intervenue avant la mise en place d’une garantie d’assurance de type « e-réputation » ne peut pas être prise en compte : les prestations d’une société de e-réputation (non avocat) sont alors à la charge de l’assuré.
Cependant lorsque l’assuré dispose d’une garantie de type « protection juridique » (le plus souvent offerte avec l’assurance habitation), il ne peut, certes, toujours pas recourir aux services d’une société de e-réputation, mais il peut recourir aux services d’un avocat pour nettoyer sa e-réputation.
En effet, la garantie « protection juridique » couvre tous les faits de moins de deux ans d’ancienneté et qui sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’assuré ou de lui causer un dommage personnel pour lequel il aurait besoin d’être défendu judiciairement. Par conséquent, dans la grande majorité des cas, tout assuré bénéficiant d’une « protection juridique » peut voir les honoraires de l’avocat pris en charge par son assureur.
En cas de doute, l’avocat peut aider à comprendre l’étendue de la garantie « protection juridique » dans le cadre des actions juridiques nécessaires à un premier nettoyage de e-réputation.
Il peut y avoir des cas particuliers et il convient de bien prendre connaissance des termes de la garantie « protection juridique ». L’avocat est précisément là pour guider la victime en l’aidant à bien formuler sa demande auprès de son assureur.
-
L’assurance peut prendre en charge jusqu’à environ 80% des honoraires de l’avocat en e-réputation
La « protection juridique » permet notamment d’indemniser l’assuré si ce denier est obligé de se défendre juridiquement contre un tiers ayant sali son honneur, ou son e-réputation sur internet.
L’indemnisation de l’assuré par son assureur face aux honoraires d’avocat peut monter jusqu’à 2950 EURO par dossier de e-réputation au titre de la garantie « Protection Juridique ».
Le plus souvent, les garanties de type « protection juridique » permettent d’indemniser différents actes juridiques et judiciaires que peut accomplir l’avocat pour obtenir le retrait ou la suppression des contenus publiés sur internet et portant atteinte à la réputation de l’assuré. Parmi ces actes on compte notamment :
- La consultation juridique écrite d’un avocat éventuellement indemnisée selon les polices d’assurance de 200 à 400 EURO ;
- Les honoraires d’intervention pour mise en demeure préalable (phase amiable), indemnisés selon les polices d’assurance à hauteur de 250 à 400 EURO ;
- L’obtention d’une ordonnance du juge (parfois désignée sous le terme générale de « autres juridictions de 1ère instance non expressément prévues »), indemnisée selon les polices d’assurance de 450 à 800 EURO ;
- Les honoraires liés à l’établissement d’une transaction, indemnisés selon les polices d’assurance à hauteur de 800 EURO ;
- Les honoraires liés à la poursuite judiciaire au fond des faits litigieux, indemnisés à hauteur de 600 à 800 EURO en moyenne selon la juridiction saisie.
C’est donc un budget global de 1650€ à 2950€, selon les situations, les procédures engagées et la couverture assurée par la garantie d’assurance qui peut être consacré aux honoraires de l’avocat pour effacer ou supprimer, voire poursuivre l’auteur, des contenus litigieux portant atteinte à la réputation de l’assuré.
Une bonne protection juridique peut couvrir 1100 EURO sur les 1400 EURO de budget d’honoraires de l’avocat pour le nettoyage d’une e-réputation. Il ne resterait donc que 300€ à la charge de l’assuré.
La plupart des dossiers, de notre expérience, ne dépasse pas, en moyenne, et dans des situations communes, un budget de 1400€ comprenant notamment : la consultation préalable de l’avocat ; les notifications de retrait de contenus et les négociations amiables de retrait de contenu(s) ; et une ordonnance du juge afin du retrait des contenus.
-
L’avocat nettoie le net, la société en e-réputation fait du référencement naturel
A la différence de la société de e-réputation qui a un rôle essentiellement technique (de référencement internet), l’avocat peut obtenir du juge des mesures tendant à la suppression de contenus litigieux.
Cependant, en cas d’échec ou d’inefficacité de la ou des procédures mises en œuvre par l’avocat, la garantie « protection juridique » ne permet pas de couvrir les actes accomplis par une société de eréputation spécialisée dans le référencement et la création de contenus internet.
C’est la raison pour laquelle les polices « e-réputation » et « protection juridique » n’offrent pas les mêmes garanties et ne sont pas au même prix.
Attention ! Ce que certaines sociétés de eréputation désignent comme du « nettoyage de e-réputation » consiste en réalité essentiellement à créer des contenus positifs pour la victime et de les référencer au mieux afin de déplacer les résultats négatifs le plus loin possible dans les résultats des moteurs de recherche internet.
De plus, les prestations des sociétés de e-réputation qui incluent également des missions de la gestion de communication de crise, en plus des prestations de création de contenus et profils de réseaux sociaux, sont beaucoup plus chères (et pouvant atteindre 10.000€) que les prestations de l’avocat en e-réputation au titre de la suppression de contenus litigieux.
Il faut donc d’abord passer par un cabinet d’avocat en e-réputation avant d’aller voir une agence commerciale de e-réputation car l’avocat peut dès la première consultation vous indiquer les contenus qui pourront être supprimés et ceux pour lesquels vous risquez d’avoir besoin d’une société de e-réputation.
En conclusion, étant donné les coûts cumulés entre l’intervention de l’avocat en e-réputation et celle d’une société commerciale de gestion de e-réputation, il paraît utile de souscrire une assurance « e-réputation » en sus de la « protection juridique ».
Mais en tout état de cause, une victime bénéficiant d’une protection juridique, n’est pas démunie face à un problème de e-réputation et l’assurance e-réputation n’est pas forcément nécessaire pour entamer les premières démarches, purement juridiques.

2014

Diffamation envers un élu : contrôle de la liberté d’expression dans la critique politique
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Par un arrêt du 08 avril 2014, la Cour de cassation a pu juger qu’une vive critique, qui s’inscrit dans la suite d’un débat sur un sujet d’intérêt général relatif à la politique municipale, dans une localité rurale dépendante de l’économie touristique, ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique, par un administré, de l’action du maire de la commune.
Dans cette affaire, le propriétaire d’une parcelle voisine d’un centre de loisirs et d’une école de pilotage automobile, mécontent de ne pas obtenir l’intervention des autorités municipales pour tenter de mettre un terme aux nuisances sonores qu’il subit, placarde sur une vitre de son véhicule une affichette sur laquelle il avait écrit : « Juin 2010, conseil municipal, Madame le maire, déclare qu’elle ne fera pas appliquer les lois contre les nuisances sonores et si elle le fait ce sera sur tout le village, et cela aura des répercussions économiques. Levier sur le forgeron... ».
Le Maire de cette commune fait citer ledit propriétaire devant le Tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers une personne chargée d’un mandat public, mais Tribunal relaxe le propriétaire.
Sur appel interjeté par Madame le Maire, la Cour d’appel de Nîmes réforme le jugement entrepris, et dit la diffamation caractérisée en refusant au prévenu le bénéfice de la bonne foi aux motifs que :
- elle n’aurait pas à tenir compte des circonstances extrinsèques à l’écrit incriminé dont il résultait que le sujet d’intérêt général traité autorisait les propos et les imputations litigieux ;
- la bonne foi du propriétaire ne peut être retenue en raison du caractère erroné des imputations de l’écrit litigieux dont la preuve de la vérité n’a pu être faite ;
En effet, dans cette affaire, l’élue municipale insistait sur le fait que vivre dans une commune touristique avait des avantages et des inconvénients et que la phrase exacte prononcée était : « s’il faut prendre un arrêté, il sera pris sur toute la commune » mais qu’à aucun moment, elle n’a déclaré qu’elle ne ferait pas appliquer les lois sur les nuisances sonores mais qu’elle a seulement expliqué pour quelle raison elle ne prenait pas d’arrêté municipal sur le cas précis dénoncé par le propriétaire mécontent.
En fondant sa réponse sur l’article 10 de la Déclaration Européenne des Droits de l’Homme, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
La Cour doit se penche ainsi sur droit le plus fondamental des citoyens de critiquer leurs élus qui est en cause et elle rappelle à cet égard que le caractère impérieux de la liberté d’expression ne doit être limité que pour des motifs encore plus impérieux (sécurité nationale, santé, morale, sûreté publique, droits d’autrui, confidentialité, autorité et impartialité de la justice).
La Cour d’appel n’ayant pas constaté une atteinte aux droits de l’élue municipale, la Cour de cassation décide que le propos incriminé, s’inscrivant dans la suite d’un débat d’intérêt général relatif à la politique municipale, dans une localité rurale dépendante de l’économie touristique, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique, par un administré, de l’action du maire de la commune.
Nous voilà rassurés sur notre liberté d’expression contre un maire, élu d’une commune rurale et touristique.
On notera à ce titre que la Cour de cassation a pris soin de souligner avec précision le caractère à la fois rural et touristique de la commune en question. Cela permet de mettre en exergue la contrariété des intérêts en présence et la justification de ce que les administrés, estimant subir des désagréments d’une politique privilégiant – par décision d’opportunité politique – l’un de ces intérêts plutôt que l’autre, puissent s’exprimer librement.
Le fait est que le texte incriminé est critique et même s’il est imprécis quant à la nature des propos tenue par l’élue de cette commune (impliquant le caractère matériellement inexact de l’imputation), ils traduisent bien l’incompréhension d’un administré, sans toutefois que ce message ne porte atteinte à l’honneur de Madame le Maire, contrairement à ce qu’elle a pu soutenir dans ses conclusions d’appel.

2014

le propos incriminé, qui s’inscrivait dans la suite d’un débat sur un sujet d’intérêt général relatif à la politique municipale concernant la mise en oeuvre de la législation sur les nuisances sonores et le respect de l’environnement, dans une localité rurale dépendante de l’économie touristique, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique, par un administré, de l’action du maire de la commune
Arrêt n° 1356 du 8 avril 2014 (12-88.095) - Cour de cassation - Chambre criminelle Read More
2014

il se déduit que les propos litigieux ont été tenus dans des circonstances traduisant une volonté de leur auteur de les rendre publics
Arrêt n° 1352 du 8 avril 2014 (12-87.497) - Cour de cassation - Chambre criminelle Read More
2014

Caractère public des propos injurieux tenus dans une cour d’immeuble accessible au public
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Par un arrêt du 08 avril 2014, la Chambre Criminelle de Cour de cassation nous apporte une précision qui pourrait être importante quant à l’appréciation de la publicité de propos injurieux ou diffamants.
Les faits de cette jurisprudence relèvent que l’auteur des propos incriminés est poursuivi pour avoir tenu à l’un de ses voisins les propos suivants : “sale bougnoule, vous êtes juste tolérés ici”, dans la cour commune de l’immeuble où résident les deux intéressés, en qualité de copropriétaires.
Pour retenir la publicité des propos incriminés, la Cour d’appel retient que « que les propos incriminés, également entendus par l’épouse de M. Y…, ont été proférés dans une cour d’immeuble comportant seize appartements et à laquelle le public a accès« .
On peut à ce titre se demander si c’est l’ouverture au public de la cour de l’immeuble, en principe pourtant privée, qui donne leur caractère public aux propos litigieux… ou si c’est davantage le fait qu’il s’agisse de propos entendus ou potentiellement entendus par les 14 autres occupants de l’immeuble.
Dans le doute, pour rejeter le pourvoi de l’injurieux et raciste personnage, la Cour aura bien fait de retenir les deux paramètres comme un faisceau d’indices : la cour de l’immeuble est ouverte au public ET il y a au moins 14 potentiels personnes de la triste scène.
Nul doute que si la cour de l’immeuble n’avait pas été ouverte au public, le critère de publicité des propos aurait posé davantage de difficultés.
Et, précisément, la Cour de cassation conclut qu’il résulte du fait de s’exprimer ainsi, dans une cour d’immeuble sur laquelle donnent 16 appartement et qui est ouverte au public, une volonté de rendre les propos publics.
Avis donc aux personnes qui postent des contenus sur Facebook à leurs amis et aux amis de leurs amis afin de rendre la plus large possible la diffusion de tout contenu injurieux ou diffamant.

2014

L’absence de vérification du respect de l’obligation de reddition des comptes est une cause de cassation d’un arrêt d’appel pour défaut de motivation
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Par un arrêt du 20/03/2014, la Cour de cassation rappelle que pour motiver correctement ses arrêts, la Cour d’appel doit rappeler en faits et en droit si l’obligation de reddition des comptes à la charge de l’éditeur a bien été respectée.
Ci-dessous l’arrêt en cause :
Cour de cassation – chambre civile 1 – Audience publique du 20 mars 2014 – N° de pourvoi: 12-29940
ECLI:FR:CCASS:2014:C100343 – Non publié au bulletin
Cassation partielle
M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Carbonnier, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Générale européenne de création et de participation (Gecep), dirigée par M. X…, puis, à compter de 1982, la société en participation constituée par cette dernière et les sociétés Edimail, Editions Harlequin et Plon, ont commercialisé en France deux cent cinquante-sept numéros de la série intitulée « l’Exécuteur », créée en 1969 par l’auteur américain Y… ; que M. Gérard Z… a écrit quarante-deux ouvrages de cette série, entre 1983 et 2000, et son fils, M. Philippe Z…, vingt-neuf, entre 1992 et 2005 ; que reprochant à l’éditeur divers manquements contractuels et invoquant la violation de leurs droits patrimoniaux et moraux d’auteur, MM. Gérard et Philippe Z… (les consorts Z…) ont assigné les sociétés Editions Harlequin, Gecep et Editions Gérard X… en résiliation de leurs contrats d’édition et paiement de dommages-intérêts ; que la société Editions Harlequin, pour s’opposer aux demandes de M. Gérard Z…, s’est prévalue du « protocole d’accord » conclu avec ce dernier le 25 octobre 2001, dont l’article 3 dispose que « M. Z… déclare et reconnaît que la société Harlequin n’a manqué à aucune de ses obligations d’éditeur au titre de la publication de la série “ l’Exécuteur “ et s’interdit d’émettre toutes revendication ou réclamation à ce sujet, s’estimant rempli de tous ses droits » ;
Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l’article 1334 du code civil, ensemble les articles 15 et 132 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que la production d’une copie ne saurait suppléer l’original, dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense ;
Attendu que pour dire que l’accord conclu entre la société Harlequin et M. Gérard Z… le 25 octobre 2001 constitue une transaction et déclarer irrecevables tant son action en nullité pour vice du consentement, prescrite, que les demandes de M. Gérard Z… portant sur des faits antérieurs au 25 janvier 2001, l’arrêt, après avoir relevé que celui-ci prétendait que l’article 3, précité, était absent du projet qui lui avait été soumis la veille de la conclusion de l’acte et procédait d’un « trucage » tardivement découvert, énonce qu’il s’abstient de produire le second exemplaire original qui lui a été remis lors de son établissement, ainsi qu’en fait foi la mention portée au pied de l’acte ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les consorts Z… avaient réclamé la production de l’original de l’acte invoqué par la société Editions Harlequin, qui n’en avait produit qu’une copie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le protocole d’accord conclu entre la société Harlequin et M. Gérard Z… le 25 octobre 2001 constitue une transaction, déclare irrecevable, comme prescrite, l’action en nullité pour vice du consentement de cette transaction et, en conséquence, déclare irrecevables les demandes de M. Gérard Z… portant sur des faits antérieurs au 25 janvier 2001, l’arrêt rendu le 1er juillet 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Editions Harlequin aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour les consorts Z…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le protocole d’accord conclu entre la société Harlequin et Gérard Z… le 25 octobre 2001 constitue une transaction, déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité pour vice de consentement de cette transaction et, en conséquence, irrecevables les demandes de Gérard Z… portant sur des faits antérieurs au 25 janvier 2001,
AUX MOTIFS QUE “ Monsieur Gérard Z… poursuit la nullité du protocole d’accord qu’il a signé avec la société Harlequin, le 25 octobre 2001 et dont l’article 3 stipule : “ Monsieur Z… déclare et reconnaît que la société Harlequin n’a manqué à aucune de ses obligations d’éditeur au titre de la publication de la série “ l’Exécuteur “ et s’interdit d’émettre toutes revendication ou réclamation à ce sujet, s’estimant rempli de tous ses droits “ ; Qu’il soutient qu’il a signé ce document dans un contexte qui ne correspond pas aux faits exposés en son préambule (puisque le différend portait sur l’altération de son manuscrit n° 184 de la série l’Exécuteur “ auquel il entendait mettre un terme et que la réception d’un avis à tiers détenteur a été inopinément invoquée par l’éditeur), souligne de multiples anomalies reflétant, selon lui, le comportement frauduleux de ce dernier à son égard, fait valoir qu’il a été établi au seul avantage de la société Harlequin, qui n’était en fait pas le véritable éditeur, et ceci sans contrepartie ; Qu’au moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription qui lui est opposé et qui a été retenu par le tribunal, il fait valoir qu’il n’a découvert la fraude que fin 2008, à la faveur de la communication de ses pièces par son adversaire dans le cadre de la présente instance ; Qu’en réplique, la société Harlequin poursuit la confirmation du jugement qui a considéré que ce protocole était constitutif d’une transaction et oppose à Monsieur Z… une exception de prescription dont le délai a commencé à courir au jour de la signature du protocole ; Qu’elle ajoute que la demande de nullité est infondée, faute d’erreur sur la personne de l’éditeur (Edimail avec qui il a toujours traité n’ayant fait que changer de dénomination sociale en 1987) ou sur son objet (s’agissant de régler la question de voies d’exécution mises en oeuvre par l’administration fiscale et d’accepter un ouvrage trop bref outre la substitution de la personne du père par celle du fils pour le rédiger) et, par ailleurs, en l’absence de manoeuvres frauduleuses qui ne sont que prétendues dès lors, en particulier, qu’il est courant, dans le processus d’élaboration d’une transaction, que des modifications soient apportées au projet initial ; Ceci exposé, que l’ensemble des causes invoquées par Monsieur Z… au soutien de sa demande d’annulation de cette convention, qu’il s’agisse de l’incapacité de l’une des parties, du défaut de concessions réciproques, de l’existence d’une erreur substantielle ou du dol viciant le consentement constituent des cas de violation d’une règle destinée à assurer la protection d’une des parties et s’analysent en des causes de nullité relative ; Qu’en application de l’article 1304 du code civil, le délai de l’action est enfermé dans le délai de cinq ans ; Que vainement Monsieur Z… entend bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de cet article reportant le point de départ du délai de prescription au jour-de la découverte du dol et de l’erreur ; Qu’en effet, il n’est pas contesté que Gérard Z… a signé cette transaction en octobre 2001, quelle que soit la date exacte de sa signature, et qu’il était conseillé depuis août 2001 par un avocat, même s’il n’était pas présent à ses côtés lors de la signature ; Que cette transaction est formulée en termes clairs et dénués d’ambiguïté et que l’appelant a admis dans ses écritures “ que c’est bien à contrecoeur qu’(il) signa le protocole définitif conscient d’avoir été floué par son éditeur “ ; Que s’il prétend, enfin, que l’article 3 sus-reproduit, absent du projet de protocole qui lui avait été soumis la veille de la passation de l’acte, procède d’un “ truquage “ tardivement découvert, il s’abstient de produire le second exemplaire original qui lui a été remis lors de son établissement, ainsi qu’en fait foi la mention portée au pied de d’acte ; Qu’il était, par conséquent, à même de voir sanctionner les vices dont il déclare qu’ils ont affecté son consentement à compter du 25 octobre 2001 en sorte que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir dès cette date ; Qu’excipant de causes de nullité affectant l’acte non contraignant niais contenant une renonciation qui lui est opposé, postérieurement à l’assignation délivrée le 21 janvier 2008, Monsieur Gérard Z… s’est trouvé prescrit en son action ; Que, s’agissant de la portée de ce protocole que Monsieur Gérard Z… entend voir limiter, au seul n° 184 de “ l’Exécuteur “, la généralité des termes de son article 3 repris ci-avant conduit à considérer qu’il n’est pas fondé en sa demande et que ce protocole ne lui permet pas de se prévaloir de manquements de l’éditeur antérieurs à la date du 25 octobre 2001, étant précisé que Philippe Z… est tiers à ladite convention “ (arrêt, p. 6 et 7),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE “ Pour apprécier si la demande en nullité relative du contrat pour vice du consentement est prescrite, il convient tout d’abord de statuer sur la nature de cette convention. En vertu de l’article 2044 du Code civil, une transaction a pour objet de mettre fin à un différend entre les cocontractants. Pour être valable, elle doit contenir des concessions, réciproques, l’absence de transactions ou une transaction dérisoire constituant une renonciation et non une transaction. Les concessions doivent s’apprécier par rapport aux intentions des parties et à ce qu’elles revendiquaient avant la transaction. En l’espèce, par courrier du 27 août 2001, l’avocate de Gérard Z… mettait en demeure les éditions HARLEQUIN de ne pas publier son manuscrit portant sur le numéro 184 de la série « L’exécuteur » en raison de l’absence de signature par son client du contrat d’auteur et du fait que l’éditeur avait opéré des ajouts et modifications de son manuscrit sans son consentement. Par courrier en date du 12 septembre 2001, les éditions HARLEQUIN prenaient acte que Gérard Z… cessait sa collaboration avec la société HUNTER, éditrice de « L’exécuteur » et indiquaient que conformément au souhait de l’auteur, le numéro 184 de la série ne serait pas publié. Par courrier en date du 17 septembre 2001, Gérard Z… exposait que l’impression du numéro 184 avait été lancée sans que le contrat d’édition soit signé et que son manuscrit avait en grande partie été remanié sans son autorisation. Il ressort de ce courrier qu’une réunion devait clarifier la situation et qu’elle porterait aussi la réévaluation de ses droits d’auteur et que l’auteur espérait qu’il n’y aura pas « une rupture dans des conditions préjudiciables pour chacun de nous ». Par courrier du 21 septembre 2001, les éditions HARLEQUIN indiquaient à Gérard Z… que compte tenu de l’absence de signature du contrat d’édition et de son veto pour la mise en vente de ce titre, ils avaient renoncé à sa parution. Il ressort du « protocole d’accord » signé le 25 octobre 2001 entre Gérard Z… et la société HARLEQUIN que suite à un avis à tiers détenteur en date du 30 mars 2001, l’éditeur a indiqué à la Trésorerie de Saint Florent qu’un projet d’édition était en cours avec Gérard Z… qui devrait être rémunéré à hauteur de 65. 000 francs à ce titre, somme qu’elle lui adresserait lorsque le contrat aurait été signé par l’auteur. Aux termes de la convention, ce dernier a contesté cette réponse, estimant qu’à la date de la notification de l’avis à tiers détenteur, la créance de droits d’auteur n’était pas née en l’absence de signature du contrat et que son fils se serait substitué à lui dans la rédaction de l’ouvrage, l’éditeur devait régulariser avec celui-ci un contrat d’auteur. Par ailleurs, Gérard Z… se plaignait de « l’exécution par la société HARLEQUIN de ses obligations d’éditeur pour les numéros passés, tant au titre de son droit moral que de ses droits patrimoniaux. » L’article 1 de la convention contient une déclaration sur l’honneur de Gérard Z… au terme de laquelle il n’a pris aucune part à la rédaction du numéro 184 de la série « L’exécuteur » dont l’auteur est son fils, Philippe Z…. Dans l’article 2, Gérard Z… s’engage à garantir la société HARLEQUIN *si celle-ci se trouvait condamnée à payer les causes de l’avis à tiers détenteur. Enfin, l’article 3 constitue une reconnaissance de Gérard Z… de ce que son éditeur n’a manqué à aucune de ses obligations et qu’il s’interdit d’émettre toute revendication ou réclamation à ce sujet. Aux termes du contrat, il apparaît que la société HARLEQUIN a accepté de substituer Philippe Z… à Gérard Z… pour répondre aux difficultés fiscales que rencontraient Gérard Z…, de sorte qu’elle a bien accepté un changement d’auteur sans être sûre de la réalité et du sérieux du travail de Philippe Z…, ce qui constitue de la part de l’éditeur une concession suffisante. En conséquence, les conditions de validité de la transaction sont remplies au sens de l’article 2044 du Code civil. Cette transaction ne lie que Gérard Z… dont l’ensemble des demandes portant sur des faits antérieurs au 25 octobre 2001 sont irrecevables, sauf si elles portent sur des faits survenus ultérieurement ayant pour cause des contrats d’édition antérieurs à la signature de la transaction “ (jugement, p. 9 à 11),
ALORS QUE la production d’une copie ne saurait suppléer l’original dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense ;
Que, dans leurs conclusions d’appel, les appelants faisaient valoir que le protocole d’accord produit aux débats par les Editions Harlequin constituant un faux, l’acte signé par Monsieur Z… comportant un paragraphe de moins, sommation avait été faite aux Editions Harlequin de produire l’original ;
Que pour rejeter ce moyen, la cour d’appel a considéré que « s’il M. Z… prétend, enfin, que l’article 3 sus-reproduit, absent du projet de protocole qui lui avait été soumis la veille de la passation de l’acte, procède d’un “ truquage “ tardivement découvert, il s’abstient de produire le second exemplaire original qui lui a été remis lors de son établissement, ainsi qu’en fait foi la mention portée au pied de d’acte » ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR limité la réparation des actes de contrefaçon imputables à la société Harlequin SA, en condamnant celle-ci à payer à Monsieur Gérard Z… les sommes de 2. 500 euros et de 3. 000 euros venant réparer l’atteinte portée, respectivement, à ses droits, moral et patrimonial, sur le personnage d’Eva Swanson dont il est le créateur, et à Monsieur Philippe Z… les sommes de 2. 500 euros et de 3. 000 euros venant réparer l’atteinte portée, respectivement, à ses droits, moral et patrimonial, sur le personnage de Frank Vitali dont il est le créateur,
AUX MOTIFS QUE “ la reprise, sans le consentement de leurs auteurs, de ces deux personnages originaux et l’exploitation qui en a été faite dans 17 ouvrages de la série “ l’Exécuteur “ écrits par des tiers à compter de 2005- éléments factuels qui ne sont, au demeurant pas contestés-constituent des actes de contrefaçon dont Messieurs Gérard et Philippe Z… sont fondés à poursuivre la réparation ¿ ; que pour solliciter les sommes de 93. 500 euros (soit 5. 500 x 17) et dé 155. 550 euros (soit 9. 150 x 17) euros venant réparer l’atteinte portée, respectivement, à leurs droits, moral et patrimonial, d’auteurs du fait de la contrefaçon des personnages d’Eva Swanson et de Frank Vitali, les appelants font état du minimum garanti de 9. 151, 13 euros sur leurs droits d’auteur qui leur était consenti pour chacun de leurs ouvrages et de l’incorporation de ces personnages dans 17 romans postérieurement à la cessation de leur collaboration ; Qu’ils ne peuvent, toutefois, raisonnablement prétendre au paiement de l’intégralité des sommes perçues du temps de leur collaboration pour la rédaction d’un ouvrage entier et se prévaloir de l’” omniprésence “ de ces deux personnages dans les 17 romans incriminés alors qu’ils se bornent à souligner leur importance dans l’action de deux seulement des romans de la série, à savoir “ Coïncidences mortelles “ et “ Les vampires de spider mountain “ ; Qu’eu égard à ces éléments, la société Harlequin sera condamnée à verser à chacun une somme de 2. 500 euros venant réparer l’atteinte portée à son droit moral et une somme de 3. 000 euros venant réparer l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux sur l’un et l’autre de ces personnages “ (arrêt, p. 13 et 14),
ALORS QUE dans leurs conclusions d’appel (p. 48 et ss.), Messieurs Z… faisaient valoir que, postérieurement à la cessation de leur collaboration avec l’éditeur, les Editions Harlequin avaient procédé à une contrefaçon en leur empruntant les personnages d’Eva Swanson et de Franck Vitali dans pas moins de treize volumes (et non pas dix-sept) clairement énumérés et régulièrement produits aux débats (pièces 160 et 162 à 173), en donnant en exemple le cas de deux de ces romans ; que l’arrêt attaqué a reconnu que « la reprise, sans le consentement de leurs auteurs, de ces deux personnages originaux et l’exploitation qui en a été faite dans 17 ouvrages de la série “ l’Exécuteur “ écrits par des tiers à compter de 2005- éléments factuels qui ne sont, au demeurant pas contestés-constituent des actes de contrefaçon dont Messieurs Gérard et Philippe Z… sont fondés à poursuivre la réparation » ;
Qu’en limitant cependant la réparation de la contrefaçon pour deux des treize romans contrefaits, la cour d’appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande indemnitaire présentée par Messieurs Z… à l’encontre des Editions Harlequin, en raison des manquements contractuels commis par l’éditeur,
AUX MOTIFS QUE “ pour solliciter la résolution ou la résiliation de leur contrat et l’allocation d’une somme de 30. 000 euros à ce titre, les consorts Z… reprochent à la société Harlequin d’avoir transmis à des tierces personnes le bénéfice des contrats d’édition qu’ils ont signés-pour Gérard Z… du 26 juillet 1983 au 24 octobre 1995, pour Philippe Z… du 26 mars 1992 au 22 janvier 1996- d’avoir ainsi transgressé l’exécution de contrats de nature intuitu personae et de s’être, de plus, montrée défaillante, durant 22 ans dans son obligation de reddition de compte en dépit de leurs demandes récurrentes à ce titre depuis 1986 ; Qu’en réplique, la société Harlequin soutient qu’elle n’a jamais cédé les droits de Messieurs Z… en infraction aux dispositions de l’article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle et que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal qui n’était pas en possession d’informations complètes sur la société en participation et la fusionabsorption intervenue, elle n’a jamais cessé d’exercer son rôle d’éditeur à part entière en rémunérant les auteurs et en assurant l’exploitation et la commercialisation des oeuvres ; ceci exposé, qu’aux termes de l’article L. 132-16 du Code de la propriété intellectuelle “ l’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur “ ; Qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
– que par acte sous seing privé du 24 novembre 1982, la SA Gecep, représentée par Gérard X…, la Librairie Plon, la SA Harlequin et la SA Edimail sont convenues de constituer une société en participation ayant pour objet (article I) l’édition des n° 39 et suivants de la série “ l’Exécuteur “ dont les droits de vente en librairie appartiennent à Edimail, que les associés sont convenus (article H) de poursuivre l’édition de la série en conservant la même présentation de couverture (” Gérard X… présente “), qu’Edimail (article VII) sera chargé du choix des différents collaborateurs extérieurs, de la rédaction des manuscrits et de la réalisation des maquettes et couvertures, Gérard X… devant apporter sa collaboration tant sur le plan éditorial qu’artistique, toutes les décisions y afférent, tout ce qui concerne la politique éditoriale devant être prises d’un commun accord entre Edimail et Gérard X… et qu’Harlequin (articles XIII et XIV), finançant toutes les dépenses entrant dans le cadre de cette participation, devra tenir une comptabilité régulière et établir un compte de résultat, ceux-ci étant contractuellement répartis (article XV) entre les quatre sociétés participantes pièce 6 de l’intimée,
– que selon le numéro du journal d’annonces légale Les Petites affiches du 14 août 1987 l’assemblée générale de la SA Edimail du 20 juin 1987 a approuvé le projet de fusion avec la SA Harlequin, qui s’est trouvée dissoute et a décidé d’adopter la nouvelle dénomination “ Harlequin SA “ ; qu’elle a conservé le même numéro de RCS pièce 189 de l’intimée,
– que par avenant n° 1 au contrat de société en participation du 1 “ janvier 1996, il a été pris acte de ce que la Gecep était substitué à la Librairie Pion ainsi que la fusion-absorption d’Edimail par Harlequin et d’un nouveau partage des résultats entre Harlequin et Gecep,
– que par avenant n° 2 au contrat de société de participation du 26 décembre 2005ont été modifiés les articles X et XIV du contrat portant sur la diffusion et la distribution des ouvrages ainsi que sur les comptes de résultat ;
Qu’étant rappelé que Monsieur Gérard Z… doit se voir opposer les termes du protocole d’accord sus-évoqué, il résulte de la chronologie et de la teneur de ces pièces que la société de participation préexistait à la conclusion des contrats signés avec Philippe Z… et que ce dernier n’est pas fondé à se prévaloir de rétrocessions contrevenant aux dispositions de l’article L. 132-16 visé ci-dessus dès lors qu’il ne démontre pas que la société Edimail, qui a pris le nom d’Harlequin SA à compter de 1981 à la suite de la fusionabsorption de la société Harlequin, a transmis, à titre gratuit ou onéreux ou par voie d’apport à des tiers le bénéfice des contrats d’édition litigieux ; Que, par motifs substitués puisque le tribunal a rejeté la demande indemnitaire au seul motif que Philippe Z… ne pouvait se prévaloir d’un préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire à ce titre “ (arrêt, p. 9 et 10),
ALORS QUE le juge doit répondre à l’ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ;
Que, dans leurs écritures d’appel (p. 10), Messieurs Z… faisaient valoir qu’il résultait de l’avenant n° 2 aux statuts de la société en participation, signé le 26 décembre 2005, que la société Harlequin avait reconnu qu’il y avait eu absorption d’Edimail par Harlequin, et non le contraire ; que devant l’incohérence flagrante entre ce document et la simple photocopie d’une publication dans le journal d’annonces légales, les Petites affiches, faisant état d’une assemblée générale extraordinaire de la SA Edimail du 20 août 1987 ayant approuvé le projet de fusion signé avec la société Harlequin, celle-ci se trouvant dissoute de plein droit du fait de sa fusion avec Edimail, Messieurs Z… en déduisaient la nécessité de produire le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire ;
Qu’en se bornant à énoncer que « selon le numéro du journal d’annonces légale Les Petites affiches du 14 août 1987 l’assemblée générale de la SA Edimail du 20 juin 1987 a approuvé le projet de fusion avec la SA Harlequin, qui s’est trouvée dissoute et a décidé d’adopter la nouvelle dénomination “ Harlequin SA “ », sans répondre au moyen péremptoire de Messieurs Z…, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENCORE, QUE dans leurs écritures d’appel (p. 62 et s., 68 et s.), Messieurs Z… faisaient valoir que, durant 22 ans, les Editions Harlequin avaient été gravement défaillantes dans leur obligation de reddition de comptes aux auteurs malgré leurs demandes récurrentes depuis 1986, si bien qu’il y avait lieu de prononcer la résolution, et subsidiairement la résiliation, de tous les contrats signés entre Messieurs Z… et les Editions Harlequin et de condamner la société Harlequin à leur verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 30. 000 ¿ chacun ;
Qu’après avoir rappelé que « pour solliciter la résolution ou la résiliation de leur contrat et l’allocation d’une somme de 30. 000 euros à ce titre, les consorts Z… reprochent à la société Harlequin ¿ de s’être montrée défaillante, durant 22 ans dans son obligation de reddition de compte en dépit de leurs demandes récurrentes à ce titre depuis 1986 », la cour d’appel s’est bornée à considérer « Que, par motifs substitués puisque le tribunal a rejeté la demande indemnitaire au seul motif que Philippe Z… ne pouvait se prévaloir d’un préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire à ce titre » ;
Qu’en statuant ainsi, sans aucun motif propre concernant la défaillance des Editions Harlequin quant à son obligation de reddition de comptes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 1 juillet 2011

2014

la qualité de fonctionnaire, au sens de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne peut être reconnue à M. X... , chirurgien hospitalier, et que, par ailleurs, au sens de ce dernier texte, il ne peut davantage être considéré comme dépositaire ou agent de l’autorité publique ou bien comme citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public
Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 11 mars 2014 Read More
2014

Faire effacer/supprimer des contenus sur internet : FAQ ereputation
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Un contenu me concernant ou concernant mon entreprise a été posté sur internet : puis-je le faire supprimer ?
La question de l’effacement d’une information, d’une image ou d’une vidéo est directement liée à la qualification du type d’atteinte portée aux droits de la personne visée (qu’elle soit une entreprise ou une personne physique).
Afin de demander une suppression de contenu, il faut prouver qu’un préjudice est subi par la personne estimant être victime de l’indélicate publication internet… et, surtout, il faut démontrer l’abus commis par la personne ayant publié le contenu litigieux.
Sans abus, pas de retrait : c’est la protection de la liberté d’expression qui le veut.
Pour qu’il y ait « atteinte », il faut d’abord que la victime soit nommément citée, identifiée, aisément identifiable ou s’agissant d’une photo ou d’une vidéo aisément reconnaissable.
Lorsque la victime est nommément citée (nom et prénom), la question de l’atteinte ne pose aucune difficulté, étant entendu que la citation du seul prénom de la victime peut, dans certaines circonstances, suffire (personne célèbre ou photos accompagnant commentaire, par exemple).
Lorsque la personne n’est pas clairement nommée, il faut qu’elle soit identifiable (informations relatives à des faits ou une société suffisant à identifier une personne physique, un dirigeant de société, par exemple) ou aisément reconnaissable (photos ou vidéos prises en qualité et distance suffisante pour distinguer les traits du visage ou un élément d’identification caractéristique).
Le critère est alors apprécié souverainement par le juge.
Quels types d’atteintes / de préjudices / d’abus doivent être en jeu pour permettre le retrait d’une publication sur internet ?
L’atteinte doit être caractérisée, d’une part, par un préjudice certain et prouvé, et d’autre part, par un abus commis par la personne ayant posté le message, l’avis, la photo ou la vidéo litigieuse.
Les cas les plus fréquents sont notamment l’injure et la diffamation d’une personne nommément désignée. Le préjudice, dans ce cas, est une publication nuisant à l’honneur et à la considération (préjudice moral). L’abus quant à lui se caractérise par le caractère outrageant de l’injure ou le caractère non prouvé des déclarations faites (ndla : « non prouvé » ne signifie pas forcément que c’est faux, mais qu’il est impossible d’apporter une preuve de vérité).
Viennent ensuite les photos ou vidéos de personne physiques, prises dans l’intimité de leur vie privée (atteinte à l’image de la personne), au rang desquelles l’atteinte la plus fréquente demeure la photographie ou la vidéo prise par un ex et mise en ligne sur internet. Ces contenus sont généralement accompagnés de commentaires incluant le prénom voire le nom de la personne nue y figurant et il n’est donc pas difficile de démontrer le préjudice subi.
L’abus, dans ce deuxième cas de figure, consiste à ne pas avoir reçu d’autorisation préalable afin de la fixation/captation, de l’enregistrement ou de la transmission de l’image d’une personne.
Enfin on trouve, également, des cas de concurrence déloyale (par dénigrement) commis par des concurrents d’une entreprise qui postent, par exemple, des « faux » avis sur des sites permettant de créer des fiches d’évaluation des produits ou services de différents secteurs d’activité.
Ces cas sont toutefois plus rarement prouvé, en raison notamment de la difficulté d’obtenir l’identité de l’auteur des propos dénigrants.
Dois-je nécessairement faire un constat d’huissier ?
Si des poursuites civiles ou pénales sont envisagées, oui, c’est absolument nécessaire.
Avec les échanges de courriels, c’est le seul mode de preuve recevable en justice, les captures d’écrans ou les impressions de pages sur imprimantes ou, pire, dans un fichier PDF n’étant absolument pas considérée comme un mode de preuve recevable devant Cours et Tribunaux.
Ainsi si un retrait est demandé de manière judiciaire, un constat est indispensable et il doit être fait préalablement à toute notification de demande de retrait et/ou à toute saisine du juge.
Le constat d’huissier n’est pas indispensable dans l’unique hypothèse où l’on sait que l’on agira pas contre l’auteur des contenus litigieux et qu’on ne fera pas de demande de suppression de contenu auprès du juge.
Or, il est de plus en plus fréquent de devoir recourir au juge afin d’obtenir le retrait d’information portant atteinte à l’honneur ou à la vie privée / image d’une personne.
Il est donc fortement conseillé de faire réaliser par un huissier un constat reprenant : les constatations de bases des faits, propos et/ou vidéos alléguées (avec des captures d’écran réalisées par l’huissier).
Peut-on saisir immédiatement le juge d’une demande de suppression de contenu ?
En principe, oui, on peut saisir le juge dès qu’un constat d’huissier est réalisé.
La loi dite « LCEN » de 2004 permet en effet de saisir le juge sur requête ou en référé afin de demander toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Cela signifie qu’il est possible, en principe, de demander le retrait d’un commentaire, d’un article de blog, d’un post sur un forum, d’une vidéo ou d’un photo sur tout site ou réseau social, en demandant une simple ordonnance au juge.
Toutefois, en pratique, les juges exigent de manière quasi systématique que la victime (ou son avocat) ait préalablement notifié à l’éditeur ou à l’hébergeur du site internet ou de réseau social concerné une demande de suppression dans les formes et conditions édictées par la loi dite « LCEN ».
Dans quels délais doit-on agir ?
Lorsque les propos publiés sur internet consistent en une provocation à la commission de certains délits, une diffamation ou une injure le délai imposé par le droit de la presse pour agir en responsabilité est très court : il est de trois (3) mois à compter du premier jour de la première publication (mise en ligne ou publication presse) du contenu litigieux.
Dans les autres cas, le délai pour agir varie de 3 à 5 ans à compter de la publication.
Pour demander l’effacement d’une publication, même si cette publication relève du régime du droit de la presse (délai de 3 mois pour agir en responsabilité), la LCEN ne précise pas qu’il faille être dans le délai de 3 mois.
Toutefois, en pratique, de nombreux magistrats exigent, pour protéger la liberté d’expression, qu’on soit toujours dans le délai de 3 mois, même pour faire jouer une simple demande de suppression de contenu.
A mon sens, cette exigence des magistrats est excessive, notamment au regard de la spécificité d’internet (ndla : cf. le fait que « n’importe qui » peut publier dans l’anonymat, ce qui n’est pas du tout le cas des organes de presse soumis à une responsabilité en cascade et à des mesures de publicité obligatoire).
Combien coute une demande de suppression ?
Le coût d’une demande de suppression commence à 80 EURO TTC (hors frais de timbres postaux) en fonction du nombre de publications à supprimer. Et l’enveloppe moyenne, procédure judiciaire de demande de retrait incluse (par voie de requête) se situe aux alentours de 1160 EURO TTC.
Ces montant peuvent varier substantiellement, notamment lorsqu’on doit procéder par voie de requête(s) afin d’ordonnance(s)… en fonction des difficultés rencontrées et du nombre de requêtes que l’avocat est contrait de déposer plusieurs requêtes.
En tout état de cause, de nombreuses assurances couvrant l’habitation ou les locaux professionnels prévoient des polices « assistance juridique/judiciaire » et une partie des frais de l’avocat peuvent être pris en charge par l’assureur (environ 600 EURO TTC pour une procédure de type « référé » ou « autre demande devant le Président du TGI »).
En tout état de cause, il faut savoir que certaines sociétés de droit étranger sont parfois rétives à exécuter une ordonnance du juge rendue sur requête et qu’une seule ordonnance sur requête ne suffit pas toujours pour obtenir l’effacement ou du moins la disparition des informations concernées.
En fin de course, contrairement à ce qu’indique la loi (LCEN), il n’est quasiment jamais possible de demander le bannissement d’une adresse IP, d’une adresse URL ou d’un serveur auprès des opérateurs de téléphonie (ADSL et mobile) pour empêcher l’accès à des informations préjudiciables hébergées à l’étranger, sur des sites qui ne se conforment pas à la réglementation française et aux décisions de justice françaises.
A ce jour seule l’ARJEL dispose d’un tel pouvoir, car il est assorti de l’obligation de payer les frais des opérateurs au titre de telles opérations de bannissement qui ont un coût substantiel.
Il faut savoir enfin que les requêtes afin d’ordonnance ne sont pas contradictoires (il n’y a pas de partie adverse, mais seulement l’avocat de la victime qui présente des demandes au juge).
Par conséquent, certains magistrats sont très prudents (voire un peu trop prudents) quant à l’octroi (ou non) des mesures préventives sollicitées.
Cela produit parfois des situations de déconvenues surprenantes au détriment de certaines victimes.
Un procès peut-il valoir le coup (ou le coût) ?
Une procédure classique (au fond ou en référé) suppose le respect du contradictoire, un calendrier procédural plus long, et l’observation de règles de fond, de forme et de procédure particulières.
Ces procédures sont donc plus longues et plus couteuses en honoraires d’avocat (selon les cas de figure, la complexité de l’affaire et la durée de la procédure).
Dans le cadre d’une procédure contradictoire, à l’inverse des procédures sur requête afin d’ordonnance, le demandeur peut certes solliciter une indemnité au titre de l’article 700 Cpc (au civil) ou de l’article 475-1 du Cpp (au pénal), ce qui correspond notamment aux frais d’avocat liés à la procédure.
Toutefois, la condamnation est souvent symbolique par rapport aux honoraires réellement acquittés à l’avocat, surtout face à un particulier, et à plus forte raison si ce dernier dispose de faibles revenus.
De plus, la capacité de recouvrer les condamnations, y compris les frais de procédure et d’honoraires d’avocat, est souvent très limitée, surtout lorsque l’atteinte est commise par un particulier dont la surface financière est limitée.
Il faut donc avoir de bonnes raisons et notamment une solide envie de faire payer l’autre, quelqu’en soit le prix, car il ne s’agit pas ici de récupérer, comme certaines victimes le croient parfois de copieux dommages intérêts. C’est plus souvent l’inverse qui se produit, sans compter que pour une bête question de preuves ou de procédure, on peut aboutir à une décision déboutant le demandeur…
Cependant, dans le cadre d’une procédure contradictoire, même en référé, les juges accordent des mesures beaucoup plus contraignantes que dans le cadre d’une procédure d’ordonnance sur requête.
Il y a donc, dans certains cas, un intérêt à recourir notamment au référé afin d’obtenir l’effacement des contenus litigieux, sous astreinte, voire avec l’octroi d’une provision sur dommages intérêts. Ce cas de figure se retrouve notamment dans le cas où un éditeur négligeant omet de satisfaire à une notification LCEN éventuellement suivie d’une ordonnance ordonnant la suppression d’une information, d’une photo ou d’une vidéo.
Faut-il recourir aux services d’une société de nettoyage de e-reputation ?
La procédure de suppression des contenus est parfois longue, surtout lorsque les décision obtenues doivent être exécutées par des sociétés de droit étranger.
Pour prendre un exemple, un société de droit américain gérant un gros moteur de recherche peut parfois obtempérer à une demande faite par courrier A.R. après un délai de plus d’un mois et demi. Parfois, c’est plus rapide, mais c’est loin d’être systématique.
Dans d’autres cas la suppression par des voies juridiques n’est tout simplement pas possible (soit parce qu’il n’est pas possible d’identifier l’éditeur du service, soit parce que les fournisseurs d’accès français ne peuvent pas limiter l’accès à un service ou un serveur ou une adresse IP sans porter préjudice à d’autres services ou d’autres contenus non concernés par la demande).
Dans ce cas, des sociétés comme NET OFFENSIVE proposent des solutions pour « nettoyer » ou du moins dissimuler certaines informations dans les résultats des moteurs de recherche.
Dans tous les cas, il faut utiliser les services d’une société de nettoyage de eréputation qui est assistée d’un avocat connaissant bien la matière car, seule, elle ne pourra aucunement obtenir les mesures et les décisions de justice que seul un avocat peut soutenir.

2013

Dénigrement par voie de presse et sur internet : la e-reputation en droit des affaires
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Peut-on tout écrire au titre de la liberté d’expression sur un concurrent ou un ex-partenaire commercial sans nuire à sa eReputation ? Quel est la limite à ne pas franchir pour ne pas tomber dans un abus de liberté d’expression ? Enfin, en matière de e-réputation, quels sont les critères permettant de distinguer diffamation et dénigrement ?
Voilà autant de questions auxquelles la Cour de cassation s’attache à répondre en ce moment.
Par un arrêt du 24 septembre 2013, la Cour de cassation avait déjà jugé que toute divulgation critique à l’égard d’un concurrent, même justifiée par la non-conformité d’un produit aux normes françaises ou européennes, est susceptible de constituer un dénigrement (voir notre article du 10 octobre 2013 dernier, à ce sujet).
Cette fois, par un arrêt n° 1354 du 27 novembre 2013 (12-13.897), la Première chambre civile de la Cour de cassation vient apporter un éclairage supplémentaire quant à la notion de dénigrement et les conséquences du dénigrement entre professionnels.
Rappel des faits :
Un agent général d’une société d’assurance manifeste son intention de démissionner de ses fonctions pour transmettre l’exercice de ses mandats à ses deux fils, qu’il employait comme collaborateurs.
La société d’assurance mandante refuse d’agréer la candidature de ses enfants, confie la gestion des portefeuilles à d’autres intermédiaires et elle interrompt les connexions informatiques de l’agent général.
Ce dernier dénonce la situation au moyen d’un “blog”, d’affiches ou d’articles de presse et de lettres circulaires adressées à la clientèle.
Déplorant la publicité négative faite à sa e-réputation, la société d’assurance lui notifie sa révocation avec effet immédiat.
Position de la Cour de cassation :
Rejetant le premier moyen de l’agent général sur la cause de la révocation du mandat d’agence, la Cour de cassation retient que si l’exercice de la liberté d’expression ne constitue pas une faute professionnelle justifiant la révocation d’un agent général d’assurances, c’est sous réserve que cet exercice n’excède pas les limites du droit de critique admissible en regard du devoir de loyauté découlant du mandat d’intérêt commun qui le lie à l’entreprise d’assurances.
Il est vrai que l’agent général n’a pas hésité, dans cette affaire, à conduire une partie de la clientèle, inexactement informée, à résilier ses contrats pour en souscrire d’autres auprès d’entreprises d’assurances concurrentes, par l’intermédiaire du cabinet de courtage géré par son épouse.
Dans ces conditions, la Cour ne pouvait faire autrement que de reconnaitre le dénigrement et les actes de concurrence déloyale.
Mais cet arrêt rappelle également une nouvelle distinction quant à l’action menée en matière de concurrence déloyale et dénigrement, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et l’action en diffamation, fondée, quant elle, sur l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
En effet, la Cour d’appel de Besançon avait relevé que les propos dénigrant l’activité de la société d’assurances avaient jeté le discrédit sur ses produits et services, en incitant une partie de sa clientèle à s’en détourner, ce dont il résultait un abus spécifique de la liberté d’expression.
Cependant, la Cour d’appel avait cru bon de rejeter les demandes de la société d’assurance en soulignant que les abus de la liberté d’expression commis par voie de presse ne relèveraient pas de la responsabilité civile de droit commun et ne pourraient pas être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil, mais sur le fondement de l’article 29 de loi du 29 juillet 1881.
La Cour de cassation vient sanctionner le raisonnement de la Cour d’appel en soulignant que le dénigrement (Art. 1382 du code civil) a vocation à s’appliquer par exception à la diffamation (art. 29 L. 29 juillet 1881), dès lors que propos litigieux avaient pour effet ou pour objet de jeter le discrédit sur les produits et service d’un concurrent en incitant une partie de sa clientèle à s’en détourner.
Ce nouvel arrêt a donc le mérite d’illustrer parfaitement comment définir les contours du dénigrement, en s’affranchissant des règles applicables à la diffamation entre professionnels, dès lors que la publication litigieuse a vocation à détourner la clientèle d’un concurrent ou d’une partenaire.
Par conséquent, dans le cas du dénigrement, l’article 1382 du Code civil s’applique dès lors qu’il y a atteinte à la réputation d’une entreprise par la critique de ses produits ou services (que la critique soit avérée ou infondée) créant ainsi une ambiance de concurrence délétère afin de captation de clientèle.
En revanche, la diffamation porte sur la seule atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne morale et physique, par la publication de propos faisant état de faits matériellement inexacts, et sans qu’il soit nécessaire de poursuivre un but de captation ou de détournement de clientèle.
En d’autres termes, si les propos litigieux sont publiés dans un but de concurrence déloyale et donc de dénigrement, l’entreprise victime de tels agissements peut agir sur le fondement de 1382 du Code civil et s’affranchir notamment du délai de prescription court applicable aux infractions de presse (3 mois à compter du jour de première publication).
A défaut de preuve de la poursuite d’objectifs de concurrence déloyale, les propos relèvent alors de l’article 29 de loi du 29 juillet 1881, à savoir de la diffamation ou de l’injure.

2013

eRéputation & Dénigrement : toute divulgation critique à l’égard d’un concurrent, même justifiée par une non-conformité, est susceptible de constituer un dénigrement
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Par un arrêt du 24 septembre 2013, la Cour de cassation vient de juger que la critique formulée à l’encontre d’un produit ou service d’un concurrent engage la responsabilité de son auteur au titre de concurrence déloyale par dénigrement, peu important que la critique formulée soit fondée et avérée.
La Cour de cassation rappelle en outre que les juges du fond ont tout loisir de prononcer une mesure de publication judiciaire, en sus des dommages-intérêts alloués à la victime, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, si cette mesure étant jugée propre à réparer le préjudice subi par la campagne de dénigrement.
Dans cet arrêt, la Cour estime en effet que la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte.
Les faits de cette jurisprudence sont relativement simples et transposables à toute matière.
Dans le cas d’espèce, une société commercialisant des bouteilles de butane d’un format particulier (190 gr) s’est aperçue que l’un de ses concurrents commercialisait un produit ne répondant pas aux normes en vigueur pour ce type de bouteilles de gaz pour appareils de camping.
Croyant être dans son bon droit, cette société a adressé des courriers à différents distributeurs pour les informer de cette non-conformité.
C’est en cette communication que la Cour de cassation a estimé qu’il y avait dénigrement.
Il est intéressant de noter que l’auteur du dénigrement, dans ses conclusions, expliquait qu’il n’avait pas averti la DGCCRF, au motif : que « l’intervention de cette dernière aurait été différée et partielle » ; et qu’une telle saisine aurait été peu adaptée à la situation, exposant à des sanctions des sociétés qui étaient par ailleurs ses clientes.
On comprend bien ce que voulait indiquer cette société et elle a partiellement raison dans la mesure ou la DGCCRF n’a pas toujours une action aussi coercitive qu’on pourrait le souhaiter.
Malheureusement l’argument apparait toutefois un peu maladroit dans la mesure où il souligne que l’auteur du dénigrement a visé un concurrent d’une attaque tout en protégeant ses propres partenaires.
C’est précisément un des critères d’un comportement déloyal.
Sur la réparation du préjudice, la Cour de cassation nous apporte là aussi un éclairage intéressant.
La défenderesse à la cassation expose que l’octroi et de dommages-intérêts et d’une mesure de publication au profit de la victime et non seulement excessif, mais également qu’une telle publication n’est prévue par aucun texte.
L’argument invoqué fait implicitement référence aux articles L.331-1-4 (en matière de droit d’auteur et bases de données), L.521-8 (en matière de dessins et modèles), L.615-7-1 (en matière de droit des brevets) et L.716-15 (en matière de droit des marques) du Code de la propriété intellectuelle.
En effet, dans ces matières, la réparation / sanction par mesure de publication de la décision de justice ou d’un extrait de celle-ci peut être ordonnée.
L’argument est intelligent : il consiste à soutenir qu’une mesure de publication est une forme de sanction, non prévue par la loi (et notamment une loi pénale, une incrimination), et par conséquent illicite.
Toutefois, la réponse de la Cour à ce moyen n’est pas moins habile.
La réponse de la Cour revient à dire de manière synthétique : non, il ne s’agit pas d’une sanction, mais d’une mesure de réparation décidée souverainement pas les premiers juges.
Il résulte de cette très intéressante jurisprudence que la critique, même objective et avérée, sur un produit ou un service d’un concurrent (frappé de non conformité, voire même d’une autre tare plus grave) est susceptible d’être qualifié d’acte de concurrence déloyale par dénigrement.
L’autre enseignement s’apparente au « retour de bâton » : celui qui a voulu être arroseur, se retrouve arrosé… et dans des proportions bien plus importantes, puisque quelques correspondances privées ont valu à leur malheureux auteur d’être cloué au pilori sur la place publique.
En effet, dans le cas d’espèce pour deux ou trois courriers adressés à des professionnels du secteur, l’auteur du dénigrement voit un extrait du jugement à son encontre publié sur son propre site internet ainsi que dans deux magazines, le tout à ses frais, bien entendu.
La sanction a de quoi faire réfléchir.