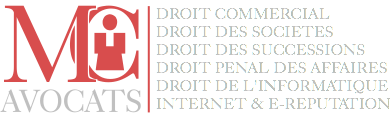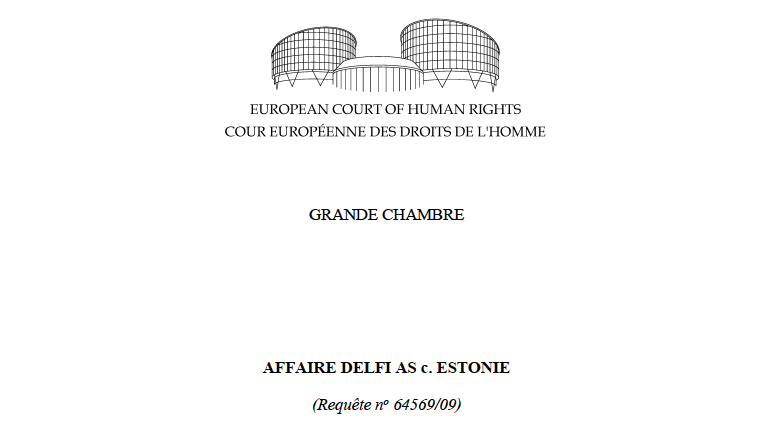2015

E-réputation : 4 leçons à retenir concernant le nettoyage judiciaire d’avis négatifs pour 2015/2016
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Toutes les entreprises sont visées par des avis négatifs sur internet, et pas seulement les hôtels qui sont en outre confrontés à des avis de clients effectifs, sur des portails tels que Hotels.com, Booking ou Tripadvisor, à l’inverse de nombreux autres sites hébergeant des avis d’internautes. Ces avis sont pourtant souvent moins contrôlés, excessifs voire parfois totalement diffamatoires ou dénigrants pour l’entreprise. Il n’est pas impossible de réagir à et de nettoyer des avis négatifs, mais la tâche est devenue plus difficile en 2015 qu’auparavant : la loi n’a pourtant pas changé ; c’est le contrôle du juge des requêtes qui s’est resserré. Voici les 5 leçons à retenir dans ce nouveau contexte.
1. L’effacement à première demande doit prendre la forme d’une notification LCEN.
Bien entendu, les entreprises peuvent faire le choix de recourir d’abord à une solution amiable, en utilisant les outils de « plainte » ou de « modération » présents sur de nombreux portails, ou en passant par l’administrateur du site, avec des chances de succès parfois très approximatives (mais dans certains cas cela fonctionne, il ne faut donc pas s’en priver) pour demander la suppression de l’avis.
A défaut, il convient avant toute démarche judiciaire, d’adresser une mise en demeure mise en forme selon les prescriptions de l’article 6 de la LCEN. C’est indispensable, et le juge exigera que cette démarche soit accomplie avant qu’on viennent le saisir, car le principe de cet article de loi est que la personne s’estimant victime d’un avis négatif ou d’un faux avis sur internet doit d’abord saisir l’hébergeur d’une demande de retrait de cet avis négatif, de manière formelle.
2. Lors d’une première requête, le juge n’ordonnera l’effacement que des contenus d’une particulière gravité
C’est cela qui a changé : la lecture de l’article 6 de la LCEN permettait, il n’y a pas si longtemps, d’obtenir l’effacement d’un avis négatif dès lors qu’on démontrait le caractère illicite de l’avis négatif litigieux, un préjudice à faire cesser, et le refus de l’hébergeur de supprimer l’avis au mépris de la LCEN.
Aujourd’hui, en remettant la protection de la liberté d’expression en avant, le juge refuse d’effacer un avis négatif, même clairement dénigrant, diffamant ou injurieux, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’auteur du message litigieux n’est pas identifiable.
3. La condition d’effacement des contenus après l’échec d’identification de l’internaute : une procédure plus longue
L’effacement de l’avis négatif pourra donc avoir lieu : sur requête, s’il est rapporté la preuve que l’auteur de l’avis litigieux n’est pas identifiable, ou par voie d’une action au fond (action en diffamation, injure ou responsabilité civile) s’il s’avère qu’une identification a été rendue possible.
Il est bien évident que de soumettre l’effacement d’un avis négatif à la condition que soit rapportée la preuve de l’impossibilité de son identification rallonge considérablement les délais permettant d’introduire une procédure, ce qui a un impact sur le choix du procès au fond à intenter si l’auteur de l’avis négatif est identifié.
4. Pour l’action au fond, préférer l’action en dénigrement à l’action en diffamation
Bien souvent, lorsqu’on obtient l’identification de l’auteur, il est trop tard pour agir sur le terrain du droit de la presse (c’est à dire, essentiellement, pour cause de diffamation ou d’injure, s’agissant d’avis négatifs sur des produits ou services d’entreprises), puisque le délai de prescription n’est que de 3 mois à compter de la première publication du message litigieux.
De plus, l’action en diffamation suppose de rapporter la preuve du caractère erroné / faux du texte de l’avis négatif, de l’atteinte à l’honneur et à la réputation de l’entreprise, tout en s’affranchissant du risque de rapport de preuves de vérité par l’auteur des propos.
A l’inverse, dans un procès en dénigrement, fondé sur l’article 1382 du Code civil, il suffit que l’avis négatif porte atteinte à l’image de l’entreprise, afin de détournement de clientèle, en usant de critiques, mêmes exactes, à l’encontre d’un produit ou service désigné ou identifiable, peu important que le message soit publié par une personne concurrente ou non l’entreprise visée. De plus, l’action en dénigrement se prescrit par 5 ans : elles est donc plus facile à mettre en oeuvre qu’une action en diffamation.

2015

La CEDH valide le principe de responsabilité « LCEN » des hébergeurs pour les avis et commentaires d’internautes
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /La Cour Européenne des Droits de l’Homme, par un arrêt pris en Grande Chambre, en date du 16 juin 2015, a jugé que la loi « SSI » estonienne (loi sur les Services de la Société d’Information) était conforme à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Hommes et des Libertés Fondamentales (CDHLF) sur la liberté d’expression.
Or, la loi « SSI » estonienne, au même titre que la loi « LCEN » française, s’inscrivent dans la droite ligne des directives « SSI » 98/34/CE et « commerce électronique » 200/31/CE, comme le rappelle la Cour Européenne. Ce qui vaut pour la loi estonienne vaut donc pour la loi française.
A ce titre, cet arrêt souligne que les éditeurs de contenus, qui sont aussi hébergeurs de commentaires ou d’avis d’internautes sur ces contenus, ont une responsabilité limitée mais certaine, non seulement quant au prompt retrait des commentaires excessifs dépassant le cadre de la liberté d’expression, et à plus forte raison lorsque ces éditeurs-hébergeurs ne s’assurent pas de moyens réalistes pour tenir les auteurs desdits commentaires / avis responsables de leurs propos.
Pour arriver à cette solution, la Cour souligne bien que la législation estonienne, comme la législation française, met en avant le principe de liberté d’expression et de responsabilité limitée des hébergeurs de contenus, sans aucune obligation de contrôle a priori des informations hébergées.
Principe de liberté d’expression sauvegardé, pas de contrôle a priori, responsabilité limitée des hébergeurs
Dans la législation estonienne, poursuit la Cour dans son analyse, seuls sont susceptibles d’être poursuivies les atteintes à la personnalité, la diffusion d’informations fausses, et la responsabilité pour faute [süü] équivalent de notre article 1382 du Code civil.
Or, c’est exactement le type de législation préconisée par le Conseil de l’Europe dans sa Déclaration sur la liberté de la communication sur l’Internet du 28 mai 2003, texte qui est désormais consacré par l’important arrêt de la CEDH.
En effet, dans la déclaration du 28 mai 2003, le Conseil de l’Europe précise notamment que « Afin d’assurer une protection contre les surveillances en ligne et de favoriser l’expression libre d’informations et d’idées, les États membres devraient respecter la volonté des usagers de l’Internet de ne pas révéler leur identité. Cela n’empêche pas les États membres de prendre des mesures et de coopérer pour retrouver la trace de ceux qui sont responsables d’actes délictueux, conformément à la législation nationale, à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et aux autres traités internationaux dans le domaine de la justice et de la police« .
Que la CNIL se le tienne pour dit, depuis plus de 12 ans : il ne serait pas illégitime de conserver des données sur les utilisateurs de services en lignes, même à titre gratuit, pour leur identification future de l’auteur d’un éventuel délit ou d’une éventuelle atteinte aux droits d’un tiers. Cela n’est toutefois pas prévu (ou du moins pour une durée bien trop limitée) par le cadre légal sur la conservation des données personnelles, telle qu’encadrée par la CNIL dans ses précieuses déclarations CNIL que nous connaissons tous.
Responsabilité en cas de retrait tardif et de défaut de moyen d’identification de(s) (l’) auteur(s) de l’infraction ou de l’atteinte
Quant au contrôle – a posteriori – après signalement d’un contenu illicite, le Conseil de l’Europe détaille les moyens que peuvent employer les éditeurs de contenus qui hébergent également les commentaires ou avis des internautes sous leurs publications.
Enfin, la Cour rappelle les dispositions de la Directive « Services de la société de l’information » 98/34/CE dans la droite ligne de laquelle se situent les législations estoniennes et française.
En conséquence, l’arrêt relève notamment que l’insuffisance des mesures prises par la société d’édition requérante : 1) pour retirer sans délai après leur publication les propos litigieux ; et 2) pour assurer une possibilité réaliste de tenir les auteurs des commentaires pour responsables de leurs propos ; est susceptible d’engager la responsabilité d’un éditeur-hébergeur sans que ce dernier puisse arguer de la violation par la législation de son pays de l’article 10 de la CDHLF.

2015

Arrêt n° 74 du 17 février 2015 (13-88.129) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCASS:2015:CR00074
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/74_17_31161.html Read More
2014

Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2014, 13-84.444, Publié au bulletin
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029765817&fastReqId=1147696876&fastPos=1 Read More
2014

Des actes interruptifs du délai de prescription de trois mois en matière de délits de presse
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /La Cour de cassation vient, de nouveau, par un arrêt du 16 septembre 2014, de préciser les actes judiciaires susceptibles d’interrompre la prescription de trois (3) mois applicable en matière de diffamation en jugeant que seul un acte de poursuite ou un acte d’instruction ou une réquisition d’enquête articulant et qualifiant la diffamation était susceptible d’interrompre le délai de prescription.
Les faits
Mme X…, en conflit avec la famille Y…, occupante d’un logement voisin du sien, publie sur son site internet « conscience-vraie.info » une série de textes et d’images censés décrire, sous la forme d’une “étude de cas”, le comportement agressif de ses voisins, en date du 10 mars 2012.
La procédure
Mme Y… porte plainte en date du 13 mars 2012, des investigations sont effectuées le 16 avril 2012 sur le site « conscience-vraie.info”, et l’audition de Mme X… est organisée le 7 juin 2012. Les juges retiennent que ces éléments d’enquête ont chacun interrompu la prescription de trois mois.
La solution
La Cour de cassation invalide le raisonnement des premiers juges en retenant que la prescription de trois mois d’un délit de diffamation publique, qui court à compter du premier jour de première publication des propos litigieux, ne peut être interrompu que par la mise en oeuvre de l’action publique. A ce titre, ne peut être reconnue comme mise en oeuvre de l’action publique que les actes de poursuites, d’instruction ou de réquisition qualifiant et articulant l’argumentation incriminant les propos litigieux du chef de « diffamation publique« .
Cela signifie que la seule plainte de la victime entre les mains du Procureur de la république (ou de la Police/Gendarmerie) ne suffit en aucun cas à interrompre la prescription de l’action en diffamation. En effet, la victime ne peut assurément pas attendre de se voir ouvert le droit à saisine du Doyen des juges d’instruction par le biais de la constitution de partie civile, puisque par définition, celle-ci ne peut intervenir que : soit après l’avis de classement de la plainte par le Procureur ; soit après un délai de trois (3) mois après le dépôt de plainte initial.
Certes, si l’avis de classement de la plainte intervient rapidement, il est possible de se constituer partie civile entre les mains du Doyen des juges d’instruction. Mais c’est rarement le cas. Et le temps perdu, en cette matière, ne se rattrape que par un acte d’instruction ou de poursuite.
Il s’en suit que le seul mode de mise en oeuvre de l’action publique en matière de diffamation ou d’injure est donc d’agir par voie de citation directe et ce avant qu’un délai de trois mois ne soit intervenu entre la date de publication des contenus litigieux et la date de saisine du Tribunal correctionnel.

2014

L’outrage commis à l’encontre d’agents territoriaux peut être poursuivi par la commune dont ils dépendent
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Dans un récent arrêt du 02 septembre 2014, la Cour de cassation se fonde sur l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 afin de reconnaître à une mairie (Ville de Dijon), le droit d’agir contre l’auteur d’une injure à l’encontre des agents territoriaux (des policiers municipaux) dont elle a la charge d’assurer la protection.
Les faits : le prévenu, un motocycliste mineur, à l’occasion d’un contrôle dont il a fait l’objet par des agents de la police municipale dans un parc de la ville de Dijon, alors qu’il circulait en deux-roues, a invectivé ces derniers en indiquant “vous êtes tous des enculés” (l’histoire ne dit pas si cette phrase était bien orthographiée à l’oral).
La procédure : l’un des policiers et la ville de Dijon ont poursuivi l’auteur de l’outrage en sollicitant réparation pour le préjudice subi. La Cour d’appel de Dijon, confirmant le jugement du Tribunal pour enfants de Dijon, déclare la constitution de partie civile de la ville irrecevable. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la recevabilité d’une telle constitution de partie civile par la une collectivité territoriale.
En effet, au sens de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, la collectivité publique, tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, doit également, selon la Cour de cassation mener toute action visant à réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
Dans cet objectif, la mairie est subrogée aux droits de la victime et elle dispose, à ce titre, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Il convient toutefois de noter que cette action intervient dans le cadre de poursuites pour outrage à agent (articles 433-5 et 433-22 du Code pénal.
Il ne s’agit donc pas d’une action en diffamation ou injure publique dont le sort aurait alors été régi par les articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Il convient de noter à ce titre que les deux infractions d’outrage à agent et d’injure publique commise envers un agent dépositaire de l’autorité publique, n’ont pas du tout les mêmes implications procédurales ni les mêmes sanctions.
Dans le cas de l’outrage à agent dépositaire de l’autorité publique, l’infraction est un délit puni pas six mois d’emprisonnement et un maximum de 7500 EURO d’amende… et surtout, ce délit se prescrit par trois ans, comme tout délit classique.
En revanche, l’action à l’encontre de l’auteur d’un injure publique faite à un élu, un ministre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, telle prévue à l’article 33 de la loi de 1881, se prescrit par trois mois et ne comporte pas de peine de prison : la peine maximum est seulement un amende de 12.000,00 EURO.
Autre subtilité : l’injure publique, au sens de la loi de presse, doit être faite à raison des fonctions de la personnes visée par l’injure… alors que l’outrage à agent pour être reconnu doit avoir été fait dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de la mission de l’agent.
Moralité : même mineur, on ne ne doit pas injurier un agent de police, ni dans la rue, ni sur internet.

2014

Suppression et blocage de contenus sur internet : article 53 de la loi de 1881 (presse) ou article 6 LCEN
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Le Tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en référé, vient de rendre un jugement (source : Legalis.net), par lequel il déboute le Procureur de la République, le CRIF, la LICRA et l’ACIT de leur demande tendant à supprimer l’accès à des sites internet à caractère antisémite.
Il est certes important de protéger la liberté d’expression, en soumettant les procédures pénales, ainsi que les procédures civiles, visant à engager la responsabilité des auteurs des messages incriminés au titre d’une infraction de presse à la rigueur procédurale de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (Cass. ass. plén., 15 février 2013, n°11-14.637).
Et n’apparaît pas forcément illogique le Conseil constitutionnel se soit prononcé en faveur de l’application du formalisme de l’article 53, y compris à l’assignation en référé : toute procédure doit respecter ce formalisme pour valablement limiter la liberté d’expression…
Cependant, cette affaire laisse un arrière goût amer : l’atteinte à l’ordre public perdure en raison d’un mauvais choix procédural certainement motivé par le soucis, infondé, de respecter inutilement le contradictoire : mon affirmation est sérieuse, le procureur a inutilement respecté le contradictoire en assignant la personne soupçonnée d’être l’auteur des propos incriminés.
Pour rentrer dans le détail de l’affaire présentée sur Legalis.net, la demande introduite par le Procureur, le CRIF, la LICRA et l’ACIT était fondée sur l’article 6.1.8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 dite « LCEN » et sur l’article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
L’article 6.I.8 de la LCEN 8. permet à l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou, à défaut, à tout fournisseur d’accès à internet, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
L’article 50-1 la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit que si des publications à caractère antisémite ou raciste constituent un trouble manifestement illicite, l’arrêt du site internet (service de communication au public en ligne) peut être prononcé par le juge des référés, à la demande du ministère public et de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.
Or, une demande tendant à la « fermeture » d’un site publiant des propos à caractère antisémite entre bien dans le cadre d’une procédure tendant à suspendre les effets d’une publication susceptible de porter atteinte aux droits d’un ou plusieurs individus (en l’occurrence de toute une communauté religieuse).
Et, pour suspendre les effets d’une publication reprise sur un site hébergé à l’étranger et peu coopératif avec les autorités françaises, la seule mesure envisageable consiste à bloquer l’accès aux URL concernées, voire l’accès au site entier, voire au(x) serveur(s)… et cela ressort de la compétence technique des fournisseurs d’accès à internet Darty Telecom, Free, SFR, Bouygues Télécom, Orange et Numéricable… raison pour laquelle on voit ces derniers pris dans la « toile » de cette procédure.
En conséquence, le Procureur de la République semblait, en théorie, parfaitement bien fondé à solliciter que soit ordonné le blocage du site litigieux sur le fondement des articles 6.I.8 de la LCEN et 50-1 de la loi de 1881.
Pourtant, le Conseil constitutionnel, saisi par QPC du 20 février 2013 transmise par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision n°2013-311 QPC du 17 mai 2013, notamment au visa (!) de l’arrêt du 15 février 2013 de l’assemblée plénière de la Cour de cassation, avait estimé qu’il n’y aurait pas de contradiction dans les dispositions de l’article 53 de la loi de 1881 et les dispositions gouvernant la procédure de référé en ce que leur combinaison permet un « droit à un recours juridictionnel » dans le cadre de « la protection constitutionnelle de la liberté d’expression » et du « le respect des droits de la défense ».
Et c’est de ces deux décisions de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel que le Tribunal de grande instance de Toulouse tire sa solution, laquelle est indiscutablement bien construite au plan procédural, malheureusement pour le Procureur, le CRIF, la LICRA et l’ACIT qui voient la (potentielle) infraction perdurer malgré la gravité des propos tenus. C’est fort dommage et fort dommageable.
En fait, le Procureur a commis une erreur stratégique : l’article 6.I.8 de la LCEN n’exige pas que les auteurs soient attraits à la cause dans le cadre d’un référé afin de blocage de site internet.
Mais dès lors que le Procureur a fait le choix d’assigner en référé la personne faisant l’objet des poursuites au titre de l’infraction de presse, en plus des fournisseurs d’accès à internet (FAI), il s’est – malgré lui – contraint à devoir respecter le formalisme de l’article 53 de la loi de la presse lequel n’est exigé qu’au bénéfice de la personne poursuivie.
Toutefois, le dispositif de la LCEN permettait au Procureur de ne pas mettre dans la cause la/les personne(s) soupçonnée(s) d’être l(es) auteur(s) des publications incriminées : il pouvait se contenter d’assigner les FAI.
Il convient en effet de rappeler que le dispositif, certes incomplet, de la LCEN de 2004 est de faire face à la spécificité de l’internet afin de permettre, y compris sur requête, l’effacement de contenus publiés par des tiers non identifiés : en effet, sur internet, n’importe qui publie n’importe quoi, en tout anonymat (enfin cela est relatif), et la publication n’a pas de limite de durée ; à l’inverse une parution périodique papier a vocation à l’oubli, il y a une responsabilité en cascade et un directeur de publication aisément identifiable.
Or, en l’espèce, l’affaire en était à l’instruction signifiant par définition l’incertitude d’un lien entre les propos incriminés et la personnes poursuivie objet de l’instruction : on tombe dès lors très précisément dans le cadre de la LCEN ; malgré un soupçon quant à l’identité l’auteur, on agit sur le fondement de la LCEN pour faire effacer ou bloquer les contenus litigieux, sans mettre dans la cause la personne soupçonnée.
Le fait de ne pas avoir à poursuivre l’auteur soupçonné est le contrepoids de la spécificité de l’internet.
La LCEN a donc vocation à faciliter la procédure d’effacement ou de blocage des contenus publiés sur internet pour faire, sous réserve que l’on assigne pas l’auteur soupçonné.
En conséquence, face aux fournisseurs d’accès, pour bloquer le site, sans avoir à respecter l’article 53 de la loi de 1881 le Procureur aurait pu ne pas assigner le (pas encore) prévenu.
Il en est de même, face aux hébergeurs, en matière de nettoyage de e-reputation par voie d’ordonnance sur requête : le respect de l’article 53 ne s’impose pas… cependant, même dans cette matière, il convient de rappeler qu’il convient de motiver les motifs de faits et de droit sur le fondement desquels une mesure de suppression de contenu est sollicitée.
L’exercice en matière de requête afin d’ordonnance n’est pas formel comme dans le cadre de l’application de la procédure du droit de la presse, mais l’idée selon laquelle la motivation en fait et en droit doit être présente et cohérente demeure, afin de ne pas porter une atteinte excessive à la liberté d’expression.

2014

Assurance « protection juridique » et « e-réputation » : honoraires de l’avocat pris en charge pour le nettoyage de e-reputation
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Dans de très nombreuses situations, les honoraires de l’avocat peuvent être pris en charge par la garantie « protection juridique » (généralement souscrite avec l’assurance habitation), laquelle couvre des dommages ayant jusqu’à deux ans d’ancienneté.
- Les honoraires de l’avocat peuvent être pris en charge par une « protection juridique » dans le cadre du nettoyage d’une e-réputation
Certains assureurs offrent déjà, depuis quelques temps, des garanties afin de la protection de la e-réputation des particuliers. Ces assurances sont essentiellement tournées vers l’avenir : il n’est en effet question, dans le cadre de ces garanties, de permettre aux particuliers de « nettoyer » les diffamations, injures, atteinte à la vie privée ou usurpation d’identité, qui se produisent de manière postérieure à la date de prise d’effet du contrat d’assurance.
Par conséquent, tout publication litigieuse intervenue avant la mise en place d’une garantie d’assurance de type « e-réputation » ne peut pas être prise en compte : les prestations d’une société de e-réputation (non avocat) sont alors à la charge de l’assuré.
Cependant lorsque l’assuré dispose d’une garantie de type « protection juridique » (le plus souvent offerte avec l’assurance habitation), il ne peut, certes, toujours pas recourir aux services d’une société de e-réputation, mais il peut recourir aux services d’un avocat pour nettoyer sa e-réputation.
En effet, la garantie « protection juridique » couvre tous les faits de moins de deux ans d’ancienneté et qui sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’assuré ou de lui causer un dommage personnel pour lequel il aurait besoin d’être défendu judiciairement. Par conséquent, dans la grande majorité des cas, tout assuré bénéficiant d’une « protection juridique » peut voir les honoraires de l’avocat pris en charge par son assureur.
En cas de doute, l’avocat peut aider à comprendre l’étendue de la garantie « protection juridique » dans le cadre des actions juridiques nécessaires à un premier nettoyage de e-réputation.
Il peut y avoir des cas particuliers et il convient de bien prendre connaissance des termes de la garantie « protection juridique ». L’avocat est précisément là pour guider la victime en l’aidant à bien formuler sa demande auprès de son assureur.
-
L’assurance peut prendre en charge jusqu’à environ 80% des honoraires de l’avocat en e-réputation
La « protection juridique » permet notamment d’indemniser l’assuré si ce denier est obligé de se défendre juridiquement contre un tiers ayant sali son honneur, ou son e-réputation sur internet.
L’indemnisation de l’assuré par son assureur face aux honoraires d’avocat peut monter jusqu’à 2950 EURO par dossier de e-réputation au titre de la garantie « Protection Juridique ».
Le plus souvent, les garanties de type « protection juridique » permettent d’indemniser différents actes juridiques et judiciaires que peut accomplir l’avocat pour obtenir le retrait ou la suppression des contenus publiés sur internet et portant atteinte à la réputation de l’assuré. Parmi ces actes on compte notamment :
- La consultation juridique écrite d’un avocat éventuellement indemnisée selon les polices d’assurance de 200 à 400 EURO ;
- Les honoraires d’intervention pour mise en demeure préalable (phase amiable), indemnisés selon les polices d’assurance à hauteur de 250 à 400 EURO ;
- L’obtention d’une ordonnance du juge (parfois désignée sous le terme générale de « autres juridictions de 1ère instance non expressément prévues »), indemnisée selon les polices d’assurance de 450 à 800 EURO ;
- Les honoraires liés à l’établissement d’une transaction, indemnisés selon les polices d’assurance à hauteur de 800 EURO ;
- Les honoraires liés à la poursuite judiciaire au fond des faits litigieux, indemnisés à hauteur de 600 à 800 EURO en moyenne selon la juridiction saisie.
C’est donc un budget global de 1650€ à 2950€, selon les situations, les procédures engagées et la couverture assurée par la garantie d’assurance qui peut être consacré aux honoraires de l’avocat pour effacer ou supprimer, voire poursuivre l’auteur, des contenus litigieux portant atteinte à la réputation de l’assuré.
Une bonne protection juridique peut couvrir 1100 EURO sur les 1400 EURO de budget d’honoraires de l’avocat pour le nettoyage d’une e-réputation. Il ne resterait donc que 300€ à la charge de l’assuré.
La plupart des dossiers, de notre expérience, ne dépasse pas, en moyenne, et dans des situations communes, un budget de 1400€ comprenant notamment : la consultation préalable de l’avocat ; les notifications de retrait de contenus et les négociations amiables de retrait de contenu(s) ; et une ordonnance du juge afin du retrait des contenus.
-
L’avocat nettoie le net, la société en e-réputation fait du référencement naturel
A la différence de la société de e-réputation qui a un rôle essentiellement technique (de référencement internet), l’avocat peut obtenir du juge des mesures tendant à la suppression de contenus litigieux.
Cependant, en cas d’échec ou d’inefficacité de la ou des procédures mises en œuvre par l’avocat, la garantie « protection juridique » ne permet pas de couvrir les actes accomplis par une société de eréputation spécialisée dans le référencement et la création de contenus internet.
C’est la raison pour laquelle les polices « e-réputation » et « protection juridique » n’offrent pas les mêmes garanties et ne sont pas au même prix.
Attention ! Ce que certaines sociétés de eréputation désignent comme du « nettoyage de e-réputation » consiste en réalité essentiellement à créer des contenus positifs pour la victime et de les référencer au mieux afin de déplacer les résultats négatifs le plus loin possible dans les résultats des moteurs de recherche internet.
De plus, les prestations des sociétés de e-réputation qui incluent également des missions de la gestion de communication de crise, en plus des prestations de création de contenus et profils de réseaux sociaux, sont beaucoup plus chères (et pouvant atteindre 10.000€) que les prestations de l’avocat en e-réputation au titre de la suppression de contenus litigieux.
Il faut donc d’abord passer par un cabinet d’avocat en e-réputation avant d’aller voir une agence commerciale de e-réputation car l’avocat peut dès la première consultation vous indiquer les contenus qui pourront être supprimés et ceux pour lesquels vous risquez d’avoir besoin d’une société de e-réputation.
En conclusion, étant donné les coûts cumulés entre l’intervention de l’avocat en e-réputation et celle d’une société commerciale de gestion de e-réputation, il paraît utile de souscrire une assurance « e-réputation » en sus de la « protection juridique ».
Mais en tout état de cause, une victime bénéficiant d’une protection juridique, n’est pas démunie face à un problème de e-réputation et l’assurance e-réputation n’est pas forcément nécessaire pour entamer les premières démarches, purement juridiques.

2014

Diffamation envers un élu : contrôle de la liberté d’expression dans la critique politique
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Par un arrêt du 08 avril 2014, la Cour de cassation a pu juger qu’une vive critique, qui s’inscrit dans la suite d’un débat sur un sujet d’intérêt général relatif à la politique municipale, dans une localité rurale dépendante de l’économie touristique, ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique, par un administré, de l’action du maire de la commune.
Dans cette affaire, le propriétaire d’une parcelle voisine d’un centre de loisirs et d’une école de pilotage automobile, mécontent de ne pas obtenir l’intervention des autorités municipales pour tenter de mettre un terme aux nuisances sonores qu’il subit, placarde sur une vitre de son véhicule une affichette sur laquelle il avait écrit : « Juin 2010, conseil municipal, Madame le maire, déclare qu’elle ne fera pas appliquer les lois contre les nuisances sonores et si elle le fait ce sera sur tout le village, et cela aura des répercussions économiques. Levier sur le forgeron... ».
Le Maire de cette commune fait citer ledit propriétaire devant le Tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers une personne chargée d’un mandat public, mais Tribunal relaxe le propriétaire.
Sur appel interjeté par Madame le Maire, la Cour d’appel de Nîmes réforme le jugement entrepris, et dit la diffamation caractérisée en refusant au prévenu le bénéfice de la bonne foi aux motifs que :
- elle n’aurait pas à tenir compte des circonstances extrinsèques à l’écrit incriminé dont il résultait que le sujet d’intérêt général traité autorisait les propos et les imputations litigieux ;
- la bonne foi du propriétaire ne peut être retenue en raison du caractère erroné des imputations de l’écrit litigieux dont la preuve de la vérité n’a pu être faite ;
En effet, dans cette affaire, l’élue municipale insistait sur le fait que vivre dans une commune touristique avait des avantages et des inconvénients et que la phrase exacte prononcée était : « s’il faut prendre un arrêté, il sera pris sur toute la commune » mais qu’à aucun moment, elle n’a déclaré qu’elle ne ferait pas appliquer les lois sur les nuisances sonores mais qu’elle a seulement expliqué pour quelle raison elle ne prenait pas d’arrêté municipal sur le cas précis dénoncé par le propriétaire mécontent.
En fondant sa réponse sur l’article 10 de la Déclaration Européenne des Droits de l’Homme, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
La Cour doit se penche ainsi sur droit le plus fondamental des citoyens de critiquer leurs élus qui est en cause et elle rappelle à cet égard que le caractère impérieux de la liberté d’expression ne doit être limité que pour des motifs encore plus impérieux (sécurité nationale, santé, morale, sûreté publique, droits d’autrui, confidentialité, autorité et impartialité de la justice).
La Cour d’appel n’ayant pas constaté une atteinte aux droits de l’élue municipale, la Cour de cassation décide que le propos incriminé, s’inscrivant dans la suite d’un débat d’intérêt général relatif à la politique municipale, dans une localité rurale dépendante de l’économie touristique, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique, par un administré, de l’action du maire de la commune.
Nous voilà rassurés sur notre liberté d’expression contre un maire, élu d’une commune rurale et touristique.
On notera à ce titre que la Cour de cassation a pris soin de souligner avec précision le caractère à la fois rural et touristique de la commune en question. Cela permet de mettre en exergue la contrariété des intérêts en présence et la justification de ce que les administrés, estimant subir des désagréments d’une politique privilégiant – par décision d’opportunité politique – l’un de ces intérêts plutôt que l’autre, puissent s’exprimer librement.
Le fait est que le texte incriminé est critique et même s’il est imprécis quant à la nature des propos tenue par l’élue de cette commune (impliquant le caractère matériellement inexact de l’imputation), ils traduisent bien l’incompréhension d’un administré, sans toutefois que ce message ne porte atteinte à l’honneur de Madame le Maire, contrairement à ce qu’elle a pu soutenir dans ses conclusions d’appel.

2014

le propos incriminé, qui s’inscrivait dans la suite d’un débat sur un sujet d’intérêt général relatif à la politique municipale concernant la mise en oeuvre de la législation sur les nuisances sonores et le respect de l’environnement, dans une localité rurale dépendante de l’économie touristique, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique, par un administré, de l’action du maire de la commune
Arrêt n° 1356 du 8 avril 2014 (12-88.095) - Cour de cassation - Chambre criminelle Read More