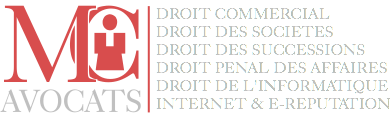2013

Le nom de domaine doit être distinctif pour assurer une protection et le NDD descriptif peut engager la responsabilité de son exploitant
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /C’est l’idée qui ressort des dernières jurisprudences en la matière : un nom de domaine ayant un caractère descriptif ne permet pas à son titulaire d’agir en concurrence déloyale à l’encontre de l’entreprise concurrente qui enregistrera le même nom de domaine ou un nom de domaine proche, même avec la même extension, visant le même territoire (voire la même localité).
Le nom de domaine descriptif ne confère aucun droit d’exclusivité et ne permet pas d’agir en concurrence déloyale
Dans un arrêt du 20 mars 2013, la Cour d’appel de Bastia avait en effet déjà statué sur la question en retenant notamment que « en vertu du principe de la libre concurrence, seul le titulaire d’un nom de domaine distinctif peut en rechercher la protection sur le fondement de l’article 1382 du code civil au titre de la concurrence déloyale, l’enregistrement d’un nom de domaine auprès d’une autorité de nommage ne lui conférant aucun droit privatif ni le bénéfice d’aucun statut juridique propre. En effet, une entreprise ne peut par le biais de son nom de domaine se voir conférer ’un droit quasi exclusif’ d’exercer une activité, même sur un territoire délimité. »
Il s’agissait, en l’espèce, d’un conflit intervenant entre le déposant du nom de domaine « mariagesencorse.com » et la déposante du nom de domaine « mariageencorse.com ».
Le premier déposant, s’imaginant sans doute que le premier arrivé est le premier servi et qu’il est forcément protégé juridiquement, estime être victime d’usurpation de son nom de domaine ’mariagesencorse.com’.
Il demande donc réparation sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, estimant avoir subi une atteinte préjudiciable à son nom de domaine, constitutive de concurrence déloyale et de parasitisme.
Le Tribunal de commerce d’Ajaccio, s’estimant compétent à tort pour juger de ce contentieux en droit des marques (même portant sur la question connexe des actes de concurrence déloyale), donne raison au demandeur.
La Cour d’appel de Bastia retient quant à elle qu’il n’y avait pas de ressemblance entre les deux sites concurrent et que le site « www.mariagesencorse.com est une juxtaposition d’un mot usuel et d’une provenance ou d’un lieu géographique, qui évoque l’objet et le lieu de l’activité de son titulaire sur internet. »
La Cour en déduit très justement que le simple dépôt auprès d’un registrar d’un nom de domaine descriptif ne confère aucun droit, ni aucun monopole à son titulaire, lequel se voit privé, subséquemment, de toute action en concurrence déloyale contre des sites internet ayant la même activités, même sur le même territoire et usant d’un signe descriptif très proche voire identique à titre de nom de domaine.
Le Tribunal de commerce de Paris, par un jugement du 24 mai 2013 a retenu une solution similaire à l’occasion d’un contentieux opposant les titulaires des noms de domaines « e-obseques.fr » et« i-obseques-paris.fr », le premier appartenant à une société privée et son gérant, demandeurs à l’instance, et l’autre à la ville de Paris, défenderesse.
Le Tribunal de commerce, à l’instar de la Cour d’appel de Bastia, retient également que la société privée et son gérant « ne peuvent revendiquer une protection qui aboutirait à leur reconnaitre un monopole d’utilisation d’un terme descriptif », outre le fait que les demandeurs « ne sont pas en mesure d’établir qu’une quelconque confusion soit possible entre le graphisme de leur site et celui de la société ».
Cette idée a d’ailleurs pour origine le fait que pour avoir une marque forte et qui pale d’elle même, il faut choisir un signe lequel, par définition, doit permettre de se distinguer des concurrents et non de se confondre avec.
Les critères permettant d’agir en concurrence déloyale au titre du plagiat d’un site internet
On notera, à ce titre, que ces solutions rejoignent celles déjà adoptées par le Tribunal de grande instance de Paris qui retient usuellement que l’imitation des fonctionnalités et la reproduction quasi-servile des conditions générales d’utilisation d’un site internet sont constitutives d’actes de concurrence déloyale (TGI, 3ème civile, 2ème Section, 15 mars 2013).
La solution de bon sens donne par conséquent une idée précise de ce que doit désormais relever l’exploitant d’un site internet pour poursuivre en concurrence déloyale un site concurrent :
– L’imitation d’un signe distinctif éventuellement déposé à titre de marque, de dénomination sociale et/ou de nom commercial ;
et/ou
– L’imitation d’un graphisme et/ou des fonctionnalités / conditions générales d’utilisation.
Ces critères ne sont pas nécessairement limitatifs, mais en l’absence de contrefaçon d’éléments de propriété intellectuelle, ils doivent servir de référence de base avant d’agir en concurrence déloyale contre un site internet concurrent.
Exploiter un nom de domaine descriptif peut être un acte de concurrence déloyale
Pour aller plus loin, rappelons que la Cour de cassation avait retenu, dans un arrêt du 04 mai 2012, que le fait (pour un avocat) d’enregistrer un signe descriptif à titre de nom de domaine (« avocat-divorce.com », en l’espèce) constituait « une infraction aux règles sur la publicité individuelle, ainsi qu’un acte de concurrence déloyale » (Cass. Civ. 1ère, 4 mai 2012, N° de pourvoi: 11-11180, publié sur Legifrance).
Le problème était par conséquent carrément inversé : c’est le déposant d’un nom de domaine descriptif qui aurait pu être attaqué pour concurrence déloyale par ses concurrents, non titulaires du même nom de domaine.
Certes cette jurisprudence s’applique à une profession réglementée (avocats)… néanmoins, l’argument, souligné par la Cour de cassation, consistant à soutenir qu’il y a concurrence déloyale du fait de l’enregistrement d’un nom de domaine descriptif est, à nos yeux, une invitation à ouvrir droit à poursuites à tout concurrent !
Contrairement à ce qu’on peut écrire faussement certains avocats, il n’est donc surtout pas question de course au référencement : au contraire, les noms de domaines génériques sont susceptibles d’engager la responsabilité de leur déposant et/ou de leur exploitant.
En effet, une telle jurisprudence dénote clairement une hostilité certaine de la haute juridiction à l’égard des signes descriptifs enregistrés à titre de nom de domaine.
Peut être que certains professionnels y verront une opportunité pour faire cesser des agissements de concurrents peu scrupuleux qui achètent des noms de domaines descriptifs à tour de bras pour « occuper l’espace » et acquérir de la visibilité.
Il se pourrait que le mouvement jurisprudentiel de ces derniers mois leur offre, en effet, une voie d’action.
Et ce serait logique puisqu’en droit des marques, tout intéressé peut invoquer à titre de moyen en défense la nullité d’un signe descriptif : il y a donc une certaine logique à neutraliser toute forme de monopole, quel qu’il soit, y compris s’agissant d’un nom de domaine descriptif quant à l’activité auquel il se rapporte.
En sus, cette hostilité rejoint la nouvelle (quoique de moins en moins « nouvelle ») politique de référencement de Google qui ne souhaite plus donner la part belle aux noms de domaine descriptifs, précisément afin d’éviter des abus en matière de référencement.
Il semble donc que l’achat de nom de domaines descriptifs pour être « bien vus » sur le net risque d’être « mal vus », non seulement par Google, mais également désormais, par les juridictions françaises.

2013

Diffamations et injures sur Facebook : critère de publicité des propos tenus
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /La presse internet et spécialisée s’est gargarisée de ce que la Cour de cassation a jugé, par un arrêt n°344 du 10 avril 2013[1], que des propos tenus sur Facebook (ou sur d’autres réseaux sociaux) n’auraient pas de caractère public et ne pourraient par conséquent pas être constitutifs de diffamation ou d’injure publique.
Il me paraît utile de revenir sur cette décision et notamment sur sa motivation pour l’expliciter un peu mieux.
La Cour nous indique, je cite : « que les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par Mme Y… tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n’étaient en l’espèce accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint, la cour d’appel a retenu, par un motif adopté exempt de caractère hypothétique, que celles ci formaient une communauté d’intérêts ; qu’elle en a exactement déduit que ces propos ne constituaient pas des injures publiques ; que le moyen n’est pas touché en ses quatres[2] premières branches » ; fin de citation.
Pour traduire cette motivation qui semble pourtant claire, il convient de d’attirer l’attention du lecteur sur le soin que la Cour de cassation apporte pour souligner qu’elle laisse aux juges du fond l’opportunité d’apprécier les faits.
En effet, la Cour de cassation indique que la Cour d’appel a apprécié le caractère privé des comptes Facebook et MSN de l’auteur des propos litigieux par un « motif adopté exempt de caractère hypothétique ».
Autrement dit : c’est à la Cour d’appel seule qu’il appartient de déterminer si un nombre plus ou moins important de personnes agréées par l’auteur sur une liste d’amis Facebook ou MSN permet d’indiquer s’il y a communauté d’intérêts entre ces « amis » Facebook ou MSN.
Et s’il y a communauté d’intérêts, nous ne sommes plus dans le cadre d’une communication publique (ndla : excusez la redondance) mais dans le cadre d’une correspondance privée.
Et, par conséquent, les qualifications de diffamation ou d’injure publique ne peuvent pas être retenues puisque les propos en cause ne sont pas publics mais bien privés.
On soulignera également que la Cour de cassation retient que « en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui incombait de le faire, si les propos litigieux pouvaient être qualifiés d’injures non publiques, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé »
Autrement dit lorsque Mme Y… se permet de qualifier de « chieuses » ses directrices, il se pourrait qu’elle commette, à défaut d’injure publique, une injure non publique et il appartenait alors à la Cour d’appel de le déterminer.
En l’espèce, la Cour d’appel s’est contentée d’écarter l’injure publique sans chercher à savoir si l’injure non publique avait été commise, et c’est sur ce dernier point que la Cour de cassation vient invalider la décision de la Cour d’appel.
La suite de la petite histoire nous sera donnée par la Cour d’appel de Versailles, cour d’appel de renvoi, afin de savoir si oui ou non il y avait injure non publique dans les propos de Mme Y… à l’encontre de ses directrices.

2012

Cyber-harcèlement et e-réputation : vade-mecum
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /La publication de contenus sur internet est devenue tellement facile qu’il n’existe plus de profil type du « cyber-harceleur ». Tout le monde peut être victime de cyber-harcèlement.
Toutefois, retrouver, sur internet, des photos ou des vidéos de soi, publiées par un « ex » ou par un tiers mal intentionné, n’est pas une fatalité insurmontable.
De même, diffamations et injures postées sur un blog peuvent être effacées, si l’on sait s’y prendre.
Nous vous proposons ici un vade-mecum des situations de cyber-harcèlement et des solutions existant pour nettoyer sa e-réputation et faire disparaitre des photos ou des vidéos intimes, des textes diffamants, injurieux et/ou dénigrants.
Il est même possible de retrouver et de poursuivre la personne ayant publié les contenus litigieux sur internet (même si certains croient parfois à tort qu’un pseudo leur confère anonymat et impunité).
La « e-réputation » se définit comme toute information disponible sur internet concernant une personne physique ou une entreprise.
Le « cyber-harcèlement » consiste à publier de manière répétée dans le temps et/ou sur un grand nombre de sites internet, des informations destinées à salir la e-réputation une personne physique ou morale.
A l’origine du mal, on notera toujours les mêmes (res)sentiments humains menant au délit : jalousie, rancune, racisme, sexisme, homophobie ou plus simplement un mécontentement.
Le plus souvent, les auteurs de cyber-harcèlement sont un ancien salarié, un ex-conjoint, un concurrent, un client mécontent, ou plus simplement un autre internaute croisé sur un réseau social, un site de rencontre ou un blog…
On retrouve même des <a href= »http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/quest-ce-que-le-harcelement/le-cyberharcelement/ »>victimes de cyber-harcèlement dans les écoles</a> et les conséquences peuvent aller, dans des cas extrêmes, jusqu’à la tentative de suicide.
Le mode d’expression choisi est souvent le même et il se traduit par la publication sur internet d’un texte diffamant, injurieux ou dénigrant ; d’images relevant de la vie privée, parfois très intimes et dénudées…
Or, si chacun jouit d’une liberté d’expression, garantie par des textes constitutionnels, cette liberté connait certaines limites, à savoir notamment les droits et libertés de ceux qui pourront être visés par la publication internet litigieuse.
Il existe deux grands types d’atteintes qui constituent précisément ces limites à la liberté d’expression : les atteintes à l’honneur et à la réputation, et les atteintes à la vie privée.
Sur internet, injure et diffamation sont parmi les atteintes les plus fréquentes.
Les atteintes à l’honneur et à la réputation sont précisément encadrées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment aux articles concernant la diffamation et l’injure, lesquelles sont les atteintes (fautes pénales et quasi-délictuelles) les plus courantes en matière de e-réputation.
A noter : en matière de diffamation et d’injure, la loi sur la presse de 1881 est applicable aux délits commis sur internet.
Comme d’autres auteurs et praticiens, j’ai apporté une contribution très critique à ce propos, mais le régime juridique n’a pas encore évolué (voir mon article à propos du <a href= »http://www.cordelier-avocat.fr/news.php?id=regime-prescription-presse-internet »>régime contestable de la prescription des délits de presse sur internet</a>).
Il faut impérativement distinguer injure et diffamation.
La diffamation est une fausse accusation portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne.
L’injure est une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective sans accusation précise.
Par exemple, qualifier quelqu’un « d’escroc », implique que l’on accuse une personne d’avoir commis des faits relevant d’un délit d’escroquerie. C’est donc une diffamation.
A l’inverse, les noms d’oiseaux et les termes ayant vocation à outrager, sans se référer à des faits ou des infractions précises sont des injures.
Par exemple, des expressions telles que « bandit » ou « voyou », dès lors que ces expressions ne sont pas liées à des faits précis, sont des injures.
A ce titre, il convient de souligner que la Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt de principe en date du mois dernier (C.cass. ass. plén. 15 fév. 2013, n°11-14.637), que la qualification entre injure et diffamation n’est pas cumulative et que chaque imputation doit faire l’objet d’une qualification précise.
Par conséquent, une injure n’est pas une diffamation et réciproquement, et on ne peut pas poursuivre l’auteur de la publication pour les deux qualifications simultanément concernant les mêmes propos.
Cet arrêt réaffirme la constante position de la Cour de cassation en matière de défense de la liberté d’expression et du respect des droits de la défense. Il démontre également que la recherche de la qualification juridique entre « injure » et « diffamation » relève d’une appréciation parfois complexe à départager.
La diffusion de photos et de vidéos est l’atteinte à la vie privée la plus fréquente.
Pour simplifier, l’atteinte à la vie privée est le fait de publier une photographie, une vidéo ou tout autre élément permettant d’identifier une personne physique sans y avoir été autorisé préalablement.
D’autres critères, tel un lieu privé ou public, ou la vie publique d’une personnalité peuvent jouer sur le caractère « privé » de ces éléments.
Les deux exemples les plus récurrents sur internet sont la publication de photos/vidéos volées (ou de clichés ou vidéos pris par l’auteur mais divulgués sans autorisation du sujet) et la publication de données d’identification ou de coordonnées privées (adresse, numéro de téléphone, etc.)
Dans la mesure où de telles publications sont répétées dans le temps et sur différents sites internet, on peut dès lors parler de <b> »cyber-harcèlement »</b>, quoique cette expression n’ait pas (encore) reçu d’écho jurisprudentiel.
La situation est malheureusement très fréquente et elle touche souvent des personnes après une rupture avec un ex-compagnon, amant ou conjoint (le féminin est ici grammatical, quoique statistiquement, les victimes sont très majoritairement des femmes).
En cas d’atteinte à la vie privée, de diffamation ou d’injure, il faut agir vite.
Si la priorité est donnée à la suppression du contenu, il faut immédiatement demander la suppression du message, de la vidéo ou de la photo.
Si la priorité est donnée à la poursuite judiciaire de l’auteur, il faut avant tout commencer par un constat d’huissier.
Le constat d’huissier est important, car c’est le premier acte que demande un avocat pour prouver les préjudices de la victime.
Ce constat d’huissier doit notamment démontrer : la matérialité des faits (la réalité des faits), leur date, et l’étendue du préjudice (le nombre de sites où la publication figure et/ou le nombre et le positionnement des résultats dans les moteurs de recherche).
Des délais courts pour agir contre une diffamation ou une injure.
Le premier réflexe est de chercher à savoir si les délais pour agir en justice ne sont pas dépassés.
Malheureusement, comme je l’expliquais dans mon article sur la prescription des délits de presse sur internet, de nombreuses victimes découvrent les textes diffamants ou injurieux beaucoup trop tard, parfois six ou huit mois, voire plusieurs années après leur date de publication.
Or, concernant la diffamation et l’injure, un délai de trois (3) mois court à compter de la première publication des propos litigieux pour saisir la justice.
Pire, ce délai continue de courir après chaque acte judiciaire de sorte qu’il faut en quelque sorte « maintenir en vie » le procès, comme on le ferait avec un malade sous assistance respiratoire.
C’est à peu près la seule procédure qui est dotée d’un régime de prescription aussi court et marquant autant la procédure (civile ou pénale).
En matière d’injure et de diffamation, il convient donc d’être très rapide pour agir.
Pour ce faire, il est recommandé aux professionnels exposés de recourir à un service de veille.
S’agissant des personnes physiques ne souhaitant pas mobiliser un budget pour cela, de simples recherches périodiques dans les principaux moteurs de recherche internet peuvent suffire à leur donner une idée de l’évolution de leur e-reputation.
Ainsi, « s’auto-googliser » ne relève pas du simple effet de mode : c’est un bienfait d’intérêt personnel aussi important que d’aller chez le dentiste pour un check-up.
S’agissant des autres atteintes non couvertes par le droit de la presse (par exemple, les atteintes à la vie privée), les prescriptions sont beaucoup plus longues : elles vont de 3 ans pour les délits jusqu’à 5 ans désormais pour les autres actions en responsabilité civile.
N.B. : pour toutes publications datées du 17 juin 2003 au 17 juin 2008, il faut bien prendre en considération que le délai de prescription, jadis de 10 ans en matière de responsabilité civile délictuelle, a désormais pour date butoir la date du 17 juin 2013 (LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile).
La lutte contre le cyber-harcèlement passe d’abord par un courrier de mise en demeure systématique.
Pour nettoyer son e-reputation, il n’est pas forcément nécessaire d’agir en justice.
En premier lieu, on peut utiliser les différents niveaux « d’alerte » existant parfois sur certains sites.
Ces « alertes » consistent en : 1) un « signalement » d’un contenu offensant à l’autorité de modération de l’éditeur du site internet concerné et/ou ; 2) une procédure de « plainte » interne au site internet concerné.
La difficulté est que ces procédures, sur certains sites internet, ne sont pas forcément fournies avec des explications en français. Ces procédures sont parfois extrêmement formalistes et rigoureuses, aboutissant souvent à une fin de non recevoir.
En outre, certaines qualifications juridiques existant en France ne sont pas toujours répertoriées.
En deuxième lieu, la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite « LCEN ») organise une procédure de notification de demande de retrait de contenu applicable aux hébergeurs.
Cette procédure permet de solliciter le retrait d’une information litigieuse, par courrier A.R. revêtant certaines formes précises prévues par ladite loi.
A ce titre, il convient de souligner que la notification d’une demande de retrait est assez formelle et qu’elle répond à des critères précis. Il faut donc manier les faits et les qualifications juridiques avec justesse pour obtenir gain de cause.
En cas de refus de suppression du contenu, la responsabilité de l’hébergeur peut être recherchée, sous réserve qu’on puisse démontrer que la publication litigieuse est bien attentatoire à un droit, et que ledit hébergeur en a été correctement informé de cette atteinte.
En troisième lieu, il est possible, sous l’empire de la même loi, de solliciter la suppression de la publication litigieuse par requête formulée auprès du juge, sans procédure contradictoire contre l’auteur du contenu litigieux dont l’identification n’est pas toujours possible (pour des raisons techniques que je n’expliquerais pas).
Toutefois, il convient de souligner que l’appréciation de la demande de retrait « judiciaire » est soumise à l’appréciation souveraine des juges.
En quatrième lieu, sous réserve que les délais de prescription le permettent, il est possible d’agir en référé (procédure d’urgence) afin de faire cesser les atteintes.
Cette procédure est rapide, mais elle ne permet d’agir qu’en cas d’urgence et d’évidence, afin de faire cesser un trouble, éventuellement sous astreinte journalière, ainsi que d’obtenir, sous certaines conditions, une provision sur les dommages intérêts à demander dans le cadre d’une procédure normale (dite procédure « au fond »).
<b>Enfin, en dernier lieu</b>, le dernier recours est d’agir au fond, c’est à dire au sein d’une procédure judiciaire classique devant un Tribunal statuant sur une demande de dommages-intérêts ou d’autre type de réparation.
Selon les cas, on peut préférer la voie de l’assignation devant un tribunal civil ou la citation directe devant un tribunal correctionnel.
Dans le cadre de l’assignation, on peut demander tous types de réparation, dont des dommages-intérêts et éventuellement une mesure de publication judiciaire du jugement ou d’un extrait du jugement, lorsque ce type de mesure participe à la réparation des dommages.
Dans le cas de la citation directe, il faut être particulièrement délicat dans la rédaction de l’acte de procédure pénal sur lequel s’appuiera le Procureur de la République pour asseoir son réquisitoire (ce qui signifie que si les faits sont mal qualifiés, le Procureur risque fort de requérir… la relaxe !).
De même, une plainte peut être déposée auprès du Procureur de la République, si les faits relèvent bien d’une infraction pénale.
A noter, toutefois, que l’accroissement constant du nombre de délits sur internet encombrent particulièrement les Parquets et que les Procureurs choisissent bien évidemment de poursuivre les dossiers les plus graves.
La lutte contre le cyber-harcèlement doit combiner des actions juridiques et des actions techniques.
Il existe de nombreuses sociétés proposant des services dits d’amélioration de son « e-réputation ».
Parmi elles, seules certaines se sont adossées aux services d’un avocat connaissant bien les problématiques de l’internet.
D’autres sont des sociétés commerciales qui vendent uniquement des services de référencement (mais un référencement « à l’envers » qu’on désigne sous le terme « d’enfouissement ») sans aucune valeur ajoutée juridique.
En effet, ces sociétés seules ne peuvent pas proposer d’agir en justice contre des éditeurs ou des hébergeurs de sites internet où figurent les publications litigieuses.
Or, il faut être clair : il ne suffit pas de pousser la saleté « sous le tapis » pour nettoyer son e-reputation ! Il convient de mener concomitamment des actions juridiques.
Malgré cela, de nombreuses sociétés, dont les plus connues, proposent donc – par défaut – des solutions de « maquillage » consistant à se limiter à tenter de reléguer en page 2 ou 3 les contenus indésirables dans les pages de résultats des moteurs de recherche… mais, dans la plupart des cas, ces contenus ne sont pas effacés !
A l’inverse, l’alliance entre une agence d’e-réputation et un avocat est synergique :
– l’agence assurant la veille et la recherche de contenus peut vérifier, grâce à des outils informatiques, l’étendue exacte des atteintes (notamment si elles sont répétées sur plusieurs sites) ;
– l’avocat assure la qualification juridique des faits et donne les premières indications quant aux voies de recours, leurs coûts et leurs délais ;
– s’agissant des envois de demande de retrait, un partage des tâches peut être opéré, avec l’accord du client, entre l’avocat et l’agence en e-réputation pour minimiser les coûts de traitement ;
– enfin, c’est seulement à défaut de pouvoir effacer les contenus juridiquement que l’agence en e-réputation participe à l’enfouissement des publications dont le retrait s’avère parfois problématique, même avec une procédure judiciaire.
C’est donc la combinaison d’actions techniques et d’actions juridiques, voire judiciaires, qui assure l’efficacité de mesures de nettoyage d’une e-réputation.
Dans tous les cas, la mise en oeuvre de ces actions n’a pas forcément un effet immédiat, même si on note, le plus souvent, une forte réactivité des hébergeurs face à une notification juridiquement bien motivée afin du retrait d’un contenu litigieux.
La protection de l’e-réputation est désormais une préoccupation intéressant tant les particuliers que les professionnels.

2009

Noms de domaine, marques et site-parking : quelle antériorité ? quelle responsabilité ?
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Depuis que les stratégies de référencement et d’accroissement de trafic à des fins publicitaires sont connues des acteurs de l’internet, on a vu tour à tour différentes méthodes d’exploitation des noms de domaines prospérer… parfois au détriment de tiers.
Sans que la liste se veuille exhaustive on dénombre parmi ces méthodes deux des plus connues :
- Le « cyber-squatting » (détention et/ou exploitation frauduleuse d’un nom de domaine homonyme de la marque et/ou du nom de domaine antérieurs d’un tiers) ;
- Le « site-parking » (enregistrement d’un nom de domaine redirigé – le plus souvent via un « redirect 301 » – vers une page contenant des liens publicitaires).
Si les actes de cyber-squatting sont désormais bien connus et facilement condamnés par les tribunaux, y compris par voie de référé, la condamnation de regristrars ou détenteurs de site-parking commence tout juste à rentrer dans les moeurs de nos juridictions.
Dans une affaire opposant le propriétaire d’une marque à la fois au registrar dudit Nom De Domaine et au titulaire du NDD litigieux la Cour de Cassation a pu retenir que le registrar, en ayant placé des liens commerciaux par redirection de l’url acquise par son client ne pouvait pas être qualifié de simple intermédiaire technique assurant le stockage de contenu, au sens de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN).
Par voie de conséquence, la Cour a conclu que le registrar ne pouvait échapper à sa responsabilité d’éditeur étant entendu que « les principes de loyauté et de libre concurrence attachés à l’exercice de toute activité commerciale imposent à une entreprise intervenant sur le marché de s’assurer que son activité ne génère pas d’actes illicites au préjudice de tout autre opérateur économique« .
LA RESPONSABILITE DES REGISTRAR EN MATIERE DE SITES-PARKINGS PUBLICITAIRES
Ce raisonnement démontre que (en une pierre, deux coups) à la fois le titulaire d’un nom de domaine acquis en fraude des droits d’un tiers pouvait être condamné à transférer ledit nom au titulaire de la marque ou du nom de domaine antérieur…
… et que le registrar, dès lors qu’il recourt à la solution du site-parking (prétendument dans l’intérêt de l’accroissement de la valeur commerciale et de la qualité du référencement du nom de domaine de son client) se rend, par cet acte, lui-même éditeur et donc responsable du contenu diffusé… parfois à l’insu de son client le temps que la redirection mise en place soit écrasée par l’édition d’un site ou par la mise en place d’une autre redirection commandée, cette fois, par le titulaire du nom de domaine.
Mais, si l’on exclue l’atteinte au droit d’un tiers, le recours au site-parking a d’autres conséquences notamment dans la relation registrar – titulaire de nom de domaine.
S’il on peut concevoir que le titulaire du nom de domaine récemment acquis et son registrar sont responsables des atteintes commises aux droits des tiers, qu’en est-il de l’atteinte commise par le registrar aux droits de son propre client ?
Le fait que le client ait adhéré à des conditions générales de ventes le prive-t-il de tout recours contre le registrar qui aura agit ainsi et créé un préjudice audit client, notamment au regard de la concurrence déloyale ?
Pour simplifier les choses, le seul titulaire du nom de domaine est celui au profit duquel l’enregistrement du nom a été validé.
Or, le registrar qui met en place, même par défaut, une redirection du nom de domaine pointant sur un site hébergeant des publicités (quasi-systématiquement très ciblées par rapport à l’intitulé du nom) va profiter directement au registrar lui-même et non au titulaire du nom de domaine.
En effet, les revenus acquis au titre des liens publicitaires en rapport avec l’intitulé du nom de domaine litigieux ne profitent pas au titulaire du nom de domaine, mais bien au registrar.
Cela pourrait caractériser un acte de concurrence déloyale au détriment du client titulaire du nom de domaine.
Toutefois, on peut s’interroger sur le sort d’une éventuelle responsabilité du registrar vis-à-vis de son client, notamment lorsque la faculté de recourir à une redirection est expressément prévue au contrat.
Cependant, il paraît difficile de concevoir que le registrar (souvent également hébergeur) puisse valablement encaisser des revenus publicitaires sans offrir de compensation à son client…
LA PROBLEMATIQUE DE L’EXPLOITATION DU NDD
Reste à savoir si un nom de domaine en site-parking peut être valablement considéré comme exploité.
Or, dès lors que l’on considère que la page publicitaire est éditée par le registrar, et non par le titulaire du nom de domaine, il apparaît difficile de considérer qu’il pourrait valablement y avoir exploitation dudit NDD.
La question trouverait-elle une réponse différente si c’est le titulaire qui exploite un page de publicité ?
La réponse est plus incertaine, car le NDD est bien utilisé à des fins commerciales…
… mais pour répondre totalement à cette question, il convient alors de s’attacher au fait de savoir si, comme le retient la jurisprudence en matière de droit des marques, l’usage fait du nom est un usage sérieux, en rapport avec les produits ou services considérés entre les deux signes (conflit de marque et de nom de domaine ou noms de domaine en conflit entre eux) dont l’antériorité est remise en cause.
L’appréciation appartient souverainement aux juges du fond.

2009

La nouvelle période d’essai dans les contrats de travail (depuis 2008)
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Les nouvelles dispositions du Code du travail, instituées par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » ont aménagé la durée et les conditions d’application de la période d’essai.
Le nouvel article L.1221-19 du Code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est :
– deux (2) mois pour les ouvriers et les employés ;
– trois (3) mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
– quatre (4) mois pour les cadres.
Exigence supplémentaire du nouvel article L.1221-23 du Code du travail : le contrat de travail (ou la lettre d’engagement) doit expressément prévoir la période d’essai, et il doit en préciser la durée en respectant ces limites : la période d’essai et notamment sa durée ne se présument pas.
INSTITUTION DU DELAI DE PREVENANCE
Avant la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail », le contrat de travail pouvait être rompu à tout moment, pendant la période d’essai, sans procédure de licenciement, sans motif et sans indemnité (sauf stipulations contraires).
Depuis l’intervention de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, applicable aux contrats conclus à compter du 27 juin 2008, l’employeur doit désormais respecter un délai de prévenance.
Ainsi, lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 du Code du travail, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– vingt-quatre heures en deçà de 8 jours de présence ;
– quarante-huit heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– deux semaines après 1 mois de présence ;
– un mois après 3 mois de présence. La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
UN DÉLAI DE PRÉVENANCE RÉCIPROQUE
Si l’employeur doit respecter un délai de prévenance, le salarié également.
L’article L.1221-26 du Code du travail dispose que lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est inférieure à huit jours.
SANCTIONS
Si les sanctions ne sont pas expressément énoncées par le législateur, elles semblent assez évidentes :
1) Le défaut de mention de période d’essai dans le contrat de travail la fait disparaitre ;
Les seuls modes de sortie du contrat sont donc la démission ou le licenciement, y incluant le respect des procédures et motivations.
2) Le non respect du délai de prévenance peut impliquer, en fonction de la durée initiale de la période d’essai, et du moment où intervient la rupture, soit :
– Un report du moment où intervient réellement la rupture de la période d’essai, en fonction du temps restant pour cette période d’essai, et du délai de prévenance dont bénéficie le salarié en fonction de son temps de présence dans l’entreprise ;
– Une nullité de la rupture de la période d’essai lorsque le délai de prévenance dont bénéficie le salarié est supérieur à la durée de la période d’essai restant à courir.

2006

Salarié, contrat de travail et droit au brevet de l’employeur
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /DROIT AU BREVET ET DROIT A LA PATERNITÉ
Le Code de la Propriété Intellectuelle dispose que l’inventeur salarié doit être mentionné lors de la
demande de dépôt de brevet, en raison de son droit à la paternité de l’invention.
Loin d’être uniquement rhétorique, ce droit permet notamment à l’inventeur-salarié d’apposer son nom
sur toute référence au brevet d’invention dont il est l’auteur. Il pourra notamment utiliser ce droit à titre
de citation dans un C.V., dans une correspondance ou sur son site internet personnel.
L’exercice de ce droit par le salarié s’effectue grâce à la communication à son employeur d’un formulaire de déclaration d’invention
(disponible sur le site internet de l’INPI). A noter que cette déclaration peut être adressée directement à l’employeur ou par
l’intermédiaire de l’INPI.
Le droit au brevet proprement dit (à savoir : la titularité des droits d’exploitation industrielle de
l’invention) n’appartient toutefois au salarié que si, cumulativement :
– Le salarié agit en dehors de toute mission inventive confiée
par l’employeur ;
– L’invention est faite en dehors de l’exécution de ses fonctions ;
– Le salarié n’utilise aucun moyen, connaissance, donnée ou technique spécifiques à l’entreprise ou confiés par elle.
La chambre sociale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé dans un arrêt du 21 septembre 2011 que l’article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel l’invention faite par le salarié dans l’exécution du contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l’employeur n’est aucunement discutable.
En tout état de cause, les cas de figure dans lesquels le salarié peut revendiquer pour lui-même le droit au brevet sont assez limités.
DROIT AU BREVET ET CONTRAT DE TRAVAIL
Un contrat de travail d’ingénieur ou de directeur de R&D par exemple, contient le plus souvent une
clause précisant une mission générale d’activité inventive dans un domaine particulier. Dans ce cas,
l’objet même du contrat de travail étant spécifiquement l’invention, le droit au brevet revient
contractuellement et de plein droit à l’employeur (on parle alors d’une « invention de mission »).
Dans les autres cas, il est fortement recommandé aux entreprises de prévoir une clause spécifique organisant le droit au brevet, notamment par un rappel de la loi.
A ce titre, il convient de noter que le salarié affecté à une mission banale et non inventive découvrant, dans le cadre de son travail ou avec ses outils de travail, un procédé
technique améliorant les performances industrielles de son entreprise, a droit au brevet à titre
personnel, sous réserve que son employeur ne souhaite pas le revendiquer dans le délai de quatre mois, comme le prévoit l’article R.611-7 du Code de la propriété intellectuelle (on parle alors d’une « invention hors mission attribuable »).
L’OBLIGATION DE RÉMUNÉRER LE SALARIE
Dans le cas d’une invention de mission ou d’une invention hors mission attribuable, le salarié a toujours droit à une rémunération, mais dans des proportions parfois très différentes selon les cas de figure.
Dans le cas d’une invention de mission, la rémunération supplémentaire à laquelle le salarié a droit est définie par la convention collective, un accord d’entreprise ou le contrat de travail.
Il est par conséquent important pour les parties, en cas de silence de la convention collective de verrouiller cette rémunération au moment de la signature du contrat.
De même, le salarié aura intérêt à prendre connaissance de la convention collective et de la rémunération y figurant pour savoir si ce complément de rémunération lui convient avant de s’engager dans le contrat de travail.
Dans le cas d’une invention hors mission attribuable, le transfert du droit au brevet, tel que prévu à l’article L.611-7-2 du Code de la propriété intellectuelle, a pour contrepartie l’obligation pour l’employeur de rémunérer le salarié à la hauteur de sa découverte… laquelle rémunération s’apprécie au regard de « l’utilité industrielle et commerciale de l’invention », à savoir : selon
l’importance, la difficulté et la qualité de l’invention, et non pas selon son seul intérêt économique (quoique ce dernier joue un rôle certain).
La rémunération au titre d’une invention hors mission est, par exemple, définie par rapport à l’intérêt scientifique et les
difficultés de la mise au point pratique de l’invention ainsi que sur l’importance de la contribution
personnelle de son auteur (Com. 21 novembre 2000, Arrêt n° 2086. Rejet. Pourvoi n° 98-11.900.)
En tout état de cause, que ce soit dans le cadre d’une invention de mission ou d’une invention hors mission attribuable, le silence du contrat de travail et/ou de la convention collective, à défaut d’accord entre les parties, conduiront quasi inévitablement ces dernières devant le juge afin d’expertise judiciaire.
Enfin, concernant la fraude faite aux droits de l’entreprise par un salarié, il a été jugé que le dépôt d’un brevet par un ancien salarié immédiatement après
son départ de l’entreprise justifiait valablement de l’action en revendication de l’employeur parce que
l’invention litigieuse avait été découverte dans le domaine précis d’activité de ladite entreprise, et grâce
aux moyens matériels et techniques de l’entreprise sans lesquels cette découverte n’aurait pas été
possible (CA Paris, 12 mars 1997, Sté Techni DD et Daniel Topczewski c/ Ets Grillat Jaeger et a.).
Précisons à l’égard de cet exemple que le dépôt fait par le salarié peut être considéré comme un acte de concurrence déloyale et parasitaire de nature à justifier l’octroi de dommages-intérêts au profit de l’ancien employeur, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

2006

Le droit d’auteur et le salarié
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Aux termes de l’article L.111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), la seule existence d’un contrat de louage d’ouvrage (ou d’un contrat de travail) conclu avec un auteur n’emporte pas cession des droits de l’auteur (prestataire ou salarié) à son cocontractant (client ou employeur).
Le CPI prévoit que la cession des droits sur une création doit être expresse et constatée par un écrit, lequel doit, de surcroît, comporter des mentions obligatoires précises, quelle que soit la création ou l’œuvre objet de la cession, le contrat de droit d’auteur étant d’interprétation restrictive (article L.131-3 du CPI).
Parmi ces mentions obligatoires, il convient de prévoir au contrat de cession notamment et sans que ce soit limitatif : durée, territoire, prix de l’œuvre (et donc une rémunération !), droits cédés, etc.
Il existe toutefois des exceptions à ce principe de cession écrite et préalable des droits, et parmi elles, notamment :
- Les œuvres collectives (dont les logiciels notamment) issues d’une élaboration d’ensemble au sein de l’entreprise, pour lesquelles la qualité d’auteur est attribuée par présomption à la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée (article L.113-1 du CPI)
- Les droits patrimoniaux (à l’exclusion du droit moral) afférents aux articles de presse sont automatiquement dévolus à l’éditeur du journal pour lequel les journalistes travaillent (le CPI, le Code du travail et les conventions collectives applicables aux journalistes organisent un mécanisme de transfert des droits patrimoniaux à l’employeur limité à une première publication seulement) ;
Ces exceptions, les plus courantes, sont toutefois à modérer.
En effet, les présomptions des articles L.113-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle peuvent parfaitement être combattues par la preuve contraire, lorsque elle est possible.
A noter à ce titre : depuis la loi DAVSI du 1er août 2006, les créations des agents de l’Etat (lesquelles faisaient parties des exceptions précitées) suivent désormais le même régime que les créations salariées et ne sont plus automatiquement dévolues à l’autorité publique.
De même, le contrat de travail ou l’accord de pige n’emporte pas la cession des droits patrimoniaux des journalistes au profit de l’éditeur au-delà de la première publication de l’article cédé. Toute autre utilisation doit donc faire l’objet d’une cession préalable, séparée et rémunérée.
Enfin, lorsque l’œuvre est réalisée en dehors de toute mission de service public (ou sans lien avec le service), l’agent public reste seul titulaire des droits sur son œuvre, y incluant les droits moraux et patrimoniaux.
L’interprétation des situations les moins évidentes seront à départager par le Tribunal de grande instance territorialement compétent.
Mais, en dehors des cas définis au CPI, le salarié ou le cocontractant (contrat de service) est seul titulaire de ses créations, dès lors qu’il n’est pas organisé par écrit et dans les formes imposées par la loi, une cession de ses droits patrimoniaux (le droit moral restant incessible).
En conséquence, l’employeur exploitant les créations de ses salariés ou cocontractants sans cession préalable se rend coupable d’acte(s) de contrefaçon, le paiement du salaire ou de la prestation de service n’entraînant aucun transfert des droits.
En tout état de cause, la clause du contrat de travail transférant automatiquement toutes les créations du salarié à l’employeur est nulle, en vertu des dispositions des articles L.111-1 et L.131-1 du CPI prévoyant la nullité de la cession des œuvres futures.
En conséquence, pour la grande majorité des cas, il convient de prévoir une cession au cas par cas des créations des salariés, bien que ce soit plus lourd en termes de gestion, notamment en cas de créations régulières, voire importantes, au sein de l’entreprise.
Aisément sanctionné de nullité du fait de son formalisme, la rédaction du contrat de cession de droits d’auteur n’est donc pas sans risque et nécessite la plupart du temps l’intervention d’un juriste ou d’un avocat exerçant en droit de la propriété intellectuelle.
Peut-être les employeurs peuvent-ils néanmoins espérer que le législateur ouvre un jour la porte au contrat de travail incorporant une mission de création en droit d’auteur, comme c’est le cas en matière de brevets.

2006

Le travail dissimulé : critères et sanctions
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Le travail dissimulé est défini à l’article L.324-10 du Code du travail. Il consiste, de la part d’un employeur, à dissimuler tout ou partie de l’activité d’un salarié.
Ce qu’on désigne vulgairement sous l’expression de travail « au noir » en est un exemple parfait.
Mais, le travail dissimulé peut aussi consister en une dissimulation d’une partie seulement du travail d’un salarié. Par exemple, la jurisprudence relève régulièrement que la non déclaration des heures supplémentaires d’un salarié consiste en une dissimulation d’un travail salarié.
De même, le fait de se soustraire intentionnellement à la remise d’un bulletin de paie, tel qu’exigé par l’article L.143-3 du Code du travail, et/ou à la déclaration nominative d’embauche (aussi appelée Déclaration Unique d’Embauche) tel qu’en dispose l’article L.320 du Code du travail, constitue une dissimulation de travail.
La sanction est lourde puisqu’elle assure à la victime de tels agissements une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, comme le prévoit l’article L.324-11-1 du Code du travail.
Il convient de souligner que le temps passé en entreprise ne joue pas sur le montant de l’indemnité forfaitaire de l’article L.324-11-1. Ainsi, une seule journée de travail non déclarée pourrait, en théorie, assurer six mois de salaires au salarié victime.
En outre, des dispositions pénales sont applicables au chef d’entreprise se rendant coupable de recours au travail dissimulé. Il est notamment prévu une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30000 Euro d’amende.
De plus, l’entreprise peut faire l’objet d’un redressement URSSAF et de mesures d’interdiction temporaire ou partielle d’activité.
Enfin, il convient de souligner la potentielle implication des cocontractants de l’entreprise fautive, notamment s’ils ont sciemment contractée avec elle. Ces derniers pourraient alors être condamné solidairement avec l’auteur principal au paiement des impôts, taxes, cotisations obligatoires et rémunérations dus en raison dudit emploi dissimulé.
Il en résulte que 100% du temps de l’activité professionnelle d’un salarié doit être couverte par une déclaration unique d’embauche (avant laquelle le salarié ne peut prendre place au sein de l’entreprise), un bulletin de salaire couvrant toutes ses heures ouvrées, ainsi que l’ensemble des déclarations et cotisations obligatoires.
Cela conduira notamment les entreprises recourant régulièrement à de la sous-traitance de faire examiner les clauses du contrat de sous-traitance par un avocat pour l’examen des clauses et pièces sociales indispensables pour prévenir toute action en responsabilité civile ou pénale.
C’est d’autant plus vrai depuis que la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article L.324-11-1 ne font pas obstacle au cumul de ladite indemnité forfaitaire avec les indemnités de toute nature auquel le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à l’exception de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (Soc. 12 janv. 2006, 03-44.777, Décision attaquée : CA Rennes, 5ème ch. prud’hom., 13 mai 2003).
Ce changement radical d’orientation de la jurisprudence, qui refusait, auparavant, un tel cumul, marque la volonté des juges de lutter contre le phénomène du travail dissimulé.
Désormais, les salariés victimes de travail dissimulé peuvent compter sur les indemnités compensatrices, les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou les indemnités pour non respect de la procédure de licenciement… en plus d’un forfait de six mois de salaire, garanti par l’article L.324-11-1 du Code du travail.
Cela signifie : pour les employeurs, de ne pas hésiter à se faire conseiller avant toute démarche hasardeuse ; et pour les entrepreneurs usant de sous-traitance de vérifier leur groupe de contrats.

2005

eReputation : le régime contesté de la prescription des délits de presse commis sur internet
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /En vue de garantir la liberté d’expression, L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 a prévu un délai de prescription de trois mois pour les infractions de presse (diffamation et injure, notamment).
Après des hésitations jurisprudentielles entre 1999 et 2000, en rendant un arrêt en date du 30 janvier 2001, la Cour de cassation a estimé qu’il appartenait aux juges du fond de rechercher la date de première publication de tout écrit numérique litigieux en vue de lui appliquer le même régime prescription que celui en vigueur pour les publications papier.
La rédaction actuelle de la loi est une gageure pour la gestion d’une eReputation, les victimes d’abus étant trop souvent privées de toute possibilité de voir réparer leurs préjudices.
Votée en juin 2004, la LCEN (Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique) a tenté d’introduire un régime de prescription plus long pour les délits de presse commis sur internet, afin de prendre en compte la « spécificité de l’internet » (Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 – publiée au JORF N°143 du 22 juin 2004).
Toutefois, cette tentative d’innovation législative a été censurée par le Conseil Constitutionnel, juste avant la promulgation de la loi (Décision n° 2004-496 DC en date du 10 juin 2004).
En effet, la LEN prévoyait que les délits de presse commis exclusivement sur internet se prescriraient « après le délai prévu par l’article 65 de ladite loi à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message susceptible de déclencher l’une de ces actions ».
Selon le Conseil Constitutionnel et de nombreux critiques, une telle disposition aurait eu pour effet de rendre quasi-imprescriptible tout délit de presse commis sur internet, et portait de ce fait atteinte à l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, portant la liberté de la presse et la liberté d’expression.
A ce jour, du fait de l’annulation de ces dispositions novatrices, seul le régime de prescription de trois mois de la loi de 1881 serait donc en vigueur, y compris pour les délits de presse commis (même exclusivement) sur internet.
Cours et Tribunaux font donc application de ce texte et ont notamment pour mission de rechercher la première date de publication de l’écrit litigieux, quelqu’en soit le support, pour juger de la recevabilité de la demande leur étant soumise.
Deux conséquences à cela :
1. Un écrit publié dans la presse peut ensuite être publié sur internet, après le délai de trois mois, sans risque pour son auteur d’être inquiété (s’il ne l’a pas déjà été pendant les trois mois précédents, à compter du jour de la publication dans la presse) ;
2. Le texte publié sur internet le 1er janvier, mais devenu visible le 10 avril par exemple, est hors de tout champ d’application de la loi : invisible sur le net pendant trois mois, il l’est aussi au yeux de la loi, du fait de l’application à l’internet d’un droit de la presse, inadapté.
Ainsi, de nombreux délits de presse commis sur internet ne sont pas, et continueront de ne pas être, punis en raison de cette prescription (trop) courte.
Si la prescription courte de trois mois a une justification afin de la protection de la liberté d’expression des organes de presse et des journalistes ; il ne faut pas oublier que les éditeurs de presse papiers sont soumis à un certain nombre d’obligations qui ne pèsent pas sur le titulaire d’un site web.
On citera notamment à la charge des professionnels de la presse et de l’audiovisuel : les innombrables dépôts encadrant la publication de presse (légal, judiciaire, administratif…), auxquels s’joutent « l’ours » et la responsabilité en cascade.
A l’inverse, la publication d’un site web par un non professionnel, ne requiert aucune déclaration préalable, aucune mention obligatoire, aucun dépôt légal.
De plus, comme expliqué plus haut, contrairement à la presse papier, nécessairement périodique et ayant donc vocation à l’oubli, la publication sur internet a vocation à une popularité croissante, au regard de la fréquentation du site internet et du travail des robots et des services d’indexation des moteurs de recherche.
On peut imaginer, sans vouloir refléter une réalité quelconque, ni dresser un profil psychologique de l’internaute « moyen », que plus un site sera diffamant, injurieux ou obscène, plus il sera visité et donc visible dans les moteurs de recherches… pour peu qu’on y diffuse du contenu interactif en plus du texte…
En ajoutant à cela un doigt de commentaires d’internautes et le contenu litigieux évolue tous les jours et il rapporte encore plus d’audience !
C’est en cela précisément que la jurisprudence entre 1999 et 2001 évoquait la « spécificité de l’internet » : l’internet c’est du contenu interactif, mis à jour en temps réel, dont la popularité croit avec le temps… tout l’inverse de la presse papier.
En conséquence, et pour schématiser, si un écrit en presse papier tombe dans l’oubli rapidement… sur internet, le même écrit commence dans un océan d’oubli, et voit croître sa notoriété avec le temps.
Dernière critique, et non la moindre : la publication sur internet permet des fraudes que ne permet pas la publication de presse papier.
Par choix nous ne citons plus les différentes fraudes permettant de dissimuler un écrit sur internet afin de ne pas en faire l’apologie.
Quoiqu’il en soit, la prescription du droit de la presse étant trop largement appliquée à l’internet, la gestion de la eRéputation devient un parcours du combattant.
Il parait donc nécessaire que le législateur crée un régime de prescription spécifique au délit de presse numérique, comme cela avait été tenté en 2004. Mais différemment, cette fois.
Il serait alors question de fixer un délai de prescription plus long, tout en conservant le principe de la date de première publication sur internet, pour éviter l’effet d »imprescriptibilité du délit.
L’internet et la presse papier étant trop radicalement différents quant à leur portée dans le temps et leur facilité de mise en oeuvre pour se voir appliquer un même régime de prescription.
Mise à jour du 12/10/2008 :
Cette opinion qui était partagée par de nombreux professionnels de l’édition et du droit s’est vue récemment concrétisée dans un projet de loi tendant à réformer le régime du délit de presse commis par voie de communication électronique en ligne.
En effet, le Sénat est à l’origine d’une proposition de loi dont le texte peut-être retrouvé <a/href= »http://www.senat.fr/leg/ppl07-423.pdf »>ici</a> : ; et dont le texte, simple et brillant, est le suivant :
« Article unique
Le dernier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Le délai de prescription prévu au premier alinéa est porté à
un an si les infractions ont été commises par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, sauf en cas de reproduction du contenu d’une publication diffusée sur support papier. » »
Cette formulation, ajoutant un alinéa au texte de l’article 65 sus visé actuellement en vigueur, validerait que le délit commis en vertu d’une première publication sur internet d’un texte – différent de ceux qui auraient pu paraître auparavant dans la presse – serait désormais prescrit par 1 an et non par 3 mois.
Des critiques se font déjà entendre à ce titre en soulignant que ce délai d’un an serait encore trop long.
Pourtant, ne leur en déplaise, ce délai est encore plus court que la plupart des délais applicables en matière délictuelle : le droit commun prévoit en effet une prescription de principe de 3 ans pour les délits.
Fervents défenseurs de cette petite réforme pour un monde plus juste, nous espérons qu’elle sera bientôt votée et promulguée.

2005

Choisir une marque : difficultés et risques
Matthieu CORDELIER / 0 Comments /Le dépôt d’une marque ou le choix d’un nom de société est moins aisé qu’il ne le paraît. La multitude des noms coexistants, la complexité du choix des classes de produits et services, les difficultés du choix stratégique entre un dépôt et une acquisition de marque ou de nom de domaine… sont autant de difficultés qui poussent de plus en plus de déposants à recourir aux services d’avocats pour effectuer les recherches, les dépôts ou négocier un accord de coexistence de marque.
S’ajoute à cette tendance le fait que les risques juridiques et financiers encourus (action en contrefaçon indemnitaire et demande d’annulation ou de transfert de marque, le plus souvent sous astreinte), peuvent être une source de graves problèmes pour l’entreprise, quelqu’en soit la taille (groupes, PME, voire artisans ou commerçants individuels).
A ce jour, le contentieux en droit des marques est chaque jour plus important, quelques soit les tailles et le niveau respectif des entreprises concurrentes (et parfois vaguement concurrentes en raison d’une marque notoire). Ce phénomène concerne également les litiges impliquant : marque contre nom de domaine ; marque contre dénomination sociale ou contre nom commercial ; nom de domaine contre dénomination sociale ou nom commercial.
Pour prévenir ce type de contentieux contre une signe antérieure, il est donc fortement recommandé aux futurs déposants de consulter un avocat qui effectuera, à leur place, recherches et dépôt, et vous avisera sur les difficultés rencontrées et les solutions à y apporter (accord de coexistence de marque, acquisition de marque, action en déchéance de marque inutilisée…).
En tout état de cause, un avocat peut accompagner le déposant, avant le dépôt de sa marque, pour l’étape qui lui conviendra et l’aider, le cas échéant, à trouver une solution économiquement sûre.
Toutefois, un petit guide en trois étapes simple, peut permettre au déposant qui a choisi de se passer d’avocat de se rendre compte de la facilité ou de la difficulté de demander, seul et de son propre chef, l’enregistrement du nom qu’il a choisi à titre de marque.
Voici ce guide :
1. Avant toute chose, commencer par l’élémentaire : en fonction des activités potentiellement couvertes par la marque future, il convient de déterminer les produits et/ou services concernés.
Pour bien délimiter le champ de ces produits et services, le déposant devra passer en revue l’ensemble des points abordés dans son plan marketing, et notamment toutes les activités envisagées, à titre principal ou à titre secondaire.
Par exemple, si le déposant crée une entreprise de services informatiques, quels sont les services envisagés (logiciels, multimédia, création vidéo numérique, etc.) ? et sera-t-il amené (même potentiellement) à distribuer des produits, y compris à titre d’accessoires (DVD, supports de mémoire flash, etc.) ?
Pour aider les déposants dans ce choix stratégique, une nomenclature des classes de produits et services est disponible sur le site internet de l’INPI.
2. Après cette définition précise du « contenu » de la marque, il convient de s’intéresser à son « emballage » et donc à la disponibilité du nom envisagé.
En effet, les marques antérieures (c’est à dire : déjà existantes, au moment de la demande d’enregistrement faite par le déposant) ne peuvent être contrefaites, ni de manière servile, ni de manière approximative, dès lors qu’il y a une ressemblance entes les deux noms et une coïncidence de classes de produits et services.
Pour bien effectuer une recherche en antériorité, plusieurs méthodes doivent être envisagées en procédant par une méthode imitant le système de l’entonnoir : partir du plus large et approximatif, pour arriver au plus précis et pertinent.
La comparaison porte à la fois sur le nom littéral de la marque et, dans une moindre mesure, sur sa forme, ses couleurs, son apparence, s’il y a lieu.
Il convient de bien souligner qu’en cette matière, les différences comptent moins que la ressemblance générale des noms concurrents. Et, cette ressemblance peut entraîner l’annulation du dépôt le plus récent au profit de la marque bénéficiant de l’antériorité.
La marque est un signe distinctif, pas un moyen d’imiter le concurrent, ni de près, ni de loin.
3. Une fois toutes les vérifications effectuées, il convient de remplir le formulaire de dépôt, avec une représentation graphique (ou non) de la marque et la listes des classes de produits et services visés.
Le déposant pourra alors préciser les classes de produits visés en excluant ceux qui pourraient déjà être occupés par une marque concurrente et ressemblante.
Il ne reste plus qu’à déposer et payer les droits d’enregistrement dont les tarifs sont disponibles sur le site de l’INPI.